dimanche, 01 mars 2015
Le choléra de 1832 à Paris
Nous reproduisons ci-dessous un fragment d'un chapitre du livre de Louis Chevalier, historien natif de l'Aiguillon-sur-Mer, Classes laborieuses et classes dangereuses, publié en 1958, dans cette belle collection dirigée par Philippe Ariès, Civilisation d'hiver et d'aujourd'hui, qui vit fleurir les œuvres de Michel Foucault, de Victor-Lucien Tapié, de Louis Chevalier et de Philippe Ariès lui-même.
On y découvre à quel point Paris a changé : les quartiers alors pauvres, vus comme infréquentables, sont aujourd'hui huppés et proprets. Mais ce que l'on ne trouve point modifié, c'est la frontière invisible et pourtant implacable que créée l'argent. Ni la Révolution, ni la République, avec leurs grands discours et leurs crimes "justifiés", n'ont aboli cette frontière. Parfois, elles l'ont même rendue encore plus efficace en niant son existence.
Mortalité cholérique et mortalité normale
Catastrophe exceptionnelle, sans doute, que ce choléra de 1832 qui succédait à une longue période, pendant laquelle on pouvait croire que de tels fléaux s'étaient à jamais évanouis. "Les grandes mortalités sont devenues rares", écrivait un peu vite le statisticien de la ville, présentant, en 1823, le deuxième tome des Recherches statistiques concernant Paris. Comment ne pas voir plutôt en cette mortalité exceptionnelle une forme exaspérée de la mortalité normale, une solennelle et monstrueuse expérience, plus lisible et plus incontestable, de cette quotidienne mortalité ? Pour l'une et l'autre, les causes véritables sont les mêmes. Non ce microbe, monté de proche en proche des bouches du Gange, mais cette vieille misère accumulée, cet ancien fond de sous-alimentation, de fatigue et d'usure : terrain de choix, et à tous moments, pour la plus forte mortalité des plus misérables ; favorable aussi, mais accessoirement et secondairement, à une épidémie dont il faut bien reconnaître qu'elle est restée sans prise sur les régions de France, même urbaines, où la misère et, en même temps qu'elle, la mortalité normale étaient le plus faible.
La ressemblance va plus loin : jusque dans une même inégalité des pertes qu'elles infligent l'une et l'autre aux groupes sociaux. La seule différence est que, le chiffre des décès cholériques étant plus élevé, la répartition par classe, en 1832, est plus nette et qu'il est possible d'aller jusqu'à ces catégories infimes qui, dans les statistiques de mortalité normale, n'apparaissent pas : non plus seulement aux bourgeois et au peuple, mais parmi eux, aux groupes professionnels, avec leurs niveaux de vie et leurs genres de vie, leur condition matérielle et morale, leurs travaux, leurs gains, leurs plaisirs, leurs passions ; non plus seulement aux arrondissements et aux quartiers, décrits en fonction de leur population prédominante, bourgeoise ou ouvrière, mais aux rues et aux logements, observés avec leurs caractères variés d'ensoleillement, de ventilation, d'humidité, de propreté. Toute une répartition sociale se lit en cette répartition de la mortalité : rentiers, petits patrons, travailleurs en atelier ou en chambre, travailleurs en plein air, travailleurs du fleuve, et même ces catégories inférieures ou considérées comme telles, journaliers, porteurs d'eau, chiffonniers enfin, chargés des déchets de la ville et du dégoût de tous. Tout un paysage urbain aussi, dans un grand détail de rues et d'impasses, dans une minutieuse classification qui n'est qu'une reproduction de la nomenclature des décès.
L'épidémie est une première et incontestable expérience de l'inégalité sociale, pour le statisticien de la ville qui fait, de l'inégalité devant la mort, une découverte dont nous décrirons les phases : mais elle l'est aussi, et immédiatement, pour les habitants de la ville, et d’abord pour les plus infimes et les plus férocement frappés par le mal. C'est à juste titre que Jules Janin évoque, en pleine épidémie, cette "peste d'une populace qui se meurt seule et la première, donnant par sa mort un démenti formidable et sanglant aux doctrines d'égalité dont on l'a amusée depuis un demi-siècle". Démenti, par l'apparition du fléau dans les quartiers les plus pauvres : sont tout d'abord atteints, le 13 février 1832, un portier de la rue des Lombards, puis une petite fille de la rue du Haut-Moulin, dans le quartier de la Cité, puis une marchande ambulante de la rue des jardins-Saint-Paul, puis un marchand d'oeufs de la rue de la Mortellerie. Démenti, par les cynique commentaires de la presse bourgeoise : "Le choléra-morbus est dans nos murs, écrit le Journal des Débats, le 28 mars. Hier, un homme est mort dans la rue Mazarine. Aujourd'hui, neuf personnes ont été portées à l'Hôtel-Dieu, dont quatre déjà sont mortes. Tous les hommes atteints de ce mal épidémique, mais qu'on ne croit pas contagieux, appartiennent à la classe du peuple. Ce sont des cordonniers, des ouvriers qui travaillent à la fabrication des couvertures de laine. Ils habitent les rues sales et étroites de la Cité et du quartier Notre-Dame".
Louis Chevalier, IN Classes laborieuses et Classes dangereuses
Sur AlmaSoror :
Caste, classe : le théâtre de la distinction sociale
Etat-civil, état des personnes
Au matin parisien du 4 juillet 2014
Visages hâves des parisiens des bas-fonds...
| Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 02 juin 2014
Poèmes à cueillir sur AlmaSoror
Sur notre colonne de gauche se trouve l'entrée vers l'album Poésie. On y trouve des poèmes, de la barmaid de ce blog sans partage, mais aussi de poètes invités pour une page ou deux.
En voici la liste et le vers d'ouverture :
Le train rouge
Le train rouge a filé sur les brumes du ciel
Venise
A Venise qui choit dans la lagune
Miroir d'eau
Soleil brillant parmi les mille anges trop pâles
Rue Milton
Petit matin, soleil, vent tiède
L'étoile
Je poursuis une étoile aux quatre coins du monde
Grise du soir
Tes yeux gris mon amour embellissaient les lieux
Séjour lunaire
Ton char aux cent rennes lunaires
Véranda
Hier soir un ciel orange se vautrait sur la plage
The Stoned / Les défoncés
La chanson des gisants
Gisez ! et ne parlez plus. Écoutez le vent du soir...
Atone
L'abîme
Tes caresses ont laissé mon corps en ruines
L'horloge
L'horloge de la gare a sonné quelques coups
Brest
Gange
Mais je sais que nous sommes un poisson
Zip & flip
Le rêve aux bulles
Comme dans la chanson d'enfant
La mer
Funboard
Sur l'océan le soir, quand le soleil se couche
Deltaplane
Ne plus jamais poser mes deux pieds sur la terre
Abattoir
C'est drôle et c'est bien de se revoir
Le van
Nous écoutons la radio dans le van
Ciao Baby
Les fressures de l'aube
J'ai besoin d'une femme qui me tende le sein
Autel
Tango de nuit, chanson d'abandon
Dans la nuit opale, je t'ai rencontrée
Messe de la citadelle
Baignée dans ton rire éclatant, sous les vagues du ciel
Le malade
Les sœurs douloureuses
Minuit dans le hangar ! et nos sœurs douloureuses
Dans un bar de nuit banal
Lumières dans la ville morte
Lac de nuit, sur ta rive herbeuse je dansais
Jour de Sleipnir
Les oiseaux fantômes ont passé la frontière
Lau
J'ai trouvé un soir une étoile
Charade
| Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 27 juillet 2012
Mémoire d'India Song, pour Sara et Gange

Ce billet est dédié à Sara et Gange.
À Sara, qui me traîna un jour pour voir ce film si long. Au bout de dix minutes, la moitié de la salle déjà peu nombreuse était partie. Il ne restait plus que la caste, la secte, ces gens seuls, solitaires, qui regardaient ce film qu'ils connaissaient déjà avec des yeux de ceux qui sont ailleurs, des yeux plongés dans quelque chose que je ne comprenais pas. Et, vraiment, ce fut une expérience gênante, bouleversante, étonnante, agaçante, fascinante, de voir ces gens fous regarder ce film fou. Grande, grande communion de solitudes inextricables !
À Gange, auprès du fleuve totémique de laquelle ce film est dit se passer. À toi, Gange, qui nous a illuminés, à toi notre soeur-chienne, notre fille, notre mère, notre fleuve d'amour.
Sara au café et Gange embrassée


Je remercie les internautes qui ont mis en ligne ces vidéos, que j'emprunte...
Publié dans Chronos, Clair-obscur, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 31 décembre 2011
La naissance des ours
Veille - Nuit - Premier matin
Veille
Les pères, les mères et les amis attendent tout le jour la naissance des oursons.
Dès l'aube, ceux-ci ont fait savoir que ce serait pour aujourd'hui. Mais le jour se lève et s'écoule sans que rien d'autre n'ait lieu que l'attente. L’attente de tous et la douleur de celle qui enfante.
Alors Spiegel im Spiegel, la berceuse d'Arvo Part qui multiplie les images dans les miroirs, joue tout le jour dans la fraîcheur froide tandis que des cierges se consument dans les maisons du Sud et les églises d'Île de France.
Même dans les pages des livres d'enfants, tout se tait ; tout s’immobilise ; les personnages attendent. Animaux et humains, ils savent que quelque chose va avoir lieu.
Et dans les cuisines on ne sait pas quoi faire en attendant. Les heures s’écoulent dans l’étonnement du silence.
Nuit

Kiko, par Sara
La nuit tombe et l’ourson frappe à la porte. Tout prend un air de crèche. C’est la fête émerveillée.
L'ourson, à peine éclos, prend place dans la fratrie totémique : un frère-Dieu, deux sœurs-fleuves et un frère-fleuve, qui l'entraîneront sur les routes puissantes du rêve éveillé.
Loin du Sud, à Paris, au fond d’une cour de Montparnasse, quelqu’un songe : quel est cet enfant assez étrange pour naître lors de la trêve des confiseurs ?
Premier matin

Le soleil d’hiver s’est levé sur le premier matin d’Orso sur la terre. Il a entrevu le ciel à travers le rideau. Il a tété sa mère, sucé son pouce. Il a voulu que son premier soir d’homme soit un réveillon de nouvel an, parce que la vie qu’il commence est une révolution.
Bienvenue dans ce monde ! Et pour t'accompagner, une phrase de philosophe :
"Quel vin est aussi pétillant, savoureux, enivrant, que l'infini des possibles!"
Søren Kierkegaard
Edith de Cornulier-Lucinière, pour Orso B, né le 30 décembre 2011 au bout d'une longue journée.
Publié dans Chronos, L'oiseau, Le corps, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (7) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 25 mai 2010
DE L INCOMPREHENSION NOTOIRE DE L'HOMME
DE L INCOMPREHENSION NOTOIRE DE L'HOMME QUANT A L'EVOLUTION DE LA HIERARCHIE DES ESPRITS DU MONDE
Par S.Barynsflook
Pas de questions sur l'évolution de tout un chacun, l'histoire des peuples, l'histoire des communautés, l'histoire des individus... Toutes les erreurs notables sont déjà notées quelque part. Et pourtant ils s'obstinent, ça les excite de revivre ces passes palpitantes de l'histoire, de la vie, de l'histoire de la vie. Incalculables vertus causant d'incalculables torts, indénombrables vices pour le plaisir de tous. L'arbre se courbe devant celui qui voudra bien chercher à lui faire courber l'échine, et bien peu malins mais nombreux ceux qui en sont capables.
Accalmie des bons jours, dangereuses bourrasques de ceux pendant lesquels tu règnes... Du sentir au toucher, le dictat de toujours, tu t'es toujours trompé, rien jamais ne te perdra et pourtant tu as déjà perdu.
J'ai créé l'armée du désespoir afin de te détrôner immonde parasite du monde des gentils. Seuls les grands ont pu observer la vérité, car cette dernière ne se sait jamais, elle s'observe... Tu aurais du comprendre, tu aurais du m'entendre. Tu verras la lumière quand tes fautes expiées tu auras renoncé à rejoindre ce gué. Le gué de l'astre mort le gué du mirador noir à cent lieues des humains, moi je t y attendrai, et tu pourras crier, forcer ou attaquer mais le soleil jamais ne te laissera passer. Ainsi, tu vois, sans même lever d'armée, sans trop de vies renier, sans les faire soupirer, j'ai ressaisi ma chance d'être de ces grands esprits, qui, dans l'histoire des Mondes ont su harmoniser les émotions, les vies, celles la même que tu t'évertuais à annihiler, aigri par la longueur des ères.
Barynsflook
Publié dans Chronos, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 26 février 2010
In Memoriam Gange
Ma chère Gange est partie en novembre 2002 voir ailleurs si on y était. Pour le dire plus brutalement : novembre 2002 est le mois de sa mort. Dès les jours suivants, on nous demandait : "et vous allez prendre un autre chien ?"
Il y a quelques jours, ce fut le tour de Lune de quitter ce monde, laissant Catherine, son humaine, et Têtue, sa fille, seules face à face dans la douleur partagée. La grande Lune qui hanta l'appartement du 13, boulevard M. quelques jours et qui faisait si peur aux voisins.
Perdre un être cher : qu'il soit homme ou chien, une seule chose change : le regard d'autrui. Le degré de légitimité qu'il accorde à notre peine.
Et c'est au fond assez amusant de savoir que les gens mettent des notes aux tristesses des autres.
"Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died"
Leonard Cohen in Everybody knows

Mais je sais que nous sommes un poisson
Toi et moi quelque part nous nageons dans l'océan
Tu es je ne sais où, je suis toujours ici
Mais au fond nous sommes un poisson
Ton départ a tout effacé, sauf ta présence.
Tes cendres frémissent dans leur boite,
Sur le piano.
Et je ris lors des grands dîners,
Je ris derrière mon masque.
Car je sais que nous sommes un poisson.
Tu as quitté ton corps,
Dans la mort.
Et j'ai quitté le mien, (l'air de rien)
Pour te suivre.
Voilà comment nous sommes devenues poisson.
Comme toujours, silencieuses,
Et comme toujours, amoureuses
De cet océan seul et immense,
Salé et sans souci
Qui nous noie inlassablement.
Seules certaines musiques
Endiablées mais lentes
Seules quelques musiques
Lancinantes
Laissent le poisson
Coloré
Nager dans l'air chaud du salon
Certains yeux nous voient
Je le vois
Certains yeux nous voient
Faire phe phe phe
Dans les vagues de fumée
Et sans drogue
Soeur de coeur
Sans alcool ni opium
Rien que le souvenir
De ton regard sans fond
Coeur de soeur
Pour rejoindre les fonds
Bas fonds
Tréfonds
De l'océan universel
Dans lequel
Toi et moi,
Le poisson,
Nous nageons.
Oui je sais que nous sommes un poisson
Toi et moi quelque part nous nageons dans le néant
Tu es je ne sais où, je suis je ne sais qui
Et c'est fou, nous sommes un poisson...
Au fond de mes yeux astrologues
Mon amour soeur
De mon ventre océanographe
Mon amour chienne
De mon coeur astrophysicien
Mon amour Gange
Au creux de mes mains géographes
La planète, petite comme une bulle
Ronde comme une pastille dans un tube
Danse
Et l'univers immense et nébuleux
Mène la transe
C'est ainsi que je sais
Que je sens
Que toi que moi que nous
Sommes Une
Nageant
Dans l'océan
Qu'importe que je parle à d'autres gens ?
Que je sois quelque part, à quelque moment ?
Puisque le temps n'est qu'un mirage
Et l'espace invisible...
Si le réel n'est que la vérité,
Nous ne faisons qu'une
Et nous faisons phe phe phe
Ton départ a tout effacé
Sauf mon absence
Et les cendres de mes cigarettes
Près du piano.
Et je ris lors des grands dîners
Je ris derrière mon casque.
Car je crois que nous sommes un poisson.
Certains yeux nous voient
Je le vois
Certains yeux nous voient
Faire phe phe phe
Dans l'écume-fumée.
Edith de Cornulier-Lucinière
Publié dans Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 01 février 2010
Le train rouge
Le train rouge a filé sur les brumes du ciel
et l'enfant qui savait a sucé le bonbon
j'oublie tout des années de silence cruel
je maudis la raison.
les voix coulent ce soir et les coeurs téléphonent
dans l'immense brouillard du restaurant d’hôtel
il a plu sur la ville et les motards frissonnent
en attendant le temps des duels
et nos mains ont voulu recommencer l'amour
mais les yeux trahissaient les rancoeurs du passé
et l’enfant qui savait l’indigence du jour
souriait à la nuit à quelques pas du pré
La nuit n’a jamais sauvé personne
au bout de sa route nous sommes tous demi-loups
Dans le creux de tes bras mon coeur frissonne
et mon âme est partie avec les douze coups
Mon coeur tatonne, mes doigts cherchent l’aurore
Mais l’esprit souffle où il peut.
Et dans le grand désert poussiéreux de mon corps
il n’y a plus de feu.
Édith de CL
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 22 décembre 2009
Convergence(s) !
Publié dans Paracelse | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 02 septembre 2009
Sonnet sans titre
Gange par Sara
Assis sur un fagot, une pipe à la main,
Tristement accoudé contre une cheminée,
Les yeux fixés vers terre, et l'âme mutinée,
Je songe aux cruautés de mon sort inhumain.
L'espoir qui me remet du jour au lendemain,
Essaie à gagner temps sur ma peine obstinée,
Et me venant promettre une autre destinée,
Me fait monter plus haut qu'un empereur romain.
Mais à peine cette herbe est-elle mise en cendre,
Qu'en mon premier état il me convient descendre
Et passer mes ennuis à redire souvent :
Non, je ne trouve point beaucoup de différence
De prendre du tabac à vivre d'espérance,
Car l'un n'est que fumée, et l'autre n'est que vent.
Marc-Antoine de Saint-Amant
XVIIème siècle
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 05 août 2009
Errants des mégapoles d'Europe
Lorsqu’on traduit les droits de l’homme dans les langues qui ne possèdent pas les mots de la philosophie grecque et chrétienne, les articles sont ramenés à leur plus simple expression. Chacun peut aller où il veut… chacun peut avoir une maison… L’ironie du grand texte nous prend à la gorge : en son nom, nous jetâmes sur la Serbie, sur l’Irak, des bombes. Mais dans nos cités, n’est-ce pas l’inégalité qui plonge les gens dans la misère et l’oppression qui les laisse sans ressource ?
Le roman des jungles urbaines
Comme les figures célèbres des romans - Jean Valjean, Oliver Twist et Rémi sans famille, Gervaise et les filles de De Quincey -, les peuples de l’abîme vivent dans l’inframonde de la cité, se disputent ses restes, se réchauffent loin du soleil social.
Mais, exaltés dans la fiction, on les conspue dans le réel. On force les enfants à finir le poulet, puis les berce avec l’histoire d’une gentille petite poule ; de même, on les écarte de cet homme aux habits miteux qui empeste sur le macadam, pour leur conter, avec des larmes dans la voix, l’histoire de Jean Valjean.
Il faut pourtant poser des yeux ouverts sur notre monde. Dans les rues des villes, des hères survivent au milieu de la grande consommation. Pour les humains brisés par les travaux, l’isolement et le manque, il n’y a pas de recours. Au XXème siècle, nous vîmes éclore des architectures qui parquaient les êtres dans des tours laides, vite insalubres, aux portes des villes. Mais voilà que fleurissent de nouveaux nomadismes.
Les gueux
Qui sont ces êtres qui, lorsque nous tirons les verrous sur la chaleur de notre foyer, continuent de hanter la nuit de la ville ?
Le paria vit hors du monde social ; il l’accepte, bien qu’il en souffre : c’est une condition de sa dignité morale. Il ne veut pas de la vie cadrée, sans choix, sans vérité, que le monde lui propose. L’exclu s’est trouvé déshérité, socialement, matériellement, financièrement. Il n’attise pas la pitié de la société ; il l’indiffère, ne correspondant ni à ses héros, ni à ses protégés. On assiste le défavorisé avec condescendance ; il en souffre, ou bien il est complaisant.
Ainsi la figure de l’exclu est double : celui qui refuse notre monde ; celui qui n’y accède pas. La société pose, comme condition pour donner l’asile à un être humain, qu’il accepte le contrat qu’elle lui propose. Mais ce contrat n’est-il pas biaisé, entre une énorme société organisée et l’individu qui naît en son sein ?
L’espace, la lumière et le mouvement
Où peuvent vivre les gueux, avec leurs chiens et leurs bagages, sans déranger l’ordre économique et social ? La rue n’est pas libre. Tout l’espace du monde est sous contrôle. Où vivre, où déployer son corps, où cueillir sa nourriture ? Des courageux se battent pour le droit des animaux à vivre leur animalité dans un monde dévoré par le « progrès ». Etendons cette lutte aux humains : qu’ils puissent aussi vivre leur animalité – le déploiement libre de leur corps et de leur cœur dans un espace ouvert.
La liberté de circuler, la liberté de vivre sous un toit, supposent mille papiers en règle. Les champs, les forêts, les océans ne sont plus libres.
Que signifie une liberté qui ne serait qu’un concept, un droit différé, un droit administré ? L’homme face à l’univers n’existe plus : il n’y a plus que l’homme face à la société et la société face à l’univers.
« Comment cela s'appelle-t-il, quand le jour se lève comme aujourd'hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, mais que les coupables agonisent, dans un coin du jour qui se lève ?
- Demande au mendiant. Il le sait ».
- Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s'appelle l'Aurore ».
Jean Giraudoux, Electre
Sur les routes d’Europe
Quel est le sens d’une culture qui s’oppose à la nature ? Quelle est l’essence d’une liberté qui oppresse les désirs des hommes ? Qu’est-ce qu’une économie qui broie l’individu ? Les errants d’Europe interrogent le fond des droits que nous prônons, des devoirs que nous exigeons. Une Europe suradministrée, surcontrôlée, où les droits théoriques se traduisent par des procédures administratives, ne peut être un rêve – ne peut être un phare. A l’aurore de notre avenir commun, ne choisissons pas une survie matérielle réglée pour les obéissants, tandis que les autres sont relégués aux mondes d’outre-société.
Que le visionnaire et le pragmatique triomphent de l’idéaliste, du fataliste et du procédurier. Le rêve européen ne doit pas être administratif et gestionnaire. Il doit avoir aussi ses routes libres…
Edith de Cornulier-Lucinière, Les Sables d’Olonne, Juillet 2006
Publié dans La place, Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |















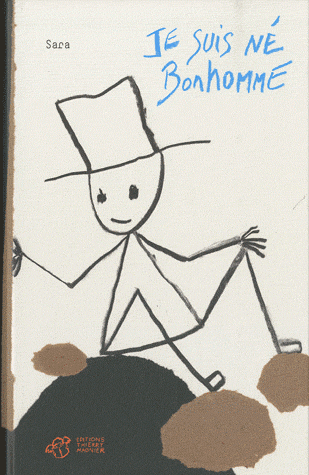






 Gange, par Sara
Gange, par Sara