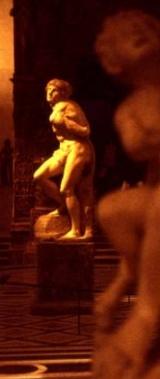vendredi, 10 mai 2013
Mur

«Se plaindre est une honte et soupirer un crime».
Pierre Corneille
(In Horace)
Je ne vous avais pas demandé de me tirer du néant, je ne vous avais rien demandé puisque je n'étais pas. Mais vous pensiez sans doute avoir le droit de poursuivre vos errances et vos malheurs à travers d'autres que vous. Me voilà donc, en apparence assez réussie, dans le fond complètement ratée, sujet de droits et de devoirs qui me dépassent. Il suffit de jeter un regard sur l'horreur du monde pour me mettre à genoux et me répandre en actions de grâces pour toutes les chances qui pleuvent sur ma vie. Mais aujourd'hui je ne le ferai pas : je serai plus franche. Je dirai que le monde dans lequel, par ennui, par dépit ou par inconscience, vous m'avez invitée, ne me plait pas. Je ne m'y sens pas mieux que vous, et force est de constater que je m'y débrouille moins bien. Le Christ cloué à la croix des points cardinaux m'a peut-être sauvée, la vie n'en est pas moins une crucifixion dont je suis presque sûre, en dépit de certains efforts que j'ai pu faire, de tirer plus de damnation que de salut. La fête païenne m'attire, mais je n'ai pas assez de force dans les bras et dans mon coeur pour y tenir un rôle digne plus de quelques quarts d'heure. Bien vite il me faut rentrer me cacher pour panser les plaies béantes. Chaque jour apporte son cortège de mauvaises nouvelles, tortures d'enfants et d'animaux, destruction de la nature sauvage et des trésors de la culture. La course aux places est longue, ardue, il y a beaucoup de coureurs acharnés et peu de vrais gagnants. La vie simple et tranquille nécessite des capacités d'adaptation dont je n'ai pas encore fait preuve, en dépit de fréquentes tentatives. J'ai même trouvé trop dur de posséder et de conduire une voiture. L'amitié est belle, mais intermittente ; les amis sont tout aussi blessés que moi et qui sait quelle rencontre apportera une caresse ou un coup de poignard ? La famille est l'unique source du mal et la seule source de réconfort : paradoxe quelque peu lassant à vivre. Les chants des oiseaux, peut-être, bercent nos pleurs et sèchent nos chagrins de l'aurore. Mais bientôt, le bruit machinal des autoroutes les recouvre. Il faut donner sa vie, ne rien chercher pour soi, soit. J'essaie de temps en temps. J'essaie encore de temps en temps de partir sur cette belle route de rêve qu'on nous décrit dans les films, dans les chansons et dans les livres qui se vendent à des millions d'exemplaires : le mauvais conducteur se retrouve assez vite dans le fossé. Je vais sortir dans la rue tout à l'heure, et chaque présence étrangère, corps allongé à même le sol, infirme, travailleur fatigué ou lobotomisé, homme battu, femme trompée, coeur solitaire, chien volé, me criera à la figure toute l'abondance de joie, de paix et d'amour qui m'assaille. Ce qui achèvera de me miner le moral.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (6) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 08 mai 2013
Mélancolie

Instance au milieu d'une journée, quand le vent chasse les rayons pâles du soleil. Une fenêtre dans un quartier où les déménagements se succèdent. Un immeuble à moitié vide, dans lequel Dylan, âgé de sept ans et demi, joue du piano sans que personne l'écoute. Sa composition étonne un peu le chat qui crâne sur le radiateur.
Aux étages identiques, des silhouettes restent immobiles. Chacun espère une autre vie, ou une autre lumière sur celle-ci ; mais le temps présent se fait pesant pour les déçus des grandes rêveries. Ainsi s'accumulent mille souvenirs, mille images sans couleurs vives, dans les mémoires mortelles des solitudes qui passent ici.
On se croise quelque fois, on se croit les uns les autres et des enfants naissent à la veille d'une rupture mitigée. C'est la vie des temps modernes qui berce nos âmes mortes-nées. Dans la pièce où le linge sèche, au piano désaccordé, l'enfant joue sans public sa chanson désenchantée.
Edith de CL
Publié dans L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 07 mai 2013
à contre-réel
Publié dans Chronos, Clair-obscur, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 06 mai 2013
Oracle
Il pleut des cordes dans la cour arrière, dans la cour « pot bouille » et sur le jardin. L'averse inonde le boulevard. Grande eau pour un lavage de printemps dont ne restera nulle trace de scorie.
Je prends le pouvoir. D'où que je vienne, c'est moi qui décide qui je suis et où je vais. Vous n'avez plus aucune prise sur ma vie, je suis dorénavant maîtresse de mon destin et n'abdiquerai jamais.
Je n'ai plus besoin de sauf-conduits, de passe-droits, de protecteurs : ma volonté suffit. Je n'ai plus besoin de remèdes, d'aides, de soignants : je m'offre la santé.
Il faudra s'habituer à mes nouveaux atours : autorité, puissance, gloire. Il faudra s'habituer au nouveau timbre de ma voix : le timbre du sceptre qui se dresse sur le monde.
Mon royaume ? L'empire autarchique. Mon trésor ? La perpétuelle abondance. Mon pouvoir ? La création.
Entre mes mains palpite le monde que je suis venue vous offrir. Que je souffle sur ces graines frêles et le miracle surgira.
Édith
Biographie officielle (merci à katharina)
Inspiration :
Sit tibi copia,
sit sapientia,
formaque detur ;
Inquinat omnia
sola superbia,
si comitetur.
Publié dans Chronos, Clair-obscur, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (5) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 05 mai 2013
Lignes de fuite
à Hanno, fraternellement, en souvenir de l'invécu
I Frontière
Nous allons faire la fête. Prenez ces verres qui se tordent de n'être pas bus au bord des tables penchées sur l'herbe. Laissez là vos manteaux et vos cravates, nous n'en aurons plus besoin de l'autre côté de la rivière, sur la butte où les pas ne laissent pas de trace.
Pluie et rayons du soleil dansent dans l'après-midi du parc et les vins tournés dégoulinent sur les nappes de papier.
Jazz, jazz, tu n'es pas mort, tu coules commercialement des hauts-parleurs et tu emportes le petit groupe vers son errance. Déni des livrets A et des clés de voiture, oubli de tout ce qui nous distingue en ville.
Avançons sur les chemins à moitié balisés sans écraser les fleurs printanières écloses hier.
Vous retournerez sur vos pas peut-être, ce soir ou demain quand nous en aurons fini avec la fête émerveillée. Moi, je crois que je ne reviendrai pas. Je chercherai plus loin sur la rive une maison sous un ciel qui promet la vue des étoiles chaque soir de la vie.
Car désormais, chaque soir je veux voir, dans un ciel d'un noir pur, scintiller des étoiles.
II Vertige
Là-bas, caresses fondantes, délices au fond des baisers qui se fondent en ondulations nuageuses vers les sphères éreintées des étreintes trop puissantes. Ici, à genoux sur les prie-dieu, chapelets monocordes jusqu'au Salut par l'Esprit qui souffle où il veut.
Ne jugez pas, car toute voie qui peut être tracée n'est pas la voie. Si vous riez de ci ou de ça, vous êtes cuit.
III Infusion
Une vie qui serait un long dimanche après-midi ; le soleil coulerait en lampée de miel sur la partie sud des maisons. Les arbres frissonneraient au léger vent de l'Ouest. Et les vieilles chansons de la forêt, chantées là-bas par des dames vieilles, berceraient nos langueurs. Une guitare ? Peut-être. Mais surtout, la douceur vagabonde de l'oubli.
Edith
Publié dans Chronos, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
Un dimanche à Avila
Je pense, pour répondre à ta question d'hier, que si j'avais un fils je l'appellerais Judicaël ou Dieudonné, et une fille, Anne.
Je n'ai plus d'inquiétude sur la question d'avoir ou non un enfant... âgée de trente ans, je suis allée dans l'église Saint-Thomas d'Aquin, et j'ai "demandé" d'avoir un enfant à 32 ans. J'ai renouvelé solennellement cette demande intérieure auprès du cercueil de mon grand-père.
Le jour de mes 33 ans, alors que rien ne s'était passé, j'ai éprouvé un cuisant dépit. Je m'en suis voulue d'avoir été si crédule, si ridicule. Dans cette déréliction, soudain, m'est apparue comme gravée sur une pierre imaginaire la phrase de Sainte Thérèse d'Avila :
« Il y a plus de larmes versées sur les prières exaucées que sur celles qui ne le sont pas ».
(C'est cette phrase qui a inspiré le titre du roman de Truman Capote Answered Prayers).
Je suis donc retournée à Saint Thomas d'Aquin pour exprimer ma gratitude et ma confiance que ma prière était exaucée au mieux quoi qu'il arrive. Depuis, j'ai un poids en moins, une confiance absolue que le mieux m'arrive, m'est arrivé, m'arrivera sur le plan de la maternité.
Il faudrait que je parvienne à atteindre une telle sérénité sur d'autres sujets, tel la vie financière... Mais on ne décide peut-être pas consciemment des prières profondes que l'on lance, des réponses non moins profondes qui nous arrivent.
Du rêve ou du réel, va dire lequel féconde l'autre... Sans leurs noces mystiques rien n'a de valeur en ce monde.
Publié dans Chronos, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 04 mai 2013
La route
La nuit
La nuit, l'enfance s'efface complètement. Les diables sortent par la porte de derrière ; les fées se drapent de tulle rouge et les rangées de serviteurs proposent des verres de champagnes à nos mains tremblantes.
Tu t'appelles je ne sais pas encore comment. Tes lèvres frissonnent de peur, de tendresse ou de froid, peut-être, bien qu'il fasse chaud au creux du bar du Temps. Demain j'ai 35 ans mon amour, accompagne-moi sur cette pente raide où tant d'amis ont dégringolé pour ne plus jamais remonter à la surface verte des jeunesses.
L'aube
L'aube, l'oubli des veilles nous guette. Ton bras suspendu sur le vide s'arrête. Le long des jambes, sur la surface des ventres, se balance l'espoir frêle qu'un jour, dans mille jours, nos mains presseront la même cafetière avant le chant du coq.
Aube nouvelle dans notre vie où se chante la liturgie des ouragans. Vatican III, danse avec moi !
L'après-midi
Route des vacances, j'ai fait toutes tes stations d'essence, tellement plus tard, bien après l'époque des petits Lu. J'y ai retrouvé pourtant les sensations d'une épopée de mon enfance, ressurgie ainsi au croisement des quatre voies contradictoires. Mais est-ce vraiment le temps de songer à ces nécropoles perdues, est-ce vraiment le lieu d'évoquer ce chemin en sens inverse ?
Le soir
Quand tout l'amour, tout l'argent, toute la gloire nous entourent, qu'est-ce qui nous pousse à partir en haillons par un soir de décembre et descendre l'escalier de la ville qui mène au banc des clochards ?
L'appel du vide, l'appel de Dieu, l'appel du Diable.
photos Mavra NN - vidéos chouravées poliment sur le web.
(La nuit d'Henri Tachan
Le Grand Meaulnes, de Jean-Gabriel Albicocco
Robert Desnos par Frédéric Hunter)
Publié dans L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 02 mai 2013
Rage
à Sébastien Ithiopia...
C'est le ressac infini de mes rages que vous entendez dans le soir tombant. Les bruits de la cuisine et ceux de la terrasse ne peuvent étouffer les vagues noires de l'amertume. L'alcool qui coule en rivières dans vos verres, le train là-bas qui revient et nous rapporte les deux de province, la musique qu'Elle vient de mettre sur la chaîne hifi performante et l'horloge qui chahute qu'il est 21h15 ne nous trompent pas. Plus rien ne dissimule le flot sombre, cracheur de rage.
(Quelqu'un s'enfuit pour écrire sur l'ordinateur du garage).
C'est le retour infini de mes saccages que je maudis en veillant les fourneaux. Les paroles des voisins et les rires des enfants n'atteignent plus mon être au centre glacé comme un fjord. Vos bons mots, vos maux mal cachés, les noix et les chips qui circulent à travers les mains lavées pour le soir, la chanson qui invoque la mémoire des noyés ne nous apaisent pas. Vous savez que je suis partie trop loin pour être sage.
(Cet imbécile qui vient souvent tente d'embrasser la mystérieuse près du buffet).
C'est le reflux infini du remord qui me ronge quand je me tourne vers vous. Mon sourire rouge artificiel ne piège plus vos croyances erronées. Nul ne brise la convenance morte. Seul, cet homme tendre à la joyeuse tristesse ment à tire larigot, et personne ne songe à le contredire. Il est des appartements où le mensonge a tous ses droits. Il est des terrasses que seule la joie criarde maquille encore. Il est des amas de naufragés déguisés en assemblée conviviale. Il est des ruines de rêve, ce soir, qui baignent la pièce et le jardin de leur odeur cendrée.
(- C'est Arnaud, là-bas ?
- Il arrose les fleurs avant la nuit complète.)
Mon Dieu, ma Rage, pourquoi inondez-vous ainsi ma vie ? Vos vagues bientôt nous recouvriront tous. J'irai m’enfuir aux antipodes de la fête, recroquevillée sur la chaise de la salle de bains, face à la lune éclatante qui fait du naturisme de l'autre côté de la fenêtre.
(Nous n'avons pas encore repeint les persiennes du mur condamné).
Quand reviendras-tu, mon mage ? Ta main de chaleur, ton épaule de douceur, ta voix de basse qui me prenait, me portait, m'emportait, vers le lit de mes souvenirs. Sans toi mes fêtes sont si vides, mes amis si flous, mes membres si froids, sans toi rien ne tient vraiment debout.
(Qui vient de changer la musique ?)
Mais te voici, rhum. Te voilà, punch. Exilé de Marie-Galante, tu irrigues mes veines mieux que mon sang. Tu institues en moi le règne du Sourire Parfait. Tu m'habites, tu m'habilles et mes joues rosissent, le rouge à lèvres tombe, obsolète ; je me tourne vers autrui, je tends les mains, je lève les bras, je chante avec eux. L'océan se calme, les dernières vagues meurent dans tes gouttes ambrées. La rage évanouie, je peux commencer à danser.
Edith
Publié dans L'oiseau, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
Zestes de jeunesse (Qui sont les charmeurs de serpents ?)

Je ne comprends pas pourquoi c'est impossible de se noyer dans l'azur, de se dissoudre dans un ciel bleu et pur.
Ne ressemblons-nous pas parfois à des serpents envoûtés qui se tordent dans un panier en rêvant de fuir ! fuir ! fuir !
Qu'est-ce qui nous retient ? Le corps ? Des liens ? Qu'est-ce qui nous retient ?
Tout au bout des insomnies, qui sait si on finit par trouver la méthode du souffle psychédélique...

Publié dans Chronos, L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 01 mai 2013
Te revoilà, Tieri !

Mon cher Tieri,
Ta zone m'ozone.
C'est un vrai soulagement de retrouver ta prose fracassante, j'avais passé tant de temps à hanter Où sont les enfants ? et Histoires d'une passion. Ta webdisparition me désolait. Heureusement qu'il y a eu votre visite et ce dîner au coin d'un feu après Effraction, alors qu'Orso barbotait encore dans le ventre de Noémie. Heureusement qu'il y a eu cette nuit de feu où je me sentais si proche d'Arles en arpentant Insomniapolis. Heureusement qu'il y a eu quelques lettres et ma visite à l'ourson.
Dosta le silence !
Si petite zone, si vaste déchirure qui tire vers la délivrance. Frasques, poèmes, murs et cris gravés. Fresque d'une dissidence multiforme. Flip photolittéraire. Incendie orange, cendres martiennes, braises de l'enfer, ça recommence ? Ah ah ah ! Sombre frère en littérature ! Joie d'une retrouvaille, en attendant un passage parisien de votre petite caravane.
Edith de CL qui t'embrasse
Tieri sur AlmaSoror :
| Lien permanent | Commentaires (3) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
Mascara

«Ils ont découvert l'enfant en suivant les traces de l'ogre».
Raoul Vaneigem

Paul, est-ce toi qui m'a appris à porter un masque ? J'ai mille masques, qui ne sont qu'un seul masque. Ce masque avec lequel je dis des choses drôles dans des dîners en ville, ce masque avec lequel je courais dans les manifs noires et rouges à la Bastille, ce masque que je portais pour oser pénétrer dans le local des Apaches.
C'est avec ce masque que j'entrerai dans la grande salle pour siéger majestueuse parmi mes pairs ; c'est avec ce masque que j'abattrai les barrières entre deux corps transis de se mêler.
Paul, je t'ai démasqué.
Anne, est-ce toi qui m'as appris à donner mes trésors aux enfants étrangers, à cacher mes butins sous la terre du côté de l'étang, à pleurer sur la plage des Sables un premier mai, à sauter par la fenêtre en croyant qu'un filet va surgir pour me sauver ?
Anne, je t'ai surpassée.
Mascara, masacarade. Vous étiez si étranges, tout le monde le dit. L'ange blond et la brune triste perdus dans ce monde pour lequel vous n'aviez pas été dressés. Frères et soeurs morts en bandoulière contre vos coeurs, rage de passer à l'épée le décor de vos enfances détraquées.
Satan et Chiquita, que reste-t-il de votre cavale ?
Une saltimbanque, une européenne, un mousquetaire : trois adultes qui se souviennent à peine. Des photos déchirées dans un jour de colère. Des vinyles et des bouquins.

Publié dans L'oiseau, Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (5) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 30 avril 2013
Sables d'Eau lonesome cowboy
Je te parlerai donc des Sables d'Olonne, une ville banale, dont la lumière est étrange, blanche, poussiéreuse, enivrante, où les serments intérieurs se prononcent au banc secret de Cayola.

C'est la ville de la joie et de la douleur pour une fratrie que je connais et qui célébra, en l'église de Notre-Dame de Bon Port, la messe de requiem d'un frère de quatorze ans emporté par une leucémie, celle d'une sœur de dix-neuf ans trouvée pendue à un arbre.
C'est la ville où j'ai couru sur le remblai qui semblait immense à quatre, cinq, six ans. Vingt ans plus tard, quand j'y suis retournée, tout m'a paru si petit. J'ai compris alors à quel point les regards d'enfants sont généreux.

C'est la ville où j'ai décidé de m'exiler, quand partout où je me tournais le paradoxe me faisait face, tirant sa langue cruelle.
J'y suis partie en quête de moi-même, et je ne m'y suis pas trouvée. Je dois être (si j'existe vraiment) bien cachée. J'y ai rencontré en revanche le silence et la solitude, et je les ai apprivoisés. Désormais, ils ne me font plus peur. Ils peuvent venir s'asseoir à côté de moi, m'entourer de leurs bras, étendre leurs ailes sur mon périmètre et même pénétrer comme le vent à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, de mon âme : ils ne me dérangent plus.

Comme toute la côte vendéenne, qui était si belle antan, la ville des Sables d'Olonne achève de troquer ses murets de pierre contre des parapets de béton, ses dunes et ses landes contre des immeubles qui rivalisent de laideur, ses jolis casinos qui ressemblaient à des chalets contre des CENTRE DE CONGRES sans accent grave, dans la lumière nocturne desquels, parfois, depuis la piscine d'en face, on croit apercevoir un congre exilé qui nage, désolé, à travers les colonnes plastifiées de son palais triste.
Mais la piscine fume esthétiquement sa chaleur artificielle, figée au pied d'un bar entre la plage et la promenade, appréciant les nageurs courageux qui la parcourent et les buveurs langoureux qui la contemplent. Elle a de la chance, car aucun toit ne la sépare de la lune.

Les jours d'été, tous ces bateaux blancs et ces jolis noms de rue ont émerveillé des générations de « congés payés », comme les Sablais les appelaient.
Mais les soirs d'hiver, la ville s'éteint tôt. Le vent souffle. Les bateaux n'osent plus rentrer par le chenal traitre. Au fond du studio, allongée sur son lit dans le noir, une rêveuse en apnée envoie des textos mystérieux en écoutant les hurlements des mouettes.

Publié dans La place, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 28 avril 2013
Lorenzo

J'avais peur, très peur en montant l'escalier de la rue du Bouloi.
J'avais traversé la ville, apparemment en sweatshirt, jean et basket ; en réalité enveloppée d'un long manteau de peur, dans une matière noire comme la mort, aux boutons rouges sang qui oppressaient ma poitrine, aux vastes pans qui enserraient mes jambes, interrogeant sans cesse ma mère qui se lassait de répondre à mes questions et m'intimait l'ordre, l'ordre étrange et impossible, de l'embrasser comme si de rien n'était.
À ma droite, ma petite sœur et ses longs cheveux blonds, son sourire désolé d'avoir quitté ses poupées, sa joie devant les scènes de rue du dimanche. Qui pouvait savoir qu'elle filerait un jour dans le Thalys, vers la Bruxelles européenne, un téléphone de femme d'affaire entre les mains ? Entre nous deux, le gros bébé aux boucles craquantes, aux joues rebondies entourant une grosse tétine que suçait sa bouche angélique, ne laissait pas deviner le lionceau facétieux qui couvait, encore moins le jeune lion impérieux et incontrôlable qui hanterait les nuits parisiennes de ses coups fourrés quelques années plus tard.
- Mais si ça se voit sur son visage ?
- Embrasse-le comme si de rien n'était.
Comme si de rien n'était. Je ne me souviens plus de l'étage auquel se trouvait l'appartement, combien de marches j'ai gravi. Mon cœur et mon pas ne faisaient qu'un. En haut, m'attendait un homme condamné à mort qui partait pour toujours.
Dans l'appartement où je suis née, et dont mon père était parti depuis déjà longtemps, je les entendais prononcer le mot effrayant, tous les amis de ma mère.
Cousins de l'Ouest, pleurant un suicide fraternel, une maison d'ancêtres vendue, cousins sous-diplômés traînant leurs noms à rallonge, leurs douceur malheureuse dans les rues du centre de Paris, les poches trop vides, des poches aux yeux.
Amis issus d'un monde ouvrier montés un peu dans l’implacable hiérarchie sociale ; trop peu habitués au ski à Mégève et aux brunchs de la rue Montorgueil, il préféraient venir frotter leurs tailleurs et costards trop récemment coupés aux vieux meubles en ruines du 13 boulevard du M., que de tenir la dragée haute chez les fringants bourgeois.
Fringants bourgeois aussi venaient jusqu'à nous, charmants, heureux, loufoques pendant les fêtes et sages au travail, trop beaux pour être honnêtes, trop honnêtes pour être beaux, trop sensibles pour être bourgeois, trop bourgeois pour dérailler, sympathiques par dessus tout et chaleureux à leurs heures, capables de vannes impitoyables et de rires merveilleux, mais toujours rattrapés par les exigences sociales au moment de franchir le Rubicon.
Cousins déchus, amis timides, idoles fringantes, toute cette faune passant et repassant à la maison, faisant des efforts pour ne pas succomber à cette panique d'avant les campagnes de sensibilisation.
J'avais entendu des gens en parler à l'école ; le journal Okapi que lisaient de jeunes voisins de mon âge, avait publié dans son courrier des lecteurs quelques lettres désespérés d'enfants hémophiles et « atteints », renvoyés de l'école ou interdits de s'asseoir à côté des autres enfants. La France d'avant les campagnes de sensibilisation se montrait parfois – souvent - sous ce jour cruel.
Le Sida, donc.
Le mystère de l'homme très brun se dévoilait. Celui qui demandait, candide, à ma mère intriguée : « Mais pourquoi, vous, femmes perdez-vous toute personnalité dès lors que vous vivez avec un homme ? » ; l'ami de l'oncle pas marié ; le peintre basané qui ne nous traitait jamais comme des enfants, mais comme de jeunes chats qu'on laisse passer entre les meubles et qu'on caresse de temps en temps. Le secret de celui dont nous mesurions l'étrange étrangeté nous était révélé. Il était homosexuel. Il avait le sida. Il retournerait mourir en Colombie.
Et nous allions le voir pour la dernière fois.
- Et si on voit vraiment qu'il est malade ?
- Embrasse-le comme si de rien n'était.
- Mais qu'est-ce qu'il va dire ?
- Il ne dira rien.
Les deux petits se disputèrent pour frapper à la porte en haut de l'escalier.
L'oncle ouvrit. Nous entrâmes.
Terne et morne à force d'être concentrée, j'embrassai quelques personnes oubliées depuis – dont une femme aux longs cheveux bouclés qui portait un bracelet afghan - et me plantai devant Lorenzo.
Il était archangélique et comme avant, il flottait dans de larges pantalons de soie beiges, bruns, tachetés de rouge carmin. Sa voix douce, dans laquelle flottait l'accent du castillan de Colombie, me salua et son regard plongea dans le mien.
- Il sait que je sais, pensai-je, les yeux plantés dans ses yeux, fixement.
En tendant mes joues et mes lèvres, j'embrassai à la fois la beauté et la mort.
Fière de ma victoire, je me tournai vers ma mère qui ne me regardait plus. Elle avait confiance en moi. Quelques minutes plus tard, dans une zone indistincte entre la cuisine et la salle à manger, je chuchotais à l'oreille de la dame au bracelet que j'avais déjà vue et dont je ne sais plus le nom : « Je l'ai embrassé comme si de rien n'était !» Elle me sourit et me pressa l'épaule.
Au moment de passer à table, Lorenzo s'asseyait là-bas, à côté du mur. Je fus prise d'un vertige. Je me précipitai pour me mettre à côté de lui avant qu'un autre prenne la place.
Je vérifiai s'il n'était pas agacé par mon audace. Ce vague sourire lointain et ses yeux d'étranger, il les inclina vers moi.
Le Christ a vaincu le monde et ceux qui ont touché sa plaie n'ont-ils pas leur part de gloire mystique ? Lorenzo le mourant planait au-dessus du monde et je siégeais à sa droite. Il me passait les plats et je frôlais sa main. Aucune parole ne fut échangée entre nous durant ce repas, juste des plats, des regards et des sourires.
Les adultes parlèrent longtemps après le déjeuner. Nous, les trois enfants, nous sombrions dans l'ennui. Je ne me souviens plus de l'au-revoir, du départ.
Il repartit dans son pays des Andes sauvages et des bidonvilles baignés de soleil, et ne revint jamais.
On nous appris sa mort lointaine, sa mort exotique, une mort impalpable. Il était devenu aveugle, un film avait été tourné sur sa vie.
Depuis ma mère et l'oncle ont cessé de se voir. Mais j'ai remonté l'escalier de la rue du Bouloi.
En entrant dans la chambre d'hôpital où l'amie (ne) pleurait (pas) son pied happé par un train, je savais que je montais l'escalier de la rue du Bouloi, et mon cœur et mon pas ne faisaient qu'un. En passant la frontière bolivienne, le dossier judiciaire d'un chef du Sentier lumineux de la région de Cuzco sous le bras, que parcoururent d'yeux soupçonneux des douaniers manifestement analphabètes, quand l'image des prisons boliviennes m'apparut à l'esprit et que je compris la folie que j'avais entreprise, je montais à nouveau l'escalier de la rue du Bouloi. À mes côtés, une compagne de voyage innocente babillait sur les produits détaxés sans savoir...
Aux côtés de C. agonisante, reconnaissant dans ses râles et au creux de ses yeux les signes de l'agonie finale que j'avais lus le matin même sur wikipédia, je tenais sa main déjà froide et je voyais l'escalier de la rue du Bouloi.
À d'autres moments encore, j'ai monté cet escalier et mon cœur et mon pas ne faisaient qu'un.
Quand j'ai rencontré sur ma route la beauté stupéfiante du monde, la profondeur abyssale de la solitude, la terreur panique de l'amour ou l'angoisse captivante de la mort, j'ai senti que ma main frôlait Lorenzo. La mort comme l'amour est un baiser. Comme la mort, l'amour est un brasier. Nous les attendons comme des enfants avides et nous les fuyons comme la peste.
La splendeur de la mort m'a été offerte par Lorenzo ; depuis, j'ai entrevu d'autres beautés vénéneuses. Il est des escaliers en haut desquels m'attendaient des initiations et que je n'ai pas gravis. Il est des caresses que j'ai fuies, de peur qu'elles laissent mon corps en ruines. Toutes les morts m'attendent, de l'autre côté desquelles les renaissances font si peur. Toutes les morts m'attendent encore.
28.4.13, Edith
Quelques requiems d'AlmaSoror :
Maryvonne, fille de la Révolution
Amour d'un homme pour son petit garçon
Ma rencontre avec Anne-Pierre Lallande, chrétien, anarchiste, antispéciste
Les yeux, les tombeaux, l'esclave
Publié dans L'oiseau, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 27 avril 2013
Nimbée de rhum
T'ai-je jamais aimé ? Tu m'intriguais. Tu passais, de loin, sur l'espace vide des lieux communs. Ton visage s'affinait sous mon regard nimbé de rhum et tu chantais. Je n'entendais ni l'air, ni les mots ; je fredonnais pour t'imiter, pour que tu tendes ton sourire vers moi. Mes mains te cherchaient dans le vide.
Et le temps a passé. Des immeubles furent érigés au lieu de nos promenades. La fontaine a été emportée par les employés municipaux. L'image que j'ai gardée de toi flotte comme un rêve autour de moi, dans les après-midi de printemps, quand les rues de la ville, peuplée d'une foule bigarrée et joyeuse, me voient marcher seule. À travers les chagrins du passé et les traces du présent, je déambule en me remémorant ta démarche, mon admiration, nos rencontres insatisfaites.
M'as-tu jamais remarquée ? Tu m'intriguais. Je restais, au loin, sous la ligne bleue des Vosges imaginaires. J'apprenais à aimer la chimère qu'on n'étreint pas ; j'édifiais mon amour avec des lettres de transparence. Peut-être qu'au fond je saisissais que dans cette inconscience du temps perdu, je vivais mes meilleurs moments.
Et le temps a recouvert cette histoire qui n'a pas été vécue. Je me demande quelquefois si j'ai vécu. Alors j'évoque ton visage et mon cœur bat encore.
Edith de C-Lucinière, 21 avril 2013, vers 19h50
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 25 avril 2013
Au confessionnal du cœur

C’est en marchant dans les rues de la vieille ville laidement modernisée que soudain la fumée immense est apparue. J’ai cru asphyxier ; une bâtisse magnifique s’est élevée devant moi. Et je l’ai reconnue : la plus vieille abbaye de France, que les Révolutionnaires avaient saccagée, dans la joie et la fureur, détruisant au nom de la liberté et de la raison un des plus vieux trésors qui appartenaient au peuple. La voilà qui se reformait devant moi, l’abbaye, et les vitraux, et les pierres millénaires se régénéraient et se recréaient et, subjuguée par le miracle, j’entrai.
Les murs ouvragés en marbre et en métal sont l’œuvre des anciens Compagnons du Tour de France. La musique qui s’élève ? Non, ce n’est pas de l’harmonium. Peut-être est-ce un vieil orgue, accompagné d’une viole de gambe. Un clavecin essaie de suivre. L’orgue et le clavecin sont jumeaux, frères miroirs des deux sœurs humaines, la solitude et la liberté. Les frères chantent les sœurs, les sœurs dansent avant de disparaître aux yeux humains qui hantent les lieux. Moines de l’an mille apparaissent et s’effacent à mon passage. Leurs yeux sont creux. Ils sont trop morts. Pourquoi suis-je ici ? J’avance et mes pas résonnent, sourds et lourds, dans la nef. Je suis dans cet antre magnifique, remis debout par un miracle de l’abbé Hugues : je suis à la vieille abbaye de Cluny ! Les ruines se sont relevées, c’est la régénération de la chair architecturale – et les clameurs qui détruisirent rageusement la vieille bâtisse se sont tues. Leur écho est terrassé. Il ne reste plus que le silence humain, la musique divine et les pas des chercheurs de vérité.
Il faut traverser tant de lieux à l’intérieur de ce lieu ! Jardins et potagers, couloirs extérieurs et arcades, comme Cluny est grand ! J’entre enfin dans l’église. La voûte m’accable. L’air est lourd. Une vérité est proche.
Je m’avance, et la lumière qui se balance, projetée sans doute par un ange, éclaire les dalles que je dois fouler. Je le pressens : je suis ici pour quelque chose. Mon cœur bat d’un autre rythme que le rythme vital : c’est le rythme du Purgatoire. J’arrive au Confessionnal du Cœur.
Des portiers sont postés sous les colonnes qui mènent au confessionnal : au nombre de quatre, ils ont pour noms Charles Baudelaire et Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval et Thomas De Quincey. Leurs toges dissimulent leurs pieds. Le premier, au visage raide et intelligent, porte une fleur. Un rictus saille son visage au moment où je passe devant lui. Le second, blessé par la splendeur d’un jour de malheur, arbore un visage triste ; on dirait qu’il ne me remarque pas ; pourtant il montre le troisième du doigt. Celui-ci soutient dans sa main une image de la Vierge, qui lui sourit avec bonté. Je marche devant eux et peux apercevoir la fixité des deux regards, celui de Nerval et celui de la Vierge. J’arrive devant la silhouette de Thomas De Quincey, coiffé d’une toque, et qui tient un flacon. Je passe mon chemin. La lumière éclaire une porte qui s’entrouvre et grince. Je sais que je dois passer. Derrière, une nouvelle petite porte s’ouvrira sur le confessionnal.
J’avance, et j’ai peur. Une dame est là. Alix, la fille d’un roi. Elle est abbesse. Elle sourit sans vigueur. Sa main gauche tient une clef. Ce que cette clef représente, je l’ignore. Mais un frisson me parcourt entièrement en contemplant l’objet de fer doré. Est-ce la clef du cœur ? Il faut entrer, passer la petite porte. J’ai mal, mais j’avance. Et je m’agenouille face à la grille enveloppée de pénombre, et une odeur d’encens se diffuse alentour. Des pas se font entendre, s’approchent ; l’autre partie de confessionnal est habitée, ça y est. La grille qui se soulève n’éclaire pas nos visages. J’ignore qui se trouve si près de moi.
- J’ai vu l’église se recréer comme par miracle. Je suis entrée. Je ne sais pas me confesser.
- Je vais vous laisser seule avec deux hommes qui vous cherchent.
- …
Incapable de répondre, je suis assaillie par la peur. Les pas du confesseur s’éloignent. Du silence noir où je me trouve, je perçois que la musique se remet à agir, tout là bas, au fond.
Du bruit : la porte du confessionnal s’ouvre brutalement. Je me relève en sursaut. Devant moi, deux hommes se dressent. Du creux de mon ventre les fontaines s’enclenchent et les éclusent se lèvent, un bourdonnement se met en route. Les canalisations s’ouvrent et débordent entre mon cerveau et mon ventre, même mes vertèbres sont ébranlées. Un instant, j’oublie où je suis et je vois l’horreur de l’intérieur : la digestion des derniers repas recommence et s’emballe : plus rien ne tient nulle part. Mon sang veut sortir des veines et tout se broie ; des saccades, des cascades se créent aux articulations. La lymphe devient nymphe et attire les résidus. Un bourgeonnement fait revivre les vieilles infections ; l’oreille droite pullule ; les conduits débordent ; une voix préhistorique croasse « je t’aime », « je t’aime », « je t’aime », c’est la bête intérieure ! qui aime qui ? Le crapaud est noir et gluant et prend tout mon corps. Les grenouilles le mangent ; il reste. Des serpents ondulent et sifflent sur les artères. Et la machine s’arrête, mon regard est éjecté, projeté à l’extérieur. Rien n’a changé. Les deux hommes se dressent. C’est alors que mon cerveau vogue à la folie et c’est mon ventre animal qui parle, qui voit, qui analyse et qui sait tout avec sa langue sans mots. Il scrute les deux hommes.
Leurs visages parlent d’eux-mêmes.
L’un est ma mauvaise conscience. L’autre est mon orgueil. J’ai peur d’un viol.
Ils attendent. Ils se taisent. Leurs regards semblent me dire : lève toi.
J’attends longtemps. Rien ne bouge. L’encens se répand toujours, et du fond de l’église me vient la belle musique des anges. Le clavecin et l’orgue jouant en cœur, la viole chantonnant sur leurs gammes étranges. Et au milieu de leur musique des voix de nulle part s’élèvent, comme pour m’encourager. Alors je me lève.
Et nous voilà trois, eux, grands, forts, raides, face à moi. Je fais un pas et j’attends. Là bas, la musique, c’est clair, sait que je me suis levée. Elle suit tous mes gestes. Elle suit toutes mes peurs. Elle m’entraîne dans des zones d’où je ne reviendrai pas. Elle est irrésistible.
- Je n’ai tué personne, murmuré-je.
Un sourd murmure traverse les murs de pierres de l’église.
»Elle soutient qu’elle n’a tué personne ». Des ricanements s’élèvent. Sont-ce des assassinés qui rient ainsi ? Quel mystère affreux ! Pourquoi mon cerveau ne revient-il pas ?
- Ne les écoute pas, murmure l’homme qui se tient à gauche, en armure, en face de moi. Et je sais : il est ma mauvaise conscience.
- Nous t’avons déjà jugée, dit l’autre homme, d’une étonnante voix de ténor.
Et je devine ; je comprends. Il est mon orgueil.
- Alors pourquoi venir me parler ? Pourquoi ne pas me tuer immédiatement ?
Ma voix est faible, presque éteinte. J’ai tant vécu dans ce monde là bas ! J’ai tant vécu de scènes et de tracas, au milieu des papiers administratifs et des relations sociales, des repas et des rues, des trains et des voyages, des ennuis des travaux et des jours, pour être jugée, torturée, condamnée par deux hommes aux allures de titans ?
Ils ne répondent pas. Ils sourient. Ils sont tellement forts qu’ils me narguent. Je les hais. Je les admire. J’aimerais qu’ils me protègent ; je sais qu’ils me tueront.
- Allez-y, murmuré-je.
Et des larmes coulent le long de mes joues. Tout était si insignifiant, là-bas, sur la terre humaine. Les mots, les voix, les gestes, les échanges, les longs après-midi qui passent, les objets qu’on achète et ceux qu’on met à la poubelle.
Les larmes coulent pour tout ce que je n’ai pas vécu. Les larmes dévalent pour tout ce que j’ai fait et dit. Je regrette presque tout. J’aurais dû faire tout ce que je n’ai pas fait. J’aurais dû comprendre comment on vit et qui on est. Mais je ne comprenais rien. Je vivais comme une insensée, et j’avais l’air normale. Je vivais une vie normale, et c’était insensé.
Ils ne bougent pas. Ils ricanent. Ils s’amusent de mes pleurs. Comment peuvent-ils être si méchants ? Oh, ils ne sont pas différents de beaucoup de jeunes gens de là bas. Leur habit est médiéval - le reste est intemporel. Ils narguent, ils violent, ils méprisent, ils prennent, donnent et reprennent. Ils aiment se faire servir. Ils aiment se faire offrir. Ils aiment ne pas aimer ceux qui les aiment. Ils aident parfois, et s’en vont sans s’en faire. Ils sont puissants, riches et méchants.
Je me révolte à ce souvenir, je me révolte de leurs deux sourires qui profanent l’église.
- Où est le prêtre ! crié-je. Je suis venue pour le confessionnal du cœur.
« Elle demande le prêtre ! » proclament des voix. « Elle demande le prêtre ! »
Les deux hommes rient et me regardent avec morgue. Le prêtre ne vient pas.
- Il n’y a pas de prêtre, dit la mauvaise conscience de sa voix de basse.
- J’en ai entendu un tout à l’heure, réponds-je.
- C’était moi, dit l’orgueil.
Je le regarde. Dans son œil brille la fierté d’être un éphèbe et un guerrier.
Je comprends que je suis prise au piège. La vieille abbaye de Cluny n’existe pas : c’est un mirage hanté et je suis tombée dans le piège. Alors je joins mes mains. Comme tous les incroyants, comme tous les impies, j’ai la prière fervente tapie comme un tigre dans la forêt, qui attend l’heure d’assaillir pour une grande dévoration. Quelle prière dire ? Je ne connais que des mots profanes.
- Que veux-tu de nous ? Demande l’orgueil, impatient.
- Moi ?
-Tu nous as invoqués, dit la mauvaise conscience. Nous sommes venus. Les musiciens jouent depuis déjà plusieurs heures et ils joueront jusqu’au bout. Mon frère et moi nous avons mis nos armures et nos casques ; les anges viennent chanter souvent. Qu’attends-tu ? Vas-tu nous laisser jouer sans but pendant toute la nuit ?
- La nuit ?
- Elle est tombée, la nuit. Elle est là. Si c’est ça que tu attendais…
- Mais vous allez faire quoi ?
- C’est ce que tu vas nous dire.
- Vous n’allez pas me tuer ?
- Nous pouvons te tuer. Si tel est ton désir.
- Vous allez me violer ?
- Nous pouvons te violer. Si tel est ton désir.
- Comment pourrais-je désirer cela ?
Ils éclatent de rire. Je m’agite. J’invente. Je tente :
- Et si je voulais vous tuer ?
- Nous nous ferons tuer par toi. Si tel est ton désir.
- Et vous violer ?
Une robe blanche surgit dans la sombreur du lieu. Elle avance, une fiole à la main. C’est Dame Guenièvre. Elle me montre le philtre.
-J’ai cela pour toi. Appelle-moi si tu veux violer ces hommes.
Je recule, horrifiée. Je ne veux plus voir cette affreuse Guenièvre.
- Et si je demandais de l’amour ?
- Nous pouvons te donner de l’amour. Si tel est ton désir.
- Et si je demandais des caresses, des sanglots, des pardons ?
- Nous te caresserons. Nous sangloterons. Nous te supplierons ton pardon. Si tel est ton désir.
- Seriez-vous mes esclaves ?
Je me dresse, fière, et je nargue à mon tour.
- Tu es seule avec toi-même, cœur blessé. Nous sommes tes créatures.
- Je veux quelqu’un ! Où sont les gens ? Où puis-je trouver des gens ?
- Tu n’as jamais rencontré personne. Tu n’as jamais aimé personne. Personne ne t’a jamais aimée. Tu as joué avec tes créatures.
Alors je hurle. Parce qu’ils sont ulcérant. Ils me volent ma vie. Ils me tournent en bourrique.
- J’ai tellement souffert !
- Tu as souffert, parce que tu es triste et violente, comme tant de dramaturges.
Serais-je une auteur ? Sommes-nous dans un théâtre ? Un éclair de pensée titille quelque chose, quelque part. Une question se forme :
- Est-ce que d’autres gens vivent en vrai ?
Les deux jeunes hommes rient. La musique appuie l’instant. Guenièvre s’assoit sur une chaise, fatiguée.
Et c’est à ce moment que j’éclate en sanglots. Le drame est là. Je le cachais depuis toujours. Il est là et il me rend folle de douleur. Je m’effondre.
- Je n’ai jamais eu d’enfant ! Je n’ai pas eu d’enfant !
Je me recroqueville, je pleure, je ne peux plus rien que pleurer. Quel malheur affreux. Les sept douleurs de la mère éprouvée ne sont rien auprès de la mère réprouvée. Aurai-je une consolation ?
Un des hommes s’approche. C’est la mauvaise conscience. Il me relève la tête et m’indique un coin de la salle. L’orgueil se tourne pour que je puisse voir. Il est là. Il s’approche. On l’amène. Il est dans une petite aube blanche, assis dans un fauteuil roulant, que des anges invisibles poussent. Il est si beau que j’en suis stupéfiée. Son visage doux et rond, rose d’enfance, me regarde avec joie. Il s’approche et tend sa main potelée vers moi.
-Maman… Ma…man prononce-t-il dans une voix de bébé mal réveillé, malgrandi. Il a quatre ans.
- Excuse-moi, murmuré-je. Mais il ne comprend pas ce que je dis. Il sourit. Il attend. Je ne sais que faire. Il tourne sa langue, il mord sa lèvre. Est-il déçu ?
- Il veut jouer, peut-être ? dit Guenièvre. L’enfant me montre un petit train qui traîne par terre. Je pousse le train. Je lui donne. Il est heureux. Il veut que je pousse encore le train.
Mais eux, derrière ? Je me tourne : cuirassés, agenouillés, ils contemplent l’enfant.
Et la musique me fait tout oublier. Elle me tourne la tête. Quelques secondes, je ferme les yeux. Lorsque je les rouvre, plus personne n’est là.
- Où êtes-vous ? Demandé-je.
Je me tourne et cherche des yeux. Ils sont absents. J’ai perdu mes beaux gardes. J’ai perdu mon amie Guenièvre. J’ai perdu mon enfant.
Et je sors de l’abbaye. Les sieurs Charles Baudelaire, Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval et Thomas De Quincey pleurent en me voyant.
- C’était beau, murmure Charles.
- Je t’aime. Je connais tes poèmes, lui dis-je.
Il fait un rictus avec son visage. C’est un sourire, bien sûr, qu’il me donne. Mais quelque chose remue, quelque chose souffle. La musique s’arrête net.
- Retourne vite ! Retourne vite ! Murmurent-ils. Cluny va disparaître. Tu vas avoir de la poussière partout.
Je sors en courant. Et dehors, je ris ! je ris ! je ris ! Ah, sieurs Charles, Aloysius, Gérard, Thomas ! Ah, impies ! Vous êtes les gardiens du Confessionnal, maintenant ! Oui, mais du confessionnal du cœur. Ah ! J’ai vu mes gardes, j’ai vu mon enfant ! J’ai senti ma digestion. Et j’éclate de rire. Cluny d’aujourd’hui est rempli de jeunes voyous qui crachent et qui regardent mon décolleté. S’ils savaient à quel point ils n’existaient pas, comme ils seraient déçus !
Edith Lucinière
Publié dans L'oiseau, Sleipnir, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |