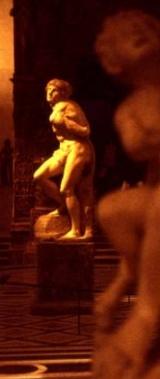samedi, 27 avril 2013
Nimbée de rhum
T'ai-je jamais aimé ? Tu m'intriguais. Tu passais, de loin, sur l'espace vide des lieux communs. Ton visage s'affinait sous mon regard nimbé de rhum et tu chantais. Je n'entendais ni l'air, ni les mots ; je fredonnais pour t'imiter, pour que tu tendes ton sourire vers moi. Mes mains te cherchaient dans le vide.
Et le temps a passé. Des immeubles furent érigés au lieu de nos promenades. La fontaine a été emportée par les employés municipaux. L'image que j'ai gardée de toi flotte comme un rêve autour de moi, dans les après-midi de printemps, quand les rues de la ville, peuplée d'une foule bigarrée et joyeuse, me voient marcher seule. À travers les chagrins du passé et les traces du présent, je déambule en me remémorant ta démarche, mon admiration, nos rencontres insatisfaites.
M'as-tu jamais remarquée ? Tu m'intriguais. Je restais, au loin, sous la ligne bleue des Vosges imaginaires. J'apprenais à aimer la chimère qu'on n'étreint pas ; j'édifiais mon amour avec des lettres de transparence. Peut-être qu'au fond je saisissais que dans cette inconscience du temps perdu, je vivais mes meilleurs moments.
Et le temps a recouvert cette histoire qui n'a pas été vécue. Je me demande quelquefois si j'ai vécu. Alors j'évoque ton visage et mon cœur bat encore.
Edith de C-Lucinière, 21 avril 2013, vers 19h50
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 25 avril 2013
Au confessionnal du cœur

C’est en marchant dans les rues de la vieille ville laidement modernisée que soudain la fumée immense est apparue. J’ai cru asphyxier ; une bâtisse magnifique s’est élevée devant moi. Et je l’ai reconnue : la plus vieille abbaye de France, que les Révolutionnaires avaient saccagée, dans la joie et la fureur, détruisant au nom de la liberté et de la raison un des plus vieux trésors qui appartenaient au peuple. La voilà qui se reformait devant moi, l’abbaye, et les vitraux, et les pierres millénaires se régénéraient et se recréaient et, subjuguée par le miracle, j’entrai.
Les murs ouvragés en marbre et en métal sont l’œuvre des anciens Compagnons du Tour de France. La musique qui s’élève ? Non, ce n’est pas de l’harmonium. Peut-être est-ce un vieil orgue, accompagné d’une viole de gambe. Un clavecin essaie de suivre. L’orgue et le clavecin sont jumeaux, frères miroirs des deux sœurs humaines, la solitude et la liberté. Les frères chantent les sœurs, les sœurs dansent avant de disparaître aux yeux humains qui hantent les lieux. Moines de l’an mille apparaissent et s’effacent à mon passage. Leurs yeux sont creux. Ils sont trop morts. Pourquoi suis-je ici ? J’avance et mes pas résonnent, sourds et lourds, dans la nef. Je suis dans cet antre magnifique, remis debout par un miracle de l’abbé Hugues : je suis à la vieille abbaye de Cluny ! Les ruines se sont relevées, c’est la régénération de la chair architecturale – et les clameurs qui détruisirent rageusement la vieille bâtisse se sont tues. Leur écho est terrassé. Il ne reste plus que le silence humain, la musique divine et les pas des chercheurs de vérité.
Il faut traverser tant de lieux à l’intérieur de ce lieu ! Jardins et potagers, couloirs extérieurs et arcades, comme Cluny est grand ! J’entre enfin dans l’église. La voûte m’accable. L’air est lourd. Une vérité est proche.
Je m’avance, et la lumière qui se balance, projetée sans doute par un ange, éclaire les dalles que je dois fouler. Je le pressens : je suis ici pour quelque chose. Mon cœur bat d’un autre rythme que le rythme vital : c’est le rythme du Purgatoire. J’arrive au Confessionnal du Cœur.
Des portiers sont postés sous les colonnes qui mènent au confessionnal : au nombre de quatre, ils ont pour noms Charles Baudelaire et Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval et Thomas De Quincey. Leurs toges dissimulent leurs pieds. Le premier, au visage raide et intelligent, porte une fleur. Un rictus saille son visage au moment où je passe devant lui. Le second, blessé par la splendeur d’un jour de malheur, arbore un visage triste ; on dirait qu’il ne me remarque pas ; pourtant il montre le troisième du doigt. Celui-ci soutient dans sa main une image de la Vierge, qui lui sourit avec bonté. Je marche devant eux et peux apercevoir la fixité des deux regards, celui de Nerval et celui de la Vierge. J’arrive devant la silhouette de Thomas De Quincey, coiffé d’une toque, et qui tient un flacon. Je passe mon chemin. La lumière éclaire une porte qui s’entrouvre et grince. Je sais que je dois passer. Derrière, une nouvelle petite porte s’ouvrira sur le confessionnal.
J’avance, et j’ai peur. Une dame est là. Alix, la fille d’un roi. Elle est abbesse. Elle sourit sans vigueur. Sa main gauche tient une clef. Ce que cette clef représente, je l’ignore. Mais un frisson me parcourt entièrement en contemplant l’objet de fer doré. Est-ce la clef du cœur ? Il faut entrer, passer la petite porte. J’ai mal, mais j’avance. Et je m’agenouille face à la grille enveloppée de pénombre, et une odeur d’encens se diffuse alentour. Des pas se font entendre, s’approchent ; l’autre partie de confessionnal est habitée, ça y est. La grille qui se soulève n’éclaire pas nos visages. J’ignore qui se trouve si près de moi.
- J’ai vu l’église se recréer comme par miracle. Je suis entrée. Je ne sais pas me confesser.
- Je vais vous laisser seule avec deux hommes qui vous cherchent.
- …
Incapable de répondre, je suis assaillie par la peur. Les pas du confesseur s’éloignent. Du silence noir où je me trouve, je perçois que la musique se remet à agir, tout là bas, au fond.
Du bruit : la porte du confessionnal s’ouvre brutalement. Je me relève en sursaut. Devant moi, deux hommes se dressent. Du creux de mon ventre les fontaines s’enclenchent et les éclusent se lèvent, un bourdonnement se met en route. Les canalisations s’ouvrent et débordent entre mon cerveau et mon ventre, même mes vertèbres sont ébranlées. Un instant, j’oublie où je suis et je vois l’horreur de l’intérieur : la digestion des derniers repas recommence et s’emballe : plus rien ne tient nulle part. Mon sang veut sortir des veines et tout se broie ; des saccades, des cascades se créent aux articulations. La lymphe devient nymphe et attire les résidus. Un bourgeonnement fait revivre les vieilles infections ; l’oreille droite pullule ; les conduits débordent ; une voix préhistorique croasse « je t’aime », « je t’aime », « je t’aime », c’est la bête intérieure ! qui aime qui ? Le crapaud est noir et gluant et prend tout mon corps. Les grenouilles le mangent ; il reste. Des serpents ondulent et sifflent sur les artères. Et la machine s’arrête, mon regard est éjecté, projeté à l’extérieur. Rien n’a changé. Les deux hommes se dressent. C’est alors que mon cerveau vogue à la folie et c’est mon ventre animal qui parle, qui voit, qui analyse et qui sait tout avec sa langue sans mots. Il scrute les deux hommes.
Leurs visages parlent d’eux-mêmes.
L’un est ma mauvaise conscience. L’autre est mon orgueil. J’ai peur d’un viol.
Ils attendent. Ils se taisent. Leurs regards semblent me dire : lève toi.
J’attends longtemps. Rien ne bouge. L’encens se répand toujours, et du fond de l’église me vient la belle musique des anges. Le clavecin et l’orgue jouant en cœur, la viole chantonnant sur leurs gammes étranges. Et au milieu de leur musique des voix de nulle part s’élèvent, comme pour m’encourager. Alors je me lève.
Et nous voilà trois, eux, grands, forts, raides, face à moi. Je fais un pas et j’attends. Là bas, la musique, c’est clair, sait que je me suis levée. Elle suit tous mes gestes. Elle suit toutes mes peurs. Elle m’entraîne dans des zones d’où je ne reviendrai pas. Elle est irrésistible.
- Je n’ai tué personne, murmuré-je.
Un sourd murmure traverse les murs de pierres de l’église.
»Elle soutient qu’elle n’a tué personne ». Des ricanements s’élèvent. Sont-ce des assassinés qui rient ainsi ? Quel mystère affreux ! Pourquoi mon cerveau ne revient-il pas ?
- Ne les écoute pas, murmure l’homme qui se tient à gauche, en armure, en face de moi. Et je sais : il est ma mauvaise conscience.
- Nous t’avons déjà jugée, dit l’autre homme, d’une étonnante voix de ténor.
Et je devine ; je comprends. Il est mon orgueil.
- Alors pourquoi venir me parler ? Pourquoi ne pas me tuer immédiatement ?
Ma voix est faible, presque éteinte. J’ai tant vécu dans ce monde là bas ! J’ai tant vécu de scènes et de tracas, au milieu des papiers administratifs et des relations sociales, des repas et des rues, des trains et des voyages, des ennuis des travaux et des jours, pour être jugée, torturée, condamnée par deux hommes aux allures de titans ?
Ils ne répondent pas. Ils sourient. Ils sont tellement forts qu’ils me narguent. Je les hais. Je les admire. J’aimerais qu’ils me protègent ; je sais qu’ils me tueront.
- Allez-y, murmuré-je.
Et des larmes coulent le long de mes joues. Tout était si insignifiant, là-bas, sur la terre humaine. Les mots, les voix, les gestes, les échanges, les longs après-midi qui passent, les objets qu’on achète et ceux qu’on met à la poubelle.
Les larmes coulent pour tout ce que je n’ai pas vécu. Les larmes dévalent pour tout ce que j’ai fait et dit. Je regrette presque tout. J’aurais dû faire tout ce que je n’ai pas fait. J’aurais dû comprendre comment on vit et qui on est. Mais je ne comprenais rien. Je vivais comme une insensée, et j’avais l’air normale. Je vivais une vie normale, et c’était insensé.
Ils ne bougent pas. Ils ricanent. Ils s’amusent de mes pleurs. Comment peuvent-ils être si méchants ? Oh, ils ne sont pas différents de beaucoup de jeunes gens de là bas. Leur habit est médiéval - le reste est intemporel. Ils narguent, ils violent, ils méprisent, ils prennent, donnent et reprennent. Ils aiment se faire servir. Ils aiment se faire offrir. Ils aiment ne pas aimer ceux qui les aiment. Ils aident parfois, et s’en vont sans s’en faire. Ils sont puissants, riches et méchants.
Je me révolte à ce souvenir, je me révolte de leurs deux sourires qui profanent l’église.
- Où est le prêtre ! crié-je. Je suis venue pour le confessionnal du cœur.
« Elle demande le prêtre ! » proclament des voix. « Elle demande le prêtre ! »
Les deux hommes rient et me regardent avec morgue. Le prêtre ne vient pas.
- Il n’y a pas de prêtre, dit la mauvaise conscience de sa voix de basse.
- J’en ai entendu un tout à l’heure, réponds-je.
- C’était moi, dit l’orgueil.
Je le regarde. Dans son œil brille la fierté d’être un éphèbe et un guerrier.
Je comprends que je suis prise au piège. La vieille abbaye de Cluny n’existe pas : c’est un mirage hanté et je suis tombée dans le piège. Alors je joins mes mains. Comme tous les incroyants, comme tous les impies, j’ai la prière fervente tapie comme un tigre dans la forêt, qui attend l’heure d’assaillir pour une grande dévoration. Quelle prière dire ? Je ne connais que des mots profanes.
- Que veux-tu de nous ? Demande l’orgueil, impatient.
- Moi ?
-Tu nous as invoqués, dit la mauvaise conscience. Nous sommes venus. Les musiciens jouent depuis déjà plusieurs heures et ils joueront jusqu’au bout. Mon frère et moi nous avons mis nos armures et nos casques ; les anges viennent chanter souvent. Qu’attends-tu ? Vas-tu nous laisser jouer sans but pendant toute la nuit ?
- La nuit ?
- Elle est tombée, la nuit. Elle est là. Si c’est ça que tu attendais…
- Mais vous allez faire quoi ?
- C’est ce que tu vas nous dire.
- Vous n’allez pas me tuer ?
- Nous pouvons te tuer. Si tel est ton désir.
- Vous allez me violer ?
- Nous pouvons te violer. Si tel est ton désir.
- Comment pourrais-je désirer cela ?
Ils éclatent de rire. Je m’agite. J’invente. Je tente :
- Et si je voulais vous tuer ?
- Nous nous ferons tuer par toi. Si tel est ton désir.
- Et vous violer ?
Une robe blanche surgit dans la sombreur du lieu. Elle avance, une fiole à la main. C’est Dame Guenièvre. Elle me montre le philtre.
-J’ai cela pour toi. Appelle-moi si tu veux violer ces hommes.
Je recule, horrifiée. Je ne veux plus voir cette affreuse Guenièvre.
- Et si je demandais de l’amour ?
- Nous pouvons te donner de l’amour. Si tel est ton désir.
- Et si je demandais des caresses, des sanglots, des pardons ?
- Nous te caresserons. Nous sangloterons. Nous te supplierons ton pardon. Si tel est ton désir.
- Seriez-vous mes esclaves ?
Je me dresse, fière, et je nargue à mon tour.
- Tu es seule avec toi-même, cœur blessé. Nous sommes tes créatures.
- Je veux quelqu’un ! Où sont les gens ? Où puis-je trouver des gens ?
- Tu n’as jamais rencontré personne. Tu n’as jamais aimé personne. Personne ne t’a jamais aimée. Tu as joué avec tes créatures.
Alors je hurle. Parce qu’ils sont ulcérant. Ils me volent ma vie. Ils me tournent en bourrique.
- J’ai tellement souffert !
- Tu as souffert, parce que tu es triste et violente, comme tant de dramaturges.
Serais-je une auteur ? Sommes-nous dans un théâtre ? Un éclair de pensée titille quelque chose, quelque part. Une question se forme :
- Est-ce que d’autres gens vivent en vrai ?
Les deux jeunes hommes rient. La musique appuie l’instant. Guenièvre s’assoit sur une chaise, fatiguée.
Et c’est à ce moment que j’éclate en sanglots. Le drame est là. Je le cachais depuis toujours. Il est là et il me rend folle de douleur. Je m’effondre.
- Je n’ai jamais eu d’enfant ! Je n’ai pas eu d’enfant !
Je me recroqueville, je pleure, je ne peux plus rien que pleurer. Quel malheur affreux. Les sept douleurs de la mère éprouvée ne sont rien auprès de la mère réprouvée. Aurai-je une consolation ?
Un des hommes s’approche. C’est la mauvaise conscience. Il me relève la tête et m’indique un coin de la salle. L’orgueil se tourne pour que je puisse voir. Il est là. Il s’approche. On l’amène. Il est dans une petite aube blanche, assis dans un fauteuil roulant, que des anges invisibles poussent. Il est si beau que j’en suis stupéfiée. Son visage doux et rond, rose d’enfance, me regarde avec joie. Il s’approche et tend sa main potelée vers moi.
-Maman… Ma…man prononce-t-il dans une voix de bébé mal réveillé, malgrandi. Il a quatre ans.
- Excuse-moi, murmuré-je. Mais il ne comprend pas ce que je dis. Il sourit. Il attend. Je ne sais que faire. Il tourne sa langue, il mord sa lèvre. Est-il déçu ?
- Il veut jouer, peut-être ? dit Guenièvre. L’enfant me montre un petit train qui traîne par terre. Je pousse le train. Je lui donne. Il est heureux. Il veut que je pousse encore le train.
Mais eux, derrière ? Je me tourne : cuirassés, agenouillés, ils contemplent l’enfant.
Et la musique me fait tout oublier. Elle me tourne la tête. Quelques secondes, je ferme les yeux. Lorsque je les rouvre, plus personne n’est là.
- Où êtes-vous ? Demandé-je.
Je me tourne et cherche des yeux. Ils sont absents. J’ai perdu mes beaux gardes. J’ai perdu mon amie Guenièvre. J’ai perdu mon enfant.
Et je sors de l’abbaye. Les sieurs Charles Baudelaire, Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval et Thomas De Quincey pleurent en me voyant.
- C’était beau, murmure Charles.
- Je t’aime. Je connais tes poèmes, lui dis-je.
Il fait un rictus avec son visage. C’est un sourire, bien sûr, qu’il me donne. Mais quelque chose remue, quelque chose souffle. La musique s’arrête net.
- Retourne vite ! Retourne vite ! Murmurent-ils. Cluny va disparaître. Tu vas avoir de la poussière partout.
Je sors en courant. Et dehors, je ris ! je ris ! je ris ! Ah, sieurs Charles, Aloysius, Gérard, Thomas ! Ah, impies ! Vous êtes les gardiens du Confessionnal, maintenant ! Oui, mais du confessionnal du cœur. Ah ! J’ai vu mes gardes, j’ai vu mon enfant ! J’ai senti ma digestion. Et j’éclate de rire. Cluny d’aujourd’hui est rempli de jeunes voyous qui crachent et qui regardent mon décolleté. S’ils savaient à quel point ils n’existaient pas, comme ils seraient déçus !
Edith Lucinière
Publié dans L'oiseau, Sleipnir, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 22 avril 2013
Dialogue entre celui qui peint et celui qui compose

- Comment fait-on des choses belles ?
- En se dégageant de soi et en exigeant de viser le plus haut.
- Oui, c'est vrai. Mais il doit y avoir autre chose...
- Oui, le rythme, la musique peut-être.
- Et la couleur.
- Oui.
- Mais il faut encore autre chose, pour atteindre une certaine puissance.
- Le côté tranchant comme un mouvement de sabre dans un combat, droit au but, avec souplesse : le bon geste.
- Ou bien la profondeur intangible du chatoiement, comme chez le peintre Turner.
Merci à Sara pour l'aide à la traduction.
Publié dans Chronos, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 19 avril 2013
Maryvonne, fille de la rêvolution
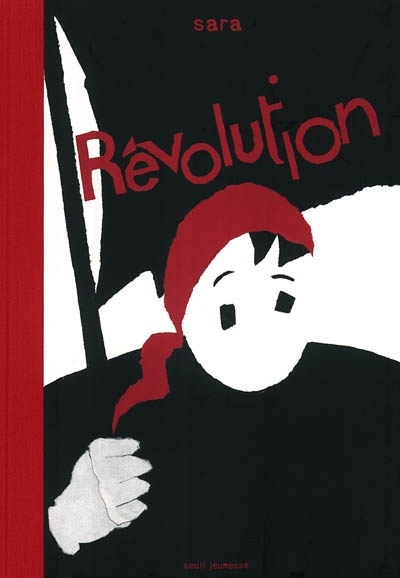
Un jour, un peu avant l'an 2000.
J'étais chez toi, rue Boissonade, et au cours d'un dialogue que nous avons eu, en quelques phrases tu as ouvert de nombreuses portes en moi. Ces portes m'ont dévoilé des jardins luxuriants dans lesquels je flâne encore aujourd'hui, étonnée de l'étendue de ta liberté.
Tu es partie, parait-il, en offrant un dernier sourire éblouissant aux gens qui t'aimaient. Tu as demandé à tes petites filles de vivre ta mort dans la joie et la paix. Tu es partie là-bas dans le Nord, dans cette maison que je ne connais pas.
Quelque temps après, tes amis, tes enfants t'ont fêtée une dernière fois tous ensemble.
Nous savions par ton exemple que la vie peut suivre la voie du rêve, se multiplier dans des baisers, tracer des routes pour la révolution. Tu nous as montré par ta mort que la mort peut être un rêve, un baiser, une révolution.
Ton héritage, j'en prends ma part.
Je vivrai de rêves, de baisers, de révolutions. Je mourrai dans un dernier rêve, dans un dernier baiser, en accomplissant mon ultime révolution.
Merci de m'avoir appris à penser d'une certaine manière. Merci de nous avoir appris à mourir en offrant un radieux sourire à ceux qui restent encore quelque temps sur la terre.
Sur le site de la CNT, un salut à Maryvonne
On peut lire en ligne son Texte L'invention d'un zéro
Publié dans Paracelse, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 18 avril 2013
Les dictatures douces

Voici quelques signes qui peuvent démontrer que vous subissez une dictature douce, dans votre couple, dans votre famille, votre religion, votre société, votre pays.
Certains de ces points concernent aussi les dictatures dures.
Il va de soi qu'éprouver quelques uns de ces ressentis ne transforme pas votre société en dictature douce ! Nous devons tous nous interroger sur notre propre responsabilité. Mais nous devons aussi refuser de porter toute la charge de notre échec lorsque toutes les portes de la société nous sont fermées de façon insidieuse.
Vous avez mauvaise conscience de vos pensées.
Vous avez honte de votre origine, de vos parents.
Vous manquez de volonté à agir dans le domaine professionnel.
Vous éprouvez un sentiment d'échec personnel face à un monde qui semble parfait mais vous est mystérieusement inaccessible.
Vous avez peur de dire des bêtises, de vous laisser aller à parler, d'aller trop loin quand vous vous exprimez avec d'autres.
Vous êtes habité par le sentiment diffus que les places au soleil vous sont inaccessibles, alors que « sur le papier » tout n'est que justice et raison.
Vous n'avez aucune prise sur votre quartier, votre environnement, votre ville.
Vous n'avez aucune maîtrise de l'évolution du monde.
Vous êtes en désaccord avec la majorité des lois, décisions prises, mais n'osez pas trop le montrer.
Vous avez envie que tout s'écroule, vous n'éprouvez aucun respect pour les institutions de la société (école, justice, police, santé...)
Vous n'avez pas bonne conscience de faire des enfants.
Vous idéalisez un passé où les possibles semblent avoir existé ; vous subissez votre propre absence de capacité à imaginer l'avenir. L'avenir paraît sans saveur.
Vous ne voyez aucun signe extérieur de censure mais vous n'avez aucune place pour vous exprimer.
Vous avez le sentiment que l'héroïsme n'est plus possible (« c'est d'un autre temps »).
(Dans le cas d'une dictature dure, en général l'apathie et la dépression sont remplacées, soit par une trouille mortelle de lever le petit doigt, soit par une exultation imprudente qui pousse à agir radicalement)
Aucun énorme barrage ne se dresse face à vous, mais vous faites face à de successives petites entraves.
Le « citoyen lambda » a une image détérioré, il ne présente aucun intérêt pour personne. Il est vu comme n'ayant rien à apporter d'autre au monde qu'un fonctionnement normal, non problématique.
Vous rêvez à des temps de guerre, de famine, de « vrais problèmes ».
(Dans une dictature dure, vous rêveriez à un monde normal, où tout roule)
Vous ressentez la désintégration de l'individu au quotidien (queues aux inscriptions à la faculté, à l'ANPE, queues dans les magasins).
Vous passez par des mini-actions dégradantes pour obtenir votre dû (remplissage de papiers administratifs, déplacements répétés sans but réel, queues).
Vous faites face à l'impossibilité légale de mener votre barque seul, de vous en sortir financièrement seul (entraves administratives et légales, taxes, interdictions d'exercer sans conditions contraignantes, interdiction de faire commerce hors des clous...)
Vous assistez à la multiplication des taxes.
Vous assistez à la multiplication des lois, règlements, etc.
Vous assistez à la multiplication des fonctionnaires et personnes payées par l’État.
Vous assistez à la multiplication des subventions.
(Ces multiplications se vérifient aussi dans beaucoup de dictatures dures)
Des programmes scolaires, que vous avez suivi docilement, vous n'avez retenu aucune connaissance précise (faits, chronologie raisonnée...)
Vous constatez la dégradation de la langue commune (appauvrissement de la syntaxe, réduction du vocabulaire).
Toute plainte de votre part sur ces ressentis est niée, ou ridiculisée par les autres au nom des vraies souffrances que vous avez bien de la chance de n'avoir jamais connues.
La moralisation des opinions augmente : s'opposer au fonctionnement des choses (administratives, scolaires, etc) revient, dans l'esprit général, à vouloir le mal d'autrui : c'est égoïste, inconscient.

à lire aussi : Comment s'effectue la traversée d'une époque troublée ?
Publié dans La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (9) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 15 avril 2013
Un soir sans étoile

Tant de choses font tant de peine dans notre vie quotidienne. Et la voix de Magkor Sérivij psalmodie de vieilles douleurs poétiques, accompagnée par un orgue religieux. C'est un disque qui appartenait à mon père, qui avait appartenu à son propre père, hommes que je n'ai pas connus mais dont j'ai hanté la maison morte.
Vraiment, en enfance, je rêvais et souriais au monde qui s'offrait. Je pardonnais tout à tous, croyant quand quelque chose me semblait laid ou mal que c'était moi qui me trompais.
Comment rester pur, quand tant de regards torves se sont posés sur vous ?
Je meurs sans en avoir l'air, peu à peu, d'avoir trop vu les adultes mentir.
J'ai l'âge d'être mère mais je ne berce aucun enfant.
J'ai l'âge d'être forte et je mens à mon tour.
Esther Mar
«À force de tout voir, l’on finit par tout supporter. À force de tout supporter, l’on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, l’on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. »
Saint Augustin
à lire aussi : L'amour ignoré
Publié dans L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 14 avril 2013
Ethel dans la ville

Éthel à neuf heures s'installe à sa table de travail, devant la fenêtre derrière laquelle les toits de Paris se déploient jusqu'à la lointaine banlieue où de hautes cheminées fument loin au-dessus des arbres. Le ciel est traversé de pigeons et d'avions à réaction. Elle ouvre son évangile grec, son dictionnaire du grec biblique, sa grammaire.
Lundi, elle travaille ainsi à mieux comprendre l'évangile dans le texte.
Mardi, à la même heure, elle s'attelle aux chroniques éthiopiennes écrites en langue amharique.
Mercredi, elle étudie de vieux poèmes arabes et des manuscrits de Tombouctou.
Jeudi, elle déchiffre la genèse en hébreu.
Vendredi est consacré à l'ancien français.
Samedi, assise à la même table, elle déchiffre des partitions musicales mentalement.
A onze heures, elle ferme ses livres et se met au piano ou à la guitare, à l'oud arménien ou à la flûte et elle laisse ses doigts rêver sur l'instrument, une heure durant. Lorsque les dernières notes meurent sur les rives de la Faim, Éthel s'en va dans habiter sa joyeuse petite cuisine. Elle y prépare un déjeuner, pour elle seule ou pour l'invité du jour.
A 14h, elle prend un café seule, sur son hamac, en écoutant de la musique, ce qu'elle préfère. Certains jours elle choisit de se balancer dans le silence.
Une promenade suit souvent ce moment de détente. Puis Éthel rentre et se met à son ordinateur, où elle écrit deux heures. En ce moment, elle travaille sur une série de dessin animé consacrée à l'histoire des rois de la Bretagne. Lorsque ces deux heures de travail sont terminées, elle s'offre une nouvelle promenade, fait des courses ou prépare un plat long et compliqué.
Le soir, seule ou avec quelques proches, elle dîne aux chandelles. Dans la pénombre où flottent quelques lueurs de feu, la cire fond lentement, les conversations se succèdent, calmes ou agitées, on met un disque ou on fait quelques pas sur la terrasse pour apercevoir la lune à travers les nuages de pollution et les lumières artificielles.
Autrui part tôt car la solitude est chère à Éthel. Quand elle n'est pas subie, mais choisie, elle lui ouvre les portes de la prière et de la pensée. Éthel prie dans la pénombre, de longs moments, que son cœur soit sec ou spirituel elle prie.
Si elle entre dans son lit avant onze heures, elle lit quelques temps avant d'éteindre et de chercher le sommeil. S'il est onze heures ou plus tard, pas de lecture.
Au bout de la nuit, elle s'éveille vers sept heures et peu à peu émerge d'un lointain monde nocturne. Après la douche, le petit-déjeuner, elle prie.
Puis elle attend dans son lit ou fait une promenade avant de se mettre, à neuf heures, à sa table de travail, sous la fenêtre par laquelle Paris se dévoile, toujours plus beau, saison après saison.
Elle ouvre son dictionnaire d'amharique, ses grammaires et ses chroniques, car on est mardi.
De temps en temps, dans la semaine, elle se rend à une réunion dans une institution, un déjeuner d'affaire ou un dîner en ville. Mais cela ne trouble pas longtemps le rythme de sa vie, né de l'habitude, de l'expérience et de l'inspiration.
Sébastien Ithiopia, 10 avril 2013, près d'une fenêtre sombre l'après-midi
| Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 10 avril 2013
Estelle au mois d'avril

1
Avril, 2077. La lumière de la journée, belle et étrange, emplit la pièce d’un rêve langoureux. Estelle Claris, tranquillement assise à sa table, se laisse glisser dans un océan de visions bleues comme les vagues qui roulent en bas de l’hôtel, sur la plage de sable blanc. A quarante-huit ans, elle songe aux années de jeunesse qui lui restent à vivre, dans une insouciance aventureuse… Elle se demande si lorsque vers soixante ans, quand l’âge d’avoir des enfants et une activité d’auto-définition sonnera, elle aura l’indépendance d’esprit de poursuivre sa course à l’instance, ou si, comme ses aînés, elle ensevelira ses rêves dans une mise en couple raisonnable, doublée d’une activité d’auto-définition bien définie.
Les vingt premières années de son enfance, Estelle les a vécues dans la plus haute capitale du monde, à La Paz. Lorsque ses pères se sont séparés, dans un fracas de larmes et de disputes, sa vie s’est scindée en deux, et elle a quitté La Paz pour toujours. Désormais partagée entre Lhassa, ou son père normatif Francis s’était réfugié, pour demeurer dans une atmosphère de montagnes qui correspondait au cheminement naturel de son karma, et Moscou, ou son père nourricier Sylvain s’était installé avec son nouvel amant Sergueï, Estelle avait appris à oublier la douleur d’un paradis perdu dans le rêve. A trente ans, elle s’était engouffrée dans une adolescence de type B1, et on l’avait envoyé dans une école privée à Vienne, les écoles de l’ONU pour adolescents de classe B et C ayant à l’époque très mauvaise réputation. Elle y avait terminé sa scolarité à l’âge conseillé, et à quarante ans, son certificat d’émotionalité régulée en poche, elle avait décidé avec trois amis de claquer toutes ses allocations de jeunesse à parcourir le monde. Ses pères ne tentèrent pas de l’en empêcher. Conscients d’avoir frôlé la ligne du viol moral au moment de leur séparation, aucun des deux ne voulait entamer le psychisme de leur fille en détournant son projet personnel, même si un tel dévergondage citoyen les effrayait. Francis, de Lhassa, et Sylvain, de Moscou, l’avaient donc soutenue dans ses voyages, et Estelle avait parcouru la planète et le ciel Ouest quelques années. Elle était partie accompagnée de Karim, Inti et Tristana, mais au cours de leur exploration du monde le quatuor s’était séparé. Karim avait eu une crise d’angoisse sur le satellite artificiel Race, et n’avait pas voulu sortir de l’hôpital même après l’autorisation du centre d’éthique de Race. Estelle, Inti et Tristana s’étaient donc résignés à laisser leur ami. Ils avaient continué leur aventure ciel Ouestiènne, pour rejoindre la planète en Inde. A Bombay, Inti était tombé amoureux d’une adolescente de trente-deux ans. Ils avaient eu une liaison, et Inti avait été interné en hôpital religio-psychiatrique. Estelle avait voulu l’attendre quand Tristana insistait pour continuer le périple, considérant qu’Inti ne méritait plus ni le titre de citoyen, ni son amitié. Estelle était alors restée à Bombay, mais Inti n’obtenait pas le droit de sortir. Lorsqu’on le transféra au centre de déracisme, sa liaison ayant été analysé comme une façon de mépriser l’ethnie de l’adolescente, il avait même été interdit de visite. Estelle s’était alors résolue à reprendre la route seule. Et c’est à partir de ce moment qu’elle avait entamé sa quête de l’instance.
Aujourd’hui, il est difficile pour Estelle de ne pas ressentir de tristesse en se remémorant ces années post-écolières. Elle n’a plus jamais eu de nouvelles de Tristana, mais Karim et Inti sont tous deux parvenus à se créer un cadre cohérent, pour une vie douce et libre. Pourtant, les relations sont difficiles entre tous les trois. Sans doute, les expériences hospitalières des deux jeunes hommes les ont marqués plus qu’Estelle ne peut le comprendre, érigeant une fumée de silence et d’insécurité entre eux. Estelle, elle, n’a pas eu à affronter ses manquements et ses errances : sa capacité à fuir dans le rêve et à voiler le rêve sous un regard bleu et vide, sous un sourire frais et ouvert, lui ont évité les désagréments de la rééducation. Elle le sait, et elle s’en félicite. La lumière du jour continue à bercer ses songes ; le roulement des vagues monte à sa fenêtre et la peau d’Estelle se tend, énervée par le désir d’eau. Elle se lève et appuie sur le programme café-matin de la machine de consommation boissonale. Un café tombe, bien chaud, bien serré, bien odorant. Estelle le savoure en fumant une cigarette de respiration mer salée. Debout à la fenêtre, elle contemple les vagues, dans un étrange sentiment mélangé de douceur et de solitude.
Le rivage et ses arbres sont beaux dans le matin. Estelle descend les escaliers, sa planche de surf sous le bras. Elle croise le gérant de l’hôtel.
- Encore du surf, Humain Claris ?
- Heu… Oui, je vais surfer un peu. A tout à l’heure, Humain Dupont.
Estelle a un soupir un peu agacé. Un A3, celui-là, se dit-elle avec un petit sourire. Elle déteste les A3. Elle s’en veut un petit peu de ce racisme affectif, mais sa solitude l’a habituée à penser franchement, et elle ne parvient plus ni à refouler, ni à exorciser ce sentiment de mépris et de rage contre les A3. Sur la plage, un vent tiède lui caresse le visage et les cheveux. Elle tourne le dos à l’hôtel Dupont, se déshabille, et marche, de son étrange démarche de pouliche, vers les vagues.
Estelle surfe. Elle rame, se lève, glisse, glisse, glisse, s’effondre dans un jaillissement d’écume quand la vague meurt, et rame à nouveau, se lève, glisse, glisse, glisse… Si, un jour, ses pensées sont découvertes, ou si ces salauds de pays très alignés font passer leur loi à l’ONU, sur l’activité d’auto-définition forcée, alors elle sait ce qu’elle fera. Un matin comme les autres, elle ira surfer comme d’habitude, et s’engouffrera dans un rouleau d’eau pour ne plus remonter vivante. Pour l’instant, Estelle surfe, elle oublie ses soucis, elle oublie les pays très alignés et elle oublie les humains A3. Elle rit, les pieds sur la vague et les cheveux dans le ciel, et les rêves d’avenir naissent à l’horizon, dans le soleil ovale.
Trois heures de surf. La biomontre d’Estelle vient de clignoter, pour la troisième fois depuis qu’elle est entrée dans l’eau. Il est temps de rentrer. Estelle, allongée sur sa planche, les yeux clos, se laisse bercer par les vagues jusqu’au bord.
Le sable tiède l’accueille agréablement. Estelle ouvre les yeux ; devant l’hôtel Dupont, trois camions de Solidarité stationnent. Des solidaires en uniforme attendent au seuil du bar de l’hôtel. Estelle se lève et plisse ses yeux pleins de sel. Un léger sentiment de malaise s’empare d’elle. Les solidaires regardent tous dans sa direction. Elle enlève le sable de sa planche et regarde à nouveau vers l’hôtel. C’est bien elle qu’on observe. Debout au milieu des solidaires, les bras croisés, l’humain Dupont la regarde aussi, d’un œil de traître. Toute sa silhouette est fuyante. Voyant son crâne imperceptiblement baissé comme pour recevoir une caresse d’un éventuel veilleur du ciel, voyant ses jambes et ses bras, bien que fermes, animés d’une mollesse fourbe, Estelle devine…
Comment a-t-elle pu croire qu’on la laisserait claquer ses dernières allocations de jeunesse dans un lieu tranquille, à danser chaque jour, des heures durant, avec les vagues de la plus belle poubelle de la planète ?
Impossible de fuir. Les solidaires l’attendent sans impatience. Ils bloquent toutes les issues de la plage. Elle n’a plus qu’à les affronter ou à retourner à l’eau. Elle sait qu’ils attendront qu’elle en ressorte… S’engouffrer dans un rouleau d’eau pour ne plus remonter vivante… Mais, parmi les solidaires bleu-casqués, Estelle distingue des sauveteurs. On ne la laissera pas se suicider.
Elle ramasse sa planche et remonte lentement la plage ; le sable se dérobe sous ses pieds nus. Une immense peur l’agrippe.
Pourquoi apprend-on à l’école que la peur a disparu de l’ère terrestre au début du vingt et unième siècle ? Même les citoyens des pays en voie d’alignement ne la connaissent plus. La peur, la colère, et la perversité… Les trois ennemis que l’humanité a enfin terrassés. Pourtant, à chaque pas qui la rapproche de son comité d’accueil, n’est-ce pas la peur, qui accroche son ventre et cogne son cœur ?
2
- Humain Claris.
- Oui, Humain solidaire.
- Vous avez votre biofiche de citoyenneté ?
Estelle tend son poignet.
- Désactivez votre montre, je vous prie.
Estelle porte la main à son oreille. Elle masse le lobe, jusqu’à ce que la biomontre s’endorme.
Le solidaire est bienveillant. Il sourit. Le timbre de sa voix, doux et équilibré, reflète une grande sincérité. Estelle essaie de ne pas trembler ; il est C1, elle en est certaine. Face à sa conscience citoyenne, sa profonde bienveillance, elle sait qu’elle est perdue : il va vouloir la sauver.
- Vous tremblez, Humain.
- J’ai froid.
- Vous vous faites beaucoup souffrir en vous baignant ainsi ?
- Non, Humain solidaire. J’aime surfer. Mais mes habits sont dans ma chambre, et j’aurais besoin de me couvrir.
- On m’a dit que vous surfiez beaucoup.
Estelle cherche du regard. L’humain Dupont, à quelques mètres, fait semblant de regarder la mer.
- Oui, Humain, je surfe beaucoup.
- Cela vous fait du bien, n’est-ce pas ?
- Oui.
- Cela vous soulage ?
- Euh… Non…
- Cela ne vous soulage pas ?
- Euh… C’est à dire, je n’ai pas besoin d’être soulagée.
- Vous n’avez jamais besoin d’être soulagée ?
- Euh… Si, bien sûr.
- Faites vous régulièrement le point chez un conseiller en trajectoire de vie ?
- Oui. Oui, de temps en temps.
- Pas plus que ça ?
- Si, quand même. Quand même assez souvent.
- Vous éprouvez le besoin de le faire souvent ?
- Non, enfin… Régulièrement. J’aime… J’aime les choses équilibrées… Les choses régulières…
- Vous sentez que vous avez besoin d’équilibre ?
- Non, enfin, pas spécialement. C’est à dire… Comme tout le monde… Je me sens comme tout le monde.
- Vous savez que vous ne menez pas la même vie que tout le monde ?
- Non. Si… Si, je sais.
- Votre fiche ne porte pourtant pas la mention Originalité.
- …
- Vous recevez vos allocations jeunesse ?
- Oui, Humain.
- Et dans deux ans, quand cela s’arrêtera, que ferez-vous ?
- Je… Je choisirai une activité d’auto définition.
- Vous ne l’avez pas encore trouvée ?
- Non. Je suis un peu attardée.
Merde ! Se dit-elle. Une phrase de trop. Sa fiche technique ne porte pas la mention Humour, et pourtant, ce petit humour sarcastique risque toujours de la perdre.
- Vous pensez que vous êtes attardée ?
- Je disais ça pour rire.
- Mais vous n’avez pas ri.
- Je… Enfin, intérieurement, j’ai souri.
- Et vous n’avez pas pu l’extérioriser, ce sourire ?
- …
- Vous surfez six heures par jour, d’après ce que je sais.
- A peu près.
- A peu près ? Je crois que vous surfez six heures par jour. Vous souffrez peut-être d’une trop grande osmose avec les éléments naturels ?
- Je ne crois pas.
- Vous pensez pouvoir choisir votre activité d’auto définition en surfant ?
- …
- Dans quelques années, vous recevrez vos allocations d’adulte. Les emploierez-vous à surfer ? Ou à participer à la créativité humaine ?
- La deuxième solution.
- Vous vous en sentez capable ?
- Oui.
- Quelle autosatisfaction, Humain Claris. Vous êtes très différente du reste de l’humanité, alors. La plupart des gens se savent à la merci de leur part animale. Vous savez, je pense que vous devriez passer un peu de temps dans un centre de réflexion, entourée de psychiatres et d’humanistes. Mais vous seule pouvez prendre cette décision. Ne vous sentez pas forcée. Ce que je veux que vous sachiez, c’est qu’une trentaine de personnes ont signé pour votre décitoyennisation. Ce processus est donc en cours, sauf si vous choisissez de vous soigner.
La décitoyennisation, cela signifie la désallocation. Et sans allocation, personne ne vous accueillera nulle part. Vous n’avez plus qu’à rejoindre un centre de décitoyennisés, pour y vivre jusqu’à la fin de vos jours, à moins que vous ne travailliez sans relâche à devenir à nouveau un citoyen. Estelle ne pourrait jamais le supporter, elle le sait.
- Je vais me soigner, Humain solidaire.
- Le camion qui vous emmènera au centre de soins vous attend.
- Cela ne peut pas attendre quelques jours ?
- Non.
- Je… Je vais m’habiller, Humain.
- D’accord, Humain Claris. Nous vous attendons.
Estelle s’éloigne en tremblant, sans se retourner. Elle sait que l’homme l’observe avec compassion. Elle n’a pas crié ; elle ne s’est pas révoltée. Elle n’a pas fait montre d’une paranoïa aiguë, évitant ainsi la mention dangerosité sur sa biofiche, et l’internement psychiatrique. Elle connaît l’histoire de cet homme qui avait raconté, lors d’un dîner de voisinage, qu’il ressentait de temps en temps de la colère. Après dix ans d’une médicalisation à outrance dans un institut de sauvetage de l’ONU, il était redevenu libre, mais on avait dû lui greffer un système affectif artificiel, car il avait perdu la faculté d’éprouver des émotions. Estelle, cela fait bien longtemps qu’elle n’éprouve presque plus rien. Mais le plaisir de glisser sur les vagues… De l’eau contre sa peau… Et de l’extase dans le tube, quand la vague se referme sur elle et qu’elle hurle dans le couloir d’eau… C’est sa raison de vivre, la réalisation ultime de sa quête de l’instance. Cela, elle ne peut y renoncer.
Estelle, la planche sous le bras, encore ruisselante de gouttes salées, monte seule le petit escalier de bois qui mène à l’étage des chambres.
Sa chambre l’accueille comme si rien ne s’était passé. Le bois du vieux plancher, le blanc des murs, la paille des chaises et l’appel de la machine de consommation boissonale. Un rayon de soleil oscille entre le lit et la cabine d’hygiène.
Non. Elle n’ira pas au centre de réflexion. Elle ne veut pas des humanistes et des psychiatres. Elle veut ses rêves ; ses rêves et ses vagues.
Elle pose sa planche contre un mur, enfile un pantalon et s’allonge sur son lit. Elle le sait, elle n’a que quelques minutes devant elle. Si elle ne descend pas, on montera la chercher. Et si elle refuse de partir, c’est la décitoyennisation immédiate. A l’époque où le suicide n’était pas encore interdit, ou plutôt, à l’époque où l’on pouvait se suicider sans que sa biofiche se mette à sonner, la situation aurait été difficile, mais solvable.
- Humain Claris !
- Merde, murmure Estelle.
Affolée (la peur n’existe pas, j’ai peur, donc je ne suis pas), Estelle se lève, et vacille.
- J’arrive !
Mais elle ne bouge pas ; elle le voit.
Dans le coin de la chambre, il est là ; il attend. Bien sûr, il est inutile : on la rattrapera dans la minute. Mais il est l’ultime espoir. L’ultime tentative de liberté.
Estelle y accroche sa planche, l’enfourche et le met en mode silencieux.
- J’arrive ! crie t-elle à nouveau.
Elle démarre et s’élève devant la fenêtre ouverte.
Un. Deux. Trois.
Estelle s’envole de l’hôtel Dupont, accroché à son scooter des airs comme au baiser de la mort.
3
Un simple coup d’œil en bas : les solidaires et les sauveteurs sont toujours devant la porte de l’hôtel, et l’humain Dupont leur sert des cafés. Estelle relève les yeux ; accélère ; accélère ; elle s’élève et s’éloigne, les yeux fixés sur l’horizon. Elle n’a pas le courage de regarder en arrière. Elle attend de s’enfoncer dans les nuages pour mettre le scooter en mode bruyant. Avant de s’engouffrer dans un nuage, elle ose un regard en arrière. Pas de poursuivants. Un regard circulaire. Pas de veilleurs du ciel. Il est impossible de leur échapper, il faudra mourir ou retomber entre les mains, ou plutôt entre les cerveaux des humains. Mais, chaque seconde de vol est une rencontre avec le ciel, avec la liberté.
Le scooter des airs danse dans les nuages. Tout est blanc. Des aires bleues apparaissent à travers la mousse blanche : le ciel pur, en haut ; et l'océan, en bas.
Les nuages étouffent le bruit du moteur et Estelle chevauche son scooter avec fougue, la passion au corps. Les champs de nuages s'étendent au loin. Estelle les traverse à une allure folle, et soudain sa bouche s'ouvre, ses poumons s'élargissent et un hurlement, un rugissement s'élève au creux de ses hanches, emplit son corps, et transperce les nuages. Estelle n'a jamais hurlé si fort, dans aucune vague, dans aucun rêve. Puis sa voix meurt et Estelle sent et voit ses bras minces trembler sur les poignées de son scooter. Le froid l'envahit. Le couloir de nuages finit ; l'océan et le ciel, bleus comme les yeux d'Estelle, bleu très scintillant, lui brûlent les yeux. Le bruit du moteur se fait à nouveau entendre, aussi assourdissant que les nuages qui l'assourdissaient. Estelle baisse les yeux. En bas, sur l'océan, à quelques centaines de mètres au dessous d'elle, une dizaine de navettes sont déjà là, remplies de solidaires et de citoyens qui attendent Estelle. Elle relève les yeux, prête à fuir au plus haut du ciel. Elle tire sur l'énergie de son scooter comme jamais. Elle crève le ciel, loin des vitesses maximales autorisées. Le soleil, frère et ami, l'appelle tranquillement. Oui, il la prendra. Oui, il lui brûlera les yeux, et la peau et les poumons, et jamais, jamais plus Estelle ne retournera chez les humains. Merci, soleil, pense Estelle, les lèvres entrouvertes, éblouie par cette promesse solaire de délivrance et par la vitesse effrayante de son scooter des airs.
Plus que quelques kilomètres. Plus que quelques petits kilomètres et le soleil accomplira sa promesse. Estelle fonce, elle file, dans un ciel tiède et doux, quand derrière elle, insidieusement, elle sent grésiller le bruit d'un moteur. Le bruit de plusieurs moteurs. Dans un espoir inouï, Estelle sollicite son scooter et donne une ruade. Plus vite ! Plus haut ! Elle sent son scooter faiblir, flancher. Le bruit de moteur s'approche. Elle se retourne : le bruit de vingt moteurs au moins. Ils sont au moins vingt. Vingt solidaires armés de lances endormisseuses, casqués, en rang, qui la rattraperont dans moins d'une minute. Estelle doit faire son choix, elle a à peine une minute pour faire son choix. Les solidaires se rapprochent sur leurs scooters de l'ONU. En haut, le soleil est trop loin. Il a menti. Il ne pourra pas la prendre. En bas, Estelle distingue des vagues, qui tissent et délissent la surface océane. Et les navettes des solidaires et des citoyens volontaires.
Estelle entrevoit le point de rencontre entre le ciel et la mer : l'horizon lui donne courage et liberté. Dans un rire magnifique, elle lâche tout. Elle lâche sa tension, elle lâche sa conduite, et laisse le scooter tomber.
La chute est fulgurante, d'une très lente rapidité. Estelle se retourne juste une fois. Les motards assistent, impuissants, immobiles dans le ciel, tous penchés vers elle. Parmi ces visages honnêtes et équilibrés, un seul l'appelle, retient son attention. En un regard de quelques secondes, ou quelques instants, Estelle et lui se rencontrent. C'est un inconnu. Il est équilibré, mais ses lèvres tremblent derrière son casque. Son regard est rempli d’admiration et de fraternité. Il l'approuve. Le cœur battant, Estelle sent qu’ils tombent amoureux. Soldat à l’invisible rébellion, il lance des flammes de vie par chacun de ses yeux. Estelle soutient ce regard ami, jusqu'au choc.
Le scooter est tombé dans la mer. Estelle tient toujours les poignées, ses jambes l'enserrent. Elle s'accroche au scooter, et laisse la mer l'entourer, l'envelopper et l'emplir. La liberté est enfin là. Elle est bleue, verte et profonde. Estelle descend dans la liberté, avec la solennité d’une mariée.
Dans un ultime sourire bleu, Estelle s’offre une prière : faites, O mes fonds océans, faites qu’ils ne retrouvent jamais mon corps.
Edith de Cornulier Lucinière, 2002
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 09 avril 2013
Adélaïde

Il y a douze ans maman entrait dans la mer. Elle marchait avec sa robe bleue dans les vagues glacées. Personne ne la vit s’enfoncer dans l’eau.
La veille au soir, elle avait appris, à la suite d’événements administratifs compliqués, que son époux, notre père, entretenait depuis le début de leur mariage des liaisons avec cinq femmes, et qu’il était le père du fils de l’une d’entre elle – un fils un peu plus jeune que moi.
Adélaïde et moi, nous découvrîmes tout cela en même temps : les liaisons de notre père, le fils caché, l’entrée de notre mère dans la mer.
J’ai été déchiré en mille morceaux par ce drame. Adélaïde est entrée au couvent. Carmélite, elle vit cloîtrée, ne sort jamais. J’ai un droit de visite restreint. Sa vie est prière. Elle prie pour maman et elle prie pour moi.
Nous avons refusé de revoir notre père, Adélaïde parce qu’elle était trop blessée, moi par fidélité à celles que j’aime. Il est si beau, si intelligent, si riche et si sympathique que si je l’avais revu ne serait-ce qu’une fois, je n’aurais pas pu rester fâché. Or, pouvais-je me laisser trahir la mémoire de ma mère, la douleur de ma sœur et mon propre chagrin de fils trompé ?
Mais il y a huit jours, le notaire, Maître Sistretaille m’a annoncé que notre père venait de mourir. A sa demande, je me suis rendu à son étude et j’y ai rencontré l’autre fils, Térence, qui porte le nom de famille de sa mère. Il n’osa pas me regarder. Pendant le rendez-vous, il répondait au notaire, signait ce qu’on lui disait sans rechigner et ne leva pas les yeux vers moi. Mais pour que nous puissions toucher notre dû amer rapidement, il fallait définir entre héritiers un accord amiable pour débloquer un fonds. Je pensai que le mieux était d’agir ainsi plutôt que d’entrer dans des déboires juridiques incessants, qui ne mèneraient à rien et n’auraient comme source unique l’horreur d’avoir été trahis chaque jour de notre enfance et de notre jeunesse.
J’appelai Adélaïde et arrangeai une date, que Térence accepta. J’aurais voulu faire le voyage seul, mais un seul train traversait la France jusqu’au carmel où elle priait.
Ce fut le premier point commun : nous nous retrouvâmes au wagon-bar du train au même moment, pour la même bière. Térence était si discret que je n’osais le snober plus longtemps et lui proposai de boire la bière ensemble. Nous fîmes connaissance. Nous échangeâmes des renseignements de surface sur nos vies.
Je tiens une salle de jeux à Monaco. Je vis dans un monde louche et j’aime ça. Je vis avec Marlène, qui ne ressemble à aucune femme connue au cours de mon éducation. Elle est vulgaire, franche, brutale, plutôt généreuse et elle s’enivre avec mes clients au lieu de faire la comptabilité pour laquelle je la paye.
Térence est fonctionnaire de l’administration française, ce que j’aurais tendance à mépriser souverainement. Mais je n’avais pas le cœur au mépris. Il fait de la guitare dans un groupe de musique beith, composé de ses vieux copains du lycée. Il fait de la boxe le mardi soir.
Nos bières terminées, aucun de nous ne retourna à sa place, car la conversation coulait, limpide, comme l’eau douce des montagnes qui passe entre les rochers.
La petite ville nous accueillit par la pluie. Nous louâmes des vélos et nous rendîmes ainsi au couvent, comme je fais à chaque fois. A l’arrivée devant la porte, je n’avais toujours pas de frère, mais j’avais un camarade.
Une carmélite vint passer son visage entre les grilles de l’entrée.
- Nous venons voir Sœur Véronique du Renoncement.
- Qui êtes-vous ?
- Ses frères, dis-je. Et je tressaillis en prononçant le mot frère au pluriel. La sœur partit, ses talons claquèrent longtemps sur les dalles de l’allée intérieure du cloître. Nous attendîmes longtemps. Puis, derrière nous, la voix de ma sœur brisa le silence :
- Je n’ai qu’un frère.
Nous sursautâmes. Elle se tenait droite derrière nous, le visage tâché de rousseur posé au sommet de la longue robe marron de son ordre.
- Adélaïde ! Je la pris dans mes bras.
Elle observa mon visage, mes cheveux, passa la main sur ma joue et lâcha son verdict :
- Tu fumes trop, Charles, tu ne manges pas assez de légumes et tu ne repartiras pas sans que je t’aie coiffé correctement.
Elle ne s’occupa pas de Térence, qui l’observait avec de grands yeux passionnés. Elle nous emmena dans un petit bureau que la Mère avait à sa disposition, connaissant l’objet de notre visite.
Nous parlâmes affaires ainsi : je m’adressais à elle, puis à Térence, cherchant à trouver un accord entre nous trois, et chacun me répondait sans qu’ils se parlent entre eux. Nous signâmes un accord ; le silence s’installa.
Lorsque Térence se leva, comprenant qu’il fallait nous laisser, il me remercia en me serrant chaleureusement la main, puis il se tourna vers ma sœur :
- Depuis douze ans, je me sens mieux de savoir que vous savez, prononça-t-il avec difficulté. Chaque morceau de son corps et de sa voix, tendu vers nous, tentait de se faire aimer.
- Il y a douze ans, Maman est entrée dans l’eau glacée à sept heures du soir, dit Adélaïde.
Térence baissa la tête. Alors, enfin, j’eus pitié de lui. Il était né coupable comme nous étions innocents. Il avait été initié aux bassesses du mensonge, de la cachotterie par notre père et sa mère dès sa plus tendre enfance. Il avait dû souffrir, lui aussi, bien que je ne sache pas dans quelles conditions on souffre quand on est illégitime, et il avait dû grandir dans la connaissance malsaine du péché comme nous avions grandi dans l’inconscience niaise de la bourgeoisie. Il avait honte de tout ce qu’il était, sachant qu’il était l’incarnation de ce qui avait brisé notre vie. Il prononça
- Pardon, Adélaïde.
Il partit précipitamment.
- A tout à l’heure, à la gare, lui lançai-je. De dos, il acquiesça de la nuque.
Nous restâmes l’un en face de l’autre. Elle était raide et belle : pas une mèche ne dépassait de son voile marron. Depuis combien de temps n’avais-je pas vu les cheveux de ma sœur ?
- Il n’y est pour rien, murmurai-je.
- Je sais, répondit-elle. C’est sans doute une âme pure. Mais il ne peut ignorer que son existence est atroce pour nous.
- Il n’a pas choisi de vivre, dis-je.
- Moi non plus.
Elle alla chercher un peigne et me coiffa. Quelques sœurs, qui allaient et venaient dans le parloir, souriaient en blaguant sur les frères ébouriffés et les sœurs maternantes. Bientôt Adélaïde dut rejoindre ses compagnes pour assister à l’office et je soupirai en prenant congé d’elle. Comme la vie était fragmentée, officieuse, si différente de ce qu’elle avait été au temps des Noël familiaux, des grands mariages de l’été, des réceptions de nos parents et des cousinades endiablées durant les grandes vacances.
J’attendis Térence de longues heures. Il n’apparut pas à la gare. Je ne voulus pas prendre le train sans lui. S’était-il soulé la gueule dans un bistrot ? Avait-il fui pour ne pas subir le chemin du retour en ma compagnie ? Je le cherchai dans toute la petite ville et finis par échouer, épuisé, affamé, dans un des seuls restaurants ouverts. C’est là que j’entendis qu’un pauvre gars s’était jeté du haut de la falaise, à sept heures du soir.
Edith de Cornulier-Lucinière
Un dimanche de Septembre 2010
Publié dans L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 08 avril 2013
Arts & administration
Et il se demanda pourquoi rien, dans l’administration, ne pouvait être littéraire, pictural ou musical. Tout était glauque, même l’esthétique du pire n’y avait pas sa place, tant l’horreur manquait de grandeur. Il pensa que l’on construit des camps de concentration avec les idées des Droits de l’homme comme avec celles de la Dictature et se demanda où pouvait se loger l’espérance.
Par M.D.
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 06 avril 2013
La belle vie

La gare du RER de Chamallow-sur-Noise l'accueillit : ferraille des rails et des poteaux, béton des quais et des murs, nappes de soleil blanc sur les verrières.
Un garçon de douze ans, châtain aux taches de rousseur, courait, blême. La peur sur son visage, il se retournait, essoufflé. Il repartait de plus belle. La bouche tordue d'angoisse, il luttait pour accélérer.
Derrière lui, riant, une dizaine de garçons noirs le rattrapaient.
-
Ils jouent ? Demanda Pégase à un vieux monsieur qui avançait avec peine, s’appuyant sur une béquille.
L'homme lui sourit sans répondre.
Il lui donnèrent quelques coups de pieds. Il mit la main à sa poche, rapidement, et sortit son téléphone portable qu'il tendit. L'un des assaillants prit le téléphone, les autres lui donnèrent de grandes baffes et des coups de pieds dans les fesses. Il repartit à toute bombe mais les autres ne le suivaient plus.
-
Petite merde ! Petite merde ! Lui criaient-ils.
L'enfant courait.
Pégase dévalait l'escalator. Il attrapa un des grands garçons :
- Comment osez vous, à quinze jeunes hommes, attaquer un enfant ?
Les yeux rieurs se firent ternes. Les bouches se fermèrent. Les joues se durcirent. Les gars se mirent, en silence, autour de Pégase. Soudain, il ne fut plus certain d'avoir eu la bonne réaction.
Son regard chercha un recours.
Les gens entraient et sortaient de la station de RER, sans jeter le moindre regard à leur attroupement.
-
Donnez-moi ce téléphone. Vous l'avez volé.
-
Il nous l'a donné.
-
Quinze contre un !
-
Tu veux passer quelques jours à l'hôpital ? Demanda l'un des hommes.
-
Non. Mais je vous ai vus agresser un enfant et lui voler son portable.
Après un nouveau silence, pesant comme une chape de plomb, le même jeune homme reposa sa question.
-
Tu veux passer quelques jours à l'hôpital ?
-
Non, dit Pégase.
L'indifférence apprêtée des gens qui passaient, le calme impeccable de ces gars le convainquirent que la seule chose à faire était d'éviter l'hôpital, par l’attitude la plus conciliante possible. Il demeura donc debout, calmement, face aux garçons, qu'il compta précisément. Ils étaient quatorze.
Un vieil homme arabe entrait dans la station. Contrairement aux autres passants à qui le petit groupe semblait transparent, il s'arrêta quelques secondes et embrassa la scène du regard.
-
Baisse les yeux, dit-il.
Pégase le regarda ; c'était bien à lui qu'il s'adressait.
Le monsieur mit la main sur son cœur, s'inclina avec un geste d'une dignité infinie :
-
Baissez les yeux, monsieur. Ces jeunes vous laisseront tranquilles si vous cessez de les regarder dans les yeux.
L'homme s'inclina de nouveau et entra dans la station sans plus se retourner.
Pégase furieux observa les adolescents. En demi-cercle face à lui, ils attendaient, pleins de patience et de vigilance.
Pégase baissa les yeux.
Après quelques instants, ils s'en allèrent.
Il garda les yeux vers le bas de longues secondes, releva les yeux et balaya son regard sur la rue. Il suffoquait de rage, de honte, d'indignation. Comme l'enfant, il s'était humilié devant cette bande de brutes.
Il courut vers la rue dans laquelle avait disparu le petit, le chercha à travers les trois énormes tours qui formaient un bloc, autour duquel passaient les voitures. Des milliers d'appartement étaient entreposés là sur des dizaines d'étages. En haut, une femme contemplait le monde depuis sa fenêtre, son bébé dans ses bras. En bas, un vieil homme marchait avec son chien.
Il fit demi-tour et chercha son chemin.
Un texte de M.D
Publié dans La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 03 avril 2013
...pour y entasser un nombre maximal d’êtres humains

A quoi pensaient les architectes des villes nouvelles et des banlieues ? N’habitaient-ils pas dans de magnifiques maisons anciennes, réaménagées de façon contemporaine, avec goût ? N’élevaient-ils pas leurs enfants dans de beaux quartiers où les ruelles anciennes s’ouvrent sur des places élégantes bordées d’églises et de boulangeries aux odeurs frémissantes, où les gens qui marchent dans la rue ne craignent pas les crachats d’individus plantés debout sur le pas des immeubles, où les femmes libres marchent à côté des hommes et conversent, sur des thèmes variés, sans censure ni contrainte, en toute égalité ?
Pourquoi construisaient-ils des halls d’immeubles voués à devenir pissotières ?
Comment imaginaient-ils, confortablement lovés dans leurs beaux fauteuils, ces blocs de béton qui ressemblent à des prisons, ces barres de fer qui rappellent les camps de concentration, ces longs couloirs qui évoquent les abattoirs pour y entasser un nombre maximal d’êtres humains qui ne se ressemblent ni dans leur mode de vie, ni dans leurs aspirations ?
Il y a un mystère des architectes du XXème siècle, un grand mystère qu’il faudra éclaircir un jour. De qui sont-ils les messagers ? Quel art les inspire, quelles écoles les formèrent, quelles politiques les missionnèrent ?
DN Steene
Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 31 mars 2013
J'ose le comparer

«Heureux sans doute l'écrivain qui plait ! Mais c'est lorsqu'il n'a point à rougir de la voie qu'il choisit pour plaire. Autrement, j'ose le comparer aux ministres des honteux plaisirs : ceux qui les emploient et qui aiment leurs services ne les regardent pas moins comme des infâmes.»
Abbé Prévost
Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 28 mars 2013
Nuits du XVII°siècle
La nuit du 23 novembre 1654, Blaise Pascal, traversé d’extase, écrivit : «Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Joie, joie, joie, pleurs de joie !»
La nuit du 10 au 11 novembre 1619, René Descartes méditait, assis auprès d’un poêle ; soudain il eut trois songes, vit sa chambre remplie d’étincelles, se repentit de ses péchés et ouvrit la porte de sa nouvelle vie.
Ce siècle avait vu d'autre nuits de mystérieuse exaltation. La vie de Johannes Keppler fut une suite de nuits assaillies par la soif d’étoiles et de musique. « Je me dois de comprendre, quitte à ne plus dormir », écrivit celui qui ressemblait dès l’enfance à un chien galeux, qui dut se battre pour tirer sa mère d’un procès de sorcellerie, qui écrivit lui-même l’épitaphe qu’il méritait : «Je mesurais les cieux, je mesure à présent les ombres de la Terre. L’esprit était céleste, ci-gît l’ombre du corps».

Publié dans Fragments, La place, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 25 mars 2013
Le relief du Brésil
Un extrait du premier chapitre du livre de Maurice Le Lannou intitulé Le Brésil, et publié pour la première fois en 1955 chez Armand Colin.
« Les cartes portent de vieux noms trompeurs. Ainsi certaines serras qui s'allongent sur des centaines de kilomètres ne sont que les rebords escarpés, taillés à l'emporte-pièce, des chapadas. D'autres ont l'allure plus classique de longues et minces échines qui coupent des horizons tabulaires : ce sont des crêtes de roches dures mises en relief par l'érosion. Mais ces échines rugueuses sont souvent groupées en faisceaux d'arêtes parallèles, supportés par un morceau de socle que des cassures ont élevé au-dessus du plateau fondamental ; de tels groupements peuvent constituer, par leur largeur, des obstacles importants, et portent alors, curieusement, le nom de chapadas (Chapada Diamantina, dans l’État de Bahia) : c'est, dans le vocabulaire géographique, le témoignage que l'immensité prime sur la raideur.
Peu d'horizons tourmentés, au total, dans ces ensembles d'échelles énormes : l'aspect qui s'impose à travers la plus grande partie du Brésil est la surface uniforme, brusquement hérissée d'une échine aiguë et mince, ou bien barrée par une escarpe raide qui mène à un nouveau plateau d'étage supérieur.
Tout change quand le socle subit des modifications substantielles. C'est le cas au Nord du Brésil, où, le long d'un axe à peu près marqué par l'équateur, la table guyano-brésilienne se déprime en un grand fléchissement au creux de quoi coule l'Amazone. Cette immense gouttière est tapissée de terrains tertiaires d'altitude presque partout inférieure à 300m, même au contact de la muraille andine. De part et d'autre de ce golfe, des couches primaires réapparaissent et remontent, vers le nord jusqu'au faîte d'altitude incertaine des frontières guyanaise et vénézuélienne, vers le sud en direction des parties hautes du plateau brésilien. La disposition du réseau hydrographique traduit bien ce gigantesque ensellement qui ouvre sur l'Atlantique des plaines profondes de plus de 3000 km. Elle traduit aussi sur l'accident transversal qui soulève le socle primaire à l'est, le long d'un axe perpendiculaire à l'Amazone et la coupant en aval d'Obidos : le golfe amazonien en est comme étranglé avant son débouché sur l'Océan. Les rapides qui accentuent les cours fluviaux – Tapajos, Xingu, Tocantins – à leur sortie du bouclier ancien sont ainsi rapprochés de la gouttière principale, et cette disposition n'est pas sans gêner la pénétration dans l’État de Para, que par ailleurs son moindre éloignement avantagerait par rapport à l'Amazonie occidentale.
L'enfoncement du bouclier brésilien vers le sud se marque par l'apparition des grandes plaines de la Plata. Mais le Brésil n'a qu'une faible étendue de ces régions basses. C'est seulement à son extrême pointe méridionale, dans l’État de Rio Grande do Sul, que l'altitude s'abaisse notablement. On ne peut pourtant pas encore parler de plaines : le socle, affecté d'ondulations, ne s'enfonce pas beaucoup ; ce sont des collines médiocres, beurrées d'une épaisse couche d'arènes et d'argiles, annonçant seulement les grandes nappes ondulées des prairies de l'Uruguay.
Entre la gouttière amazonienne et les collines du Rio Grande do Sul, le plateau brésilien, solidement entretenu par la constance du socle, n'agence pas partout semblablement ses divers éléments. Au nord du dixième parallèle, les altitudes restent modérées, ne dépassant guère 1000 mètres. Les sommets les plus élevés sont éloignés de l'Océan. Les dénudations ont été relativement peu poussées, et le type de relief le plus répandu est la véritable chapada gréseuse. Cependant, à l'est du méridien de Fortaleza, c'est la pénéplaine cristalline qui apparaît, affectée par un bombement S-N qui constitue, à l'ouest de Recife, les hautes terres de la Borborema (600-400 m). La retombée de ce bombement se fait en pente douce vers l'Atlantique. Sur la surface granitique inclinée posent des tables sédimentaires résiduelles – les taboleiros -, répliques menues des chapadas du versant occidental, mais la plus grande partie de cette région du Nord-Est brésilien est occupée par des collines basses, profondément décomposées, du socle ancien, séparées seulement de la mer par un mince ourlet de plaine littorale. Il y a là, par une heureuse rencontre, une zone aisément accessible et pénétrable, qui est au point le plus rapproché de l'Ancien Monde. Ce sera la première région vivante du Brésil colonial.
Au sud du dixième degré, et jusque vers le vingtième, le relief d'ensemble du plateau, d'altitude plus forte, se dispose en grande alignements S-N. Entre le Tocantins et le Rio Sao Francisco s'allongent, fort mal connus, surtout constitués par des fronts de chapadas gréseuses, des reliefs que les vieilles cartes magnifient sous les noms exagérés d'Espigao Mestre ou Serra Geral de Goias. Entre le Rio Sao Francisco et la mer, ce sont les crêtes et les hauts plateaux de la Serra do Espinhaço et de la Chapada Diamantina, qui atteignent 1400 m dans la première, 1800 m dans la seconde. Un trait essentiel à la construction géographique du Brésil est la vallée du Rio Sao Francisco, laquelle, en arrière des territoires côtiers ensevelis sous la forêt tropicale, ménage une grande voie ouverte entre le vieux Brésil colonial du Nord-Est et les régions élevées plus méridionales qui, au XVIII°siècle, seront le centre de l'activité minière.
Au sud du vingtième parallèle, les directions majeures du relief changent, se disposant du sud-ouest au nord-est, comme la côte elle-même. Les pentes d'ensemble sont au nord-ouest, et elles se lisent dans le dessin du réseau hydrographique. Cependant, à l'est du méridien de Santos, les rivières restent parallèles à la côte, comme ce rio Paraiba qui, allongé sur 600 km des environs de Saint-Paul jusqu'au cap Sao Tomé, et passant seulement à 601 km de Rio, trace entre les deux capitales brésiliennes une route d'importance essentielle. Entre le Paraiba et la mer, la Serra do Mar est un premier bloc cristallin basculé, dont la face abrupte tombe sur l'Océan. Au nord du Paraiba, c'est un autre front qui se présente, celui de la Serra da Mantiqueira, où sont les plus hauts sommets du Brésil (Pico da Bandeira, 2884 m). Ce nouveau bloc est lui aussi dissymétrique, et son revers tombe au nord-ouest en pente douce, par de hautes surfaces ondulées qui se raccordent aux hautes terres du Minas.
À l'ouest du méridien de Santos, il n'y a pas ce morcellement de la masse : le seul front présenté à l'Atlantique est celui de la Serra do Mar, haut de plus de 1000 m, cerné de nuages et vêtu de forets denses, dominant une mince frange de plaines littorales. Sur le revers de cette escarpe brutale, des fleuves nés à quelques dizaines de kilomètres de la mer en font plusieurs centaines pour gagner, rigoureusement parallèles, le grand collecteur du Rio Parana, qui porte ses eaux, par l'intermédiaire du Rio Uruguay, à l'estuaire de la Plata. Au-delà du Parana, qui coule au fond d'une grande gouttière synclinale, les couches sédimentaires masquant le vieux socle se relèvent doucement, et, avec elles, les altitudes. Mais le relief reste calme, et il ne présente d'autre obstacle à la pénétration des hommes vers les plaines du Paraguai et le sud du Mato Grosso que celui de l'immensité ».
Maurice Le Lannou
Le Brésil
Publié dans Fragments, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |