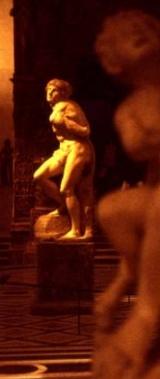dimanche, 22 mai 2011
L'intelligence contre le diplôme
Paul Valéry, en 1936, dans une conférence intitulée le bilan de l’intelligence, livre une critique belle et sévère du diplôme. Voici justement l'extrait qui concerne le diplôme.
Phot. Sara pour VillaBar (on reconnaît Florian Guy)
Je n’hésite jamais à le déclarer, le diplôme est l’ennemi mortel de la culture. Plus les diplômes ont pris d’importance dans la vie (et cette importance n’a fait que croître à cause des circonstances économiques), plus le rendement de l’enseignement a été faible. Plus le contrôle s’est exercé, s’est multiplié, plus les résultats ont été mauvais.
Mauvais par ses effets sur l’esprit public et sur l’esprit tout court. Mauvais parce qu’il crée des espoirs, des illusions de droits acquis. Mauvais par tous les stratagèmes et subterfuges qu’il suggère ; les recommandations, les préparations stratégiques, et, en somme, l’emploi de tous expédients pour franchir le seuil redoutable. C’est là, il faut l’avouer, une étrange et détestable initiation à la vie intellectuelle et civique.
D’ailleurs, si je me fonde sur la seule expérience et si je regarde les effets du contrôle en général, je constate que le contrôle, en toute manière, aboutit à vicier l’action, à la pervertir… Je vous l’ai déjà dit : dès qu’une action est soumise à un contrôle, le but profond de celui qui agit n’est plus l’action même, mais il conçoit d’abord la prévision du contrôle, la mise en échec des moyens de contrôle. Le contrôle des études n’est qu’un cas particulier et une démonstration éclatante de cette observation très générale.
Le diplôme fondamental, chez nous, c’est le baccalauréat. Il a conduit à orienter les études sur un programme strictement défini et en considération d’épreuves qui, avant tout, représentent, pour les examinateurs, les professeurs et les patients, une perte totale, radicale et non compensée, de temps et de travail. Du jour où vous créez un diplôme, un contrôle bien défini, vous voyez aussitôt s’organiser en regard tout un dispositif non moins précis que votre programme, qui a pour but unique de conquérir ce diplôme par tous moyens. Le but de l’enseignement n’étant plus la formation de l’esprit, mais l’acquisition du diplôme, c’est le minimum exigible qui devient l’objet des études. Il ne s’agit plus d’apprendre le latin, ou le grec, ou la géométrie. Il s’agit d’emprunter, et non plus d’acquérir, d’emprunter ce qu’il faut pour passer le baccalauréat.
Ce n’est pas tout. Le diplôme donne à la société un fantôme de garantie, et aux diplômés des fantômes de droits. Le diplômé passe officiellement pour savoir : il garde toute sa vie ce brevet d’une science momentanée et purement expédiente. D’autre part, ce diplômé au nom de la loi est porté à croire qu’on lui doit quelque chose. Jamais convention plus néfaste à tout le monde, à l’Etat et aux individus (et, en particulier, à la culture), n’a été instituée. C’est en considération du diplôme, par exemple, que l’on a vu se substituer à la lecture des auteurs l’usage des résumés, des manuels, des comprimés de science extravagants, les recueils de questions et de réponses toutes faites, extraits et autres abominations. Il en résulte que plus rien dans cette culture adultérée ne peut aider ni convenir à la vie d’un esprit qui se développe.
Paul Valéry, in Le Bilan de l’intelligence, 1935
Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 16 mai 2011
La ville des écrivains

"Sur la littérature universelle plane un nuage d'alcool".
Michael Krüger
"L'abus d'alcool est dangereux ; consommez avec modération".
Loi Evin
Voici un billet d'Edith, qui a répondu à son tour aux questions d'une interview du journaliste de pop/rock/punk/techno musiques Jon Savage
What was your favourite childhood book?
Les maisons de Dame Souris, de Smith & Mendoza
Which book has made you laugh?
Les palmes de monsieur Schütz, de J-N Fenwick
Which book has made you cry?
Lova, la BD de Servais
Which book would you never have on your bookshelf?
Aucun. Tous les livres, les bons et les méchants, sont les bienvenus sur mes étagères.
Which book are you reading at the moment?
Machine Soul, de Jon Savage
Which book would you give to a friend as a present?
Propaganda, de Bernays, préfacé par Baillargeon, ou Les derniers géants de François Place
Which other writers do you admire?
Truman Capote, Carson McCullers, Thomas Mann, Tolstoï, Paul d'Ivoi, Paul Féval, Jean de La Ville de Mirmonts.
Which classic have you always meant to read and never got round to it?
Dostoïevski et Gogol
What are your top five books of all time, in order or otherwise?
Guerre et Paix, de Tolstoï
Les 7 piliers de la sagesse, de T.E. Lawrence
Le pays où l'on n'arrive jamais, d'André Dhôtel
La balade de la mer salée, de Hugo Pratt
Nolimé Tangéré, de Béja et Nataël
What is the worst book you have ever read?
Le journal d'Anne Frank
Is there a particular book or author that inspired you to be a writer?
La comtesse de Ségur ; Sans Famille, d'Hector Malo ; Bandini, de John Fante
What is your favourite time of day to write?
A l'heure où l'heure s'efface et qu'il ne reste que la flottaison dans l'espace.
And favourite place?
Dans le halo de lumière du jour qui a pénétré dans la pièce
Longhand or word processor?
N'importe
Which fictional character would you most like to have met?
J'hésite entre Arsène Lupin et Sir Jerry. Auraient-ils été gentils avec moi ?
Who, in your opinion, is the greatest writer of all time?
Saint Jean, l'Aigle ? Ruteboeuf ?
Which book have you found yourself unable to finish?
La guerre du Pélopponèse, ce que je regrette.
What is your favourite word?
Aurore
Other than writing, what other jobs or professions have you undertaken or considered?
Aviatrice, tenancière de bar.
What was the first piece you ever had in print?
Un conte de Noël, quand j'avais 13 ans, dans un journal des enfants du groupe où travaillait ma mère.
Adulte, un documentaire sur les langues pour les 9/13 ans
What are you working on at the moment?
Un roman qui ressemble à ce qu'on écrira quand la littérature aura changé de forme
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 07 mai 2011
Tango & tao pour un printemps
Iwan Harlan et Isabella Cremer tanguent au rythme d'une chanson du musicien poète argentin Daniel Melingo.
Yogas, porte de la sagesse : un livre du Britannique John Blofeld, publié aux belles éditions Dervy en 1986 (6 ans après sa sortie en langue anglaise). John Blofeld écrit bien, admirablement suivi sur ce point par son traductreur Pierre Dupin. Voilà qu'il nous explique la disposition d'esprit idéale du taoïste. Cette description rappelle un peu le stoïcisme grec ou encore un texte comme l'Imitation de Jésus Christ. Blofeld, lui, trouve que les idées du philosophe américain Ralph Waldo Emerson ressemblent à celles des sages taoïstes qu'il a rencontrés.
"L'adepte taoïste arrive à ressembler aux Trois Amis de l'Hiver. Comme le pin, il peut espérer parvenir à une bonne longévité. Comme le prunier d'hiver avec ses pétales pourpres miroitant sur la neige, il fleurit dans l'adversité, sereinement imperturbable au froid et à un environnement hostile. Comme le bambou, il est à la fois si fort et si flexible qu'il se courbe sans effort devant le souffle passager des circonstances et, loin d'en être brisé, il se redresse avec une élasticité sans égale".
"Être tendu, rigide, raide, désobligeant, guindé dans le comportement et les opinions, bigot, sans humour, vite offensé, facilement déconcerté, vite déprimé, ravagé d'inquiétude, aller se lamentant, accablé par l'adversité - tout cela est le contraire des qualités taoïstes. Les gens qui s'enorgueillissent de savoir nager à contre-courant, de graver contre le grain du matériau, ne feront jamais de bons taoïstes s'ils ne changent pas de disposition d'esprit. Le taoïste conserve son état énergie en s'accordant et en s'adaptant à chaque situation. Il peut avoir une volonté aussi forte que le courant d'un torrent de montagne, cela ne l'amène pas pour autant à pousser inutilement sur des obstacles infranchissables qui peuvent être facilement contournés d'une autre manière. Comme il se moque de ce qu'on peut penser de lui, il ne tire pas gloire de l'héroïsme, cherchant donc les voies les plus faciles. Ce n'est pas qu'il renonce facilement à un objectif, mais il ne cherchera pas l'impossible et ne dépensera pas plus d'énergie qu'il n'en faut exactement pour parvenir à ce qui est possible. Loin d'être paresseux, il économise ses pouvoirs afin de les utiliser au maximum".
John Blofeld
Publié dans Clair-obscur, Fragments | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 30 avril 2011
Voyageurs, sédentaires, nous partirons tous un jour

photo de Sara
La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence.
Miles Davis
« Nous ne croyons pas que réussir sa vie c’est se marier, avoir des enfants, gagner de l’argent, être député, écrire des livres célèbres ; nous savons que réussir sa vie c’est quelquefois être jugé comme un inutile parce qu’on ne sait pas arriver à ces choses ; réussir sa vie c’est souvent mourir dépouillé de tout, être jugé comme un échec vivant, ...tel le Christ à l’heure de sa mort. »
Philippe Ariès
Nous n'avions peur de rien, ni des loups, ni du vide, pas même des chauves-souris gantées et casquées, qui chaviraient leurs coeurs suspendus dans l'aube naissante des sagas hivernales.
Hanno Buddenbrook
Publié dans L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 28 avril 2011
Les vieux écrivains (L’hypocrisie et la lâcheté)
Depuis le 8 avril il ne se passait plus rien sur l'AlmaSoror blog. Nous en demandons pardon à ceux qui viennent souvent ici, cueillir des fleurs. Nous avons été occupés, surtout moi, Edith, occupés par des activités qui nous laissaient trop peu d'espace mental pour venir faire la cuisine d'AlmaSoror.

Voici, présente et proposé par Sara, un texte de Piotr Rawic, écrivain qui détesta Mai 68 et raconte une scène 68arde qui ne manque pas de piquant. Un écrivain regrette que le Louvre n'ait pas été fracassé par les Révolutionnaires !
L’hypocrisie et la lâcheté
L’auteur avoue dans une post-face qu’il n’est pas “contre-révolutionnaire” mais se contente de rapporter des propos critiques ou moqueurs de ses amis sur les événements de mai 1968 au moment où ils le vivaient.
Peu sympathique, ambigu et mal écrit, ce livre est cependant intéressant puisqu’il donne les points de vue d’intellectuels parisiens tels qu’ils les exprimaient en privé. C’est rare.

Récit de X. :
“Littérature et Révolution” à la nouvelle Faculté de médecine, le 27 juin au soir :
Que de mesquineries, que d’ambitions non assouvies, que de demi-gloires qui n’aspirent qu’à devenir gloires “à part entière” fût-ce grâce à des soirées de cette sorte !
- Une dame fanée, parée de fleurs fanées, déguisée en fleur fanée invoque sa participation à la “prise” de l’hôtel Massa comme un acte d’héroïsme révolutionnaire ;
- un représentant connu du “nouveau roman” se prévaut des “coups de pied au cul” reçus à l’âge de seize ans d’un patron fasciste et de la modicité de ses droits d’auteur (“inférieurs à ce que vous autres les étudiants gagnerez dans quelques années quand vous serez médecins”) et se justifie, s’excuse humblement d’être le propriétaire d’une petite voiture ; un prix Goncourt pousse des hurlements car, dans cette salle, toute banalité devient “révolutionnaire” à condition d’être accompagnée de puissants effets acoustiques ;
- une vieille dame, présentée comme critique littéraire, n’oublie pas de souligner qu’elle écrit “aussi” des poèmes ;
- une autre dame âgée ( la plus convenable et la plus lucide de toutes) souligne avec volupté que “nous autres, les vieux, nous n’avons rien à vous apprendre, car toutes nos révolutions ont été loupées...”
Du côté des jeunes on use et on abuse du langage ordurier :
- Tais-toi, vieux con ! Tu as été dans la Résistance, à ce que tu dis... On s’en fout !
Messieurs les écrivains font de la lèche. Ils cherchent à imiter le langage “vigoureux” des étudiants. Des deux côtés, les mots “révolution” et “socialisme” sont maniés comme si leur signification était claire et concrète. Comme s’ils recouvraient un espace sémantique, un contenu humain bien connus et bien déterminés. Un vieux monsieur qui ose rappeler les assassinats d’écrivains commis après Octobre, au nom du socialisme, se fait traiter de “contre-révolutionnaire”... sans aucune aménité.
Il y aurait pour un sociologue (si cette engeance survit) une étude à faire sur les rapports entre les “révolutions” et les effets acoustiques.
M.S. (soixante ans, lunettes cerclées de métal, vétéran du mouvement trotskiste ; sa pomme d’Adam ne cesse de bouger ce qui met en évidence sa maigreur surnaturelle) :
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de morts (sauf quelques accidents) ni de vraies destructions. La Sorbonne, Notre-Dame, le Louvre sont toujours debout...
Eh bien, la foi de ceux qui combattaient n’était pas assez forte. J’aurais été désolé, bien sûr, pour le Louvre. J’y passe mes dimanches. Mais la faiblesse de la foi est mauvais signe. C’est le signe de la dégénérescence...”
Bloc-notes d’un contre-révolutionnaire ou la gueule de bois, de Piotr Rawicz (pour voir qui est cet écrivain : http://www.fundacioars.org/dictionnaire/rawicz.html), Gallimard, 1969
Sara (billet et photos)
Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 08 avril 2011
parfois j'ai prié

Phot Anglet, par Sara
"j'ai toujours accepté de combattre, dans la solitude et dans l'échec, dans le rêve et la douleur, dans la joie et la réussite. J'ai toujours choisi de combattre et vivre libre. Il s'agissait de sauver ma tête, sauver mon coeur, sauver mon corps, sauver mon âme. J'ai fui le salariat au risque de devenir la lèpre de la société. Car, comme le servage et l'esclavage, le salariat n'est point digne de l'homme. J'ai repoussé avec violence les médias qui prostituaient leurs espaces à la publicité ; je me suis tenue éloignée de tout supermarché, de toute multinationale, de toute usure. J'ai chômé le dimanche, et parfois j'ai prié. J'ai combattu. Je ne dirai plus rien. J'ai tout dit".
Venexiana Atlantica
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 05 avril 2011
Internet et le bain qui coule
Phot. Mavra Nicolaïevna Novogrochneïeva
(Un billet de Katharina F-B)
Le principal impact d’Internet dans ma vie (outre la découverte de langues (apprentissage inachevé du maori), d’univers musicaux, d’idées politiques, la plongée dans la littérature mondiale, la possibilité de créer et diffuser un journal, l’aventure de la rencontre virtuelle avec des centaines d’inconnus, l’étonnement face à la liberté d’expression et aux censures), a été la réduction subjective du temps que l’eau met à couler dans ma baignoire.
Auparavant, je vaquais à mes occupations, et encore aujourd’hui, lorsque l’ordinateur est éteint, j’erre, effectue diverses tâches, pour aller sans cesse constater que la baignoire est à moitié vide. Mais, si j’ouvre le robinet pour aller me réinstaller face à mon ordinateur et naviguer sur Internet, alors, quelques espaces-temps plus tard, je cours à la salle de bains pour éteindre l’eau juste à temps !
Katharina Flunch-Barrows
| Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 02 avril 2011
La traque
Publié dans Clair-obscur | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 30 mars 2011
Le désillusionné

Photo de Sara
Lorsque mourut Abderrahman III, qui détint le pouvoir en Espagne pendant un demi-siècle (Xème siècle) et construisit l'admirable palais d'Az-Zahra, on trouva parmi ses papiers, une note portant ses mots : "Cinquante ans se sont écoulés depuis que je suis Calife. Trésors, honneurs, plaisirs, j'ai joui de tout, j'ai tout épuisé. Les rois mes rivaux m'estiment, me redoutent et m'envient. Tout ce que les hommes désirent m'a été accordé par le ciel. Dans ce long espace d'apparente félicité, j'ai calculé le nombre de jours où je me suis trouvé heureux : ce nombre se monte à quatorze. Mortels, appréciez par là, la grandeur, le monde et la vie..."
Cité par J Benoist-Méchin, dans sa biographie d'Ibn Séoud
Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 27 mars 2011
Feu
Publié dans Clair-obscur, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 24 mars 2011
Voyages
Avant le départ
Le voyage
Arrêt au bord de la ville-océan
Publié dans Clair-obscur | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 21 mars 2011
L’invasion de l’Europe (années 700)

Jacques Benoist-Méchin conte l'invasion islamique des années 700, épopée spectaculaire qui s'arrêta par une débâcle en plein Poitou,
en 732.
« Le successeur de Hassan, Mousa-Ibn-Noseïr, fut une des plus grandes figures de l’épopée islamique. Rompant avec la politique de son prédécesseur, il se rallia les Maures vaincus, et sut leur inspirer confiance par ses mesures de clémence. Il les attira auprès de lui, les incorpora à ses troupes et les invita « à le suivre où il les conduirait » (709).
En agissant ainsi, Mousa travaillait à la réalisation d’un plan qui mûrissait depuis longtemps dans son esprit. Face à la côte africaine, il voyait se déployer à l’horizon un autre littoral qui exerçait sur lui une fascination étrange. C’était l’Espagne. Comme les voyageurs ne cessaient de lui vanter l’opulence de ses villes, l’enchantement de ses jardins et la fertilité de ses plaines, il résolut de s’en emparer.
Ayant obtenu l’autorisation de Walid, Mousa accéléra ses préparatifs. Mais le fils de Noseïr était un homme prudent. Ne voulant pas engager ses meilleures troupes dans une entreprise qui comportait beaucoup d’aléas, il décida d’envoyer en avant-garde ses régiments maures, sous le commandement de leur chef, Tarik. Celui-ci franchit le détroit de Calpé, débarqua sur la côte espagnole et dressa son camp au pied d’une falaise abrupte qu’il baptisa Djebel-al-Tarik (Gibraltar). Puis, ayant passé une dernière fois ses hommes en revue, il brûla ses embarcations pour leur montrer que l’aventure dans laquelle il s’engageait était sans retour, et s’enfonça vers l’intérieur du pays (710).
Les Wisigoths, qui occupaient à cette époque la péninsule ibérique avaient beaucoup perdu de leur vigueur primitive. Leur roi Roderic était un prince raffiné, d’une grande élévation d’esprit, mais émasculé par la mollesse et le luxe de sa cour. « Ses vêtements couverts d’or, son char d’ivoire, sa selle tout incrustée de pierreries cachaient sous leur éclat le fer, qui seul, en ce moment, avait de la valeur. Les nobles qui l’entouraient, équipés magnifiquement, se fiaient bien moins à leur courage qu’au nombre de leurs soldats, esclaves embrigadés de force qui ne combattaient qu’à contre-cœur. En face d’eux, les Berbères, commandés par un chef intelligent et prêts à accepter la mort comme un bienfait, puisqu’elle devait leur assurer le ciel, semblaient avoir oublié leur infériorité numérique. » (Sédillot)
Le choc décisif eut lieu dans la plaine de Guadalete, non loin de Xérès. Pendant sept jours, les deux armées s’épuisèrent en escarmouches et en combats singuliers. Enfin Tarik, voulant forcer le destin, chargea impétueusement les Wisigoths à la tête de sa cavalerie et réussit à couper les forces ennemies en plusieurs tronçons. Aussitôt, les Wisigoths commencèrent à perdre pied. Les voyant se débander, l’évêque de Séville et les troupes qu’il commandait, se rangèrent du côté de l’envahisseur. Roderic, trahi, chercha en vain à rallier ses escadrons qui fuyaient de tous côtés. Il fut entraîné dans la déroute générale et périt dans les eaux du Guadalquivir (711).
Tarik sut exploiter à fond cette éclatante victoire. Il fonça sur Tolède, la capitale du royaume, après s’être emparé d’Ecija, de Malaga, d’Elvira, de Grenade et de Cordoue. Tolède, privée de défenseurs, capitula. Tarik poursuivit sa marche vers le nord et parvint, par Saragosse et Pampelune, jusqu’à Giron, sur le golfe de Biscaye.
Mousa, ne voulant pas laisser à son lieutenant tout le bénéfice de cette campagne, se hâta de traverser à son tour le détroit de Gibraltar et pénétra en Andalousie, qui n’était pas encore entièrement subjuguée. Ayant pris Mérida, Carmona et Séville, il alla rejoindre Tarik à Tolède, tandis que son jeune fils Abdelaziz, qui avait amené d’Afrique un renfort de 7000 hommes, se rendait maître de la Lusitanie et de l’Estrémature.
Toute l’Espagne était aux mains de l’Islam. Cette proie splendide fut partagée entre les légions victorieuses. La légion de Damas s’établit à Cordoue ; celle d’Emèse, à Séville ; celle de Kinnesrin (Chalcis), à Jaen ; celle de Palestine, à Médina-Sidonia et à Algéziras ; celle de Perse, à Xérès de la Frontera ; celle de l’Yémèn, à Tolède ; celle de l’Irak, à Grenade ; celle d’Egypte, à Murcie et à Lisbonne. Enfin, 10 000 cavaliers du Nedjed et du Hedjaz se virent attribuer les plaines les plus fertiles de l’intérieur. On eût dit qu’une « Arabie nouvelle », avec toutes ses provinces, s’était constituée derrière les colonnes d’Hercule, à cette pointe extrême du Ponant.
Mais pour Mousa, la conquête de l’Espagne n’était qu’un commencement. Remettant à son fils Abdelaziz le soin d’administrer le pays et laissant en arrière des garnisons suffisantes pour y assurer l’ordre, il partit pour le nord avec le reste de ses troupes. Lorsqu’il fut parvenu au sommet des Pyrénées et qu’il vit se déployer à ses pieds les riches plaines de la Narbonnaise, Mousa « suspendu sur l’Europe » conçut un plan grandiose : il décida de rejoindre le Bosphore par la voie de terre et de prendre Constantinople de revers, en subjuguant tous les peuples qu’il rencontrerait sur sa route. Ce projet lui était inspiré « par un orgueil démesuré et par son vieil instinct nomade, pour qui les distances ne comptent pas ».
Il détacha une avant-garde, sous le commandement de l’Emir Alsamah, et lui enjoignit de conquérir la Septimanie. Narbonne fut occupée en 719. Alsamah ayant été tué au cours d’un combat, son successeur Ambizah s’empara de Carcassonne, d’Adge, de Béziers et de Nîmes, mais se heurta à une résistance vigoureuse d’Eudes, duc d’Aquitaine, qui lui interdit l’accès de Toulouse (721). Ambizah et ses cavaliers s’infléchirent alors vers la vallée du Rhône, qu’ils remontèrent pas étapes. L’Albigeois, le Rouergue, le Gévaudan, le Velay subirent leurs déprédations. Poursuivant leur avance le long de la Saône, les forces musulmanes parvinrent en Bourgogne. Beaune fut prise et ravagée. Sens se racheta par un tribut. Autun fut enlevé d’assaut et pillé (725). Auxerre faillit connaître le même sort. Les Arabes campèrent dans les vallées de l’Aube et de l’Absinthe à peu près là où devait s’élever plus tard l’abbaye de Clairvaux. Troyes barricada ses portes, en prévision d’un siège.
Ces opérations coïncidèrent avec un débarquement effectué par la flotte sarrazine dans la région de Fréjus (Fraxinet). Les escadrons musulmans s’installèrent en force dans le massif dit des Maures. De là, ils rayonnèrent jusqu’en Provence, où ils occupèrent Arles et Avignon (730).
Enhardi par ces succès, Mousa ordonna à un autre de ses généraux, l’Emir Abderrahman, de conquérir le reste de la Gaule. A la tête d’une armée nombreuse, Abderrahman franchit le col de Puygcerda. Cette fois-ci, le duc d’Aquitaine ne put résister à l’envahisseur. Battu sur les bords de la Garonne, Eudes dut se replier en toute hâte vers le nord-est, ouvrant aux Arabes la route de Bordeaux, qui fut emportée d’assaut. Abderrahman, vainqueur de nouveau au passage de la Dordogne, se dirigea vers Tours, dans l’intention de s’emparer de l’Abbaye de Saint-Martin, qui était, à cette époque, le sanctuaire national des Francs.
La nouvelle de l’arrivée des Arabes sur les bords de la Loire, souleva, dans toute la Gaule, une émotion indescriptible. L’Europe allait-elle devenir musulmane ? Charles, fils de Pépin d’Héristal, que soutenait la fortune ascendante de sa famille, résolut de sauver la Chrétienté menacée. Il appela les Leudes aux armes, convoqua le ban et l’arrière-ban des guerriers francs et meusiens. Tous les hommes en état de se battre répondirent à son appel. Abderrahman décrocha de la Loire et attendit son ennemi à Vouillé, entre Tours et Poitiers. C’est là qu’allait se décider le sort de l’Occident (732).
« Les Arabes comptaient sur une seconde bataille de Xérès, et furent déçus dans leurs espérances. Les Francs austrasiens ne ressemblaient pas aux Wisigoths dégénérés. Ils ne portaient point d’or sur leurs vêtements et se présentaient au combat tout bardés de fer. Là, point d’esclaves combattant pour un maître détesté, mais des compagnons entourant un chef qui se disait leur égal. Pendant les six premiers jours, il n’y eut que des engagements partiels, où les musulmans eurent l’avantage. Le septième, l’action devint générale ; elle fut sanglante et solennelle. Les Arabes, accablés par la force et la stature des Francs, furent mis en déroute par l’impétuosité de Charles, qui gagne dans cette batille le nom de Martel » (Sédillot).
Abderrahman fut tué au cours de la mêlée. Dans la nuit qui suivit, les Arabes, privés de leur chef, perdus dans un pays qu’ils ne connaissaient pas, furent pris de panique et se querellèrent entre eux. On vit alors, dans les clairières du Poitou, les tribus du Hedjaz, de l’Yémen et du Nedjd tourner leurs armes les uns contre les autres et s’entredéchirer avec fureur. L’armée se volatilisa sous l’effet du désastre. Ses débris se replièrent péniblement vers la Septimanie, harcelés par Charles Martel et son frère Childebrand. Ils ne se retrouvèrent en sûreté que derrière les remparts de Narbonne et de Carcassonne.
Stoppée en Occident par la victoire de Charles Martel, bloquée devant Byzance par la résistance de Léon III et de Justinien II, l’expansion arabe avait atteint en 743, des limites qu’elle ne dépasserait plus. Grâce à la force des Francs et à la ténacité des Grecs, l’Europe devait rester en dehors de son emprise. Mais la domination musulmane ne s’en étendait pas moins de Narbonne à Kashgar ; et le Calife, « cette image de la divinité sur terre » se trouvait à la tête d’un empire plus vaste que ceux de Darius ou d’Alexandre le Grand.
Jamais entreprise aussi considérable n’avait été réalisée en un aussi petit laps de temps, et les chroniqueurs de l’époque n’eurent pas tort de la comparer à une tempête. Plus de douze mille kilomètres séparaient les positions extrêmes occupées par les Arabes en Orient et en Occident. Pourtant il ne s’était écoulé que cent vingt-deux ans depuis le serment d’Akaba, c’est-à-dire depuis le jour où, rassemblant autour de lui une quarantaine de guerriers, Mahomet avait constitué le noyau initial des armées islamiques ».
Jacques Benoist-Méchin, Ibn Séoud ou la naissance d’un royaume.

Beaune floue depuis un téléphone androïde, par une fin d'après-midi en 2010
Publié dans Fragments, La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 20 mars 2011
Magie de Crin Blanc
Et une petite explication sur ce magnifique film-livre
Publié dans Clair-obscur, Le corps, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 18 mars 2011
extrait d'un manifeste contre le travail II

Que le travail et l'asservissement soient identiques, voilà ce qui se laisse démontrer non seulement empiriquement, mais aussi conceptuellement. Il y a encore quelques siècles, les hommes étaient conscients du lien entre travail et contrainte sociale. Dans la plupart des langues européennes, le concept de "travail" ne se réfère à l'origine qu'à l'activité des hommes asservis, dépendants : les serfs ou les esclaves. Dans les langues germaniques, le mot désigne la corvée d'un enfant devenu serf parce qu'il est orphelin. Laboraresignifie en latin quelque chose comme "chanceler sous le poids d'un fardeau", et désigne plus communément la souffrance et le labeur harassant des esclaves. Dans les langues romanes, des mots tels que travail, trabajo,etc., viennent du latin tripalium,une sorte de joug utilisé pour torturer et punir les esclaves et les autres hommes non libres. On trouve un écho de cette signification dans l'expression "joug du travail".
Même par son étymologie, le "travail" n'est donc pas synonyme d'activité humaine autodéterminée, mais renvoie à une destinée sociale malheureuse. C'est l'activité de ceux qui ont perdu leur liberté. L'extension du travail à tous les membres de la société n'est par conséquent que la généralisation de la dépendance servile, de même que l'adoration moderne du travail ne représente que l'exaltation quasi religieuse de cette situation.
Ce lien a pu être refoulé avec succès et l'exigence sociale qu'il représente a pu être intériorisée, parce que la généralisation du travail est allée de pair avec son "objectivation" par le système de production marchande moderne : la plupart des hommes ne sont plus sous le knout d'un seigneur incarné dans un individu. La dépendance sociale est devenue une structure systémique abstraite - et justement par là totale. On la ressent partout, et c'est pour cette raison même qu'elle est à peine saisissable. Là où chacun est esclave, chacun est en même temps son propre maître — son propre négrier et son propre surveillant. Et chacun d'obéir à l'idole invisible du système, au "grand frère" de la valorisation du capital qui l'a envoyé sous le tripalium.
Le site source : http://kropot.free.fr/manifestevstrav.htm
Publié dans La place, Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 15 mars 2011
extrait d'un manifeste contre le travail

Nous (Axel) présentons un extrait du manifeste contre le travail publié par le site anarchiste Kropot.
"Autrefois, les hommes travaillaient pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, l'État ne regarde pas à la dépense pour que des centaines de milliers d'hommes et de femmes simulent le travail disparu dans d'étranges "ateliers de formation" ou "entreprises d'insertion" afin de garder la forme pour des "emplois" qu'ils n'auront jamais. On invente toujours des "mesures" nouvelles et encore plus stupides simplement pour maintenir l'illusion que la machine sociale, qui tourne à vide, peut continuer à fonctionner indéfiniment. Plus la contrainte du travail devient absurde, plus on doit nous bourrer le crâne avec l'idée que la moindre demi-baguette se paie. À cet égard, le New Labour et ses imitateurs partout dans le monde montrent qu'ils sont tout à fait en phase avec le modèle néo-libéral de sélection
sociale. En simulant "l'emploi" et en faisant miroiter un futur positif de la société de travail, on crée la légitimation morale nécessaire pour sévir encore plus durement contre les chômeurs et ceux qui refusent de travailler. En même temps, la contrainte au travail imposée par l'État, les subventions salariales et la fameuse " économie solidaire " abaissent toujours plus le coût du travail. On encourage ainsi massivement le secteur foisonnant des bas salaires et du working poor.
La "politique active de l'emploi" prônée par le New Labour n'épargne personne, ni les malades chroniques ni les mères célibataires avec enfants en bas âge. Pour ceux qui perçoivent des aides publiques, l'étau des autorités ne se desserre qu'au moment où leur cadavre repose à la morgue. Tant d'insistance n'a qu'un sens : dissuader le maximum de gens de réclamer à l'État le moindre subside et montrer aux exclus des instruments de torture tellement répugnants qu'en comparaison le boulot le plus misérable doit leur paraître désirable.
Officiellement, l'État paternaliste ne brandit jamais son fouet que par amour et pour éduquer sévèrement ses enfants, traités de "feignants", au nom de leur développement personnel. En réalité, ces mesures "pédagogiques" ont un seul et unique but : chasser de la maison le quémandeur à coups de pied aux fesses. Quel autre sens pourrait avoir le fait de forcer les chômeurs à ramasser des asperges? Là, ils doivent chasser les saisonniers polonais qui n'acceptent ces salaires de misère que parce que le taux de change leur permet de les transformer en un revenu acceptable dans leur pays. Cette mesure n'aide pas le travailleur forcé, ni ne lui ouvre aucune "perspective d'emploi". Et pour les cultivateurs, les diplômés et les ouvriers qualifiés aigris qu'on a eu la bonté de leur envoyer ne sont qu'une source de tracas. Mais quand, après douze heures de travail sur le sol de la patrie, l'idée imbécile d'ouvrir, faute de mieux, une pizzéria ambulante paraît nimbée d'une lumière plus agréable, alors l'"aide à la flexibilisation" a atteint le résultat néo-britannique escompté.
" N'importe quel travail vaut mieux que pas de travail du tout. "
Bill Clinton, 1998
" Il n'y a pas de boulot plus dur que de ne pas en avoir du tout. "
Slogan d'une affiche d'exposition de l'Office du pacte de coordination des
initiatives de chômeurs en Allemagne, 1998
" L'engagement civique doit être récompensé et non pas rémunéré. [.] Celui
qui pratique l'engagement civique perd aussi la souillure d'être chômeur et
de toucher une aide sociale.
Ulrich Beck, l'Âme de la démocratie,1997"
Ce n'était qu'un infime extrait portant sur cette ignominie de forcer les chômeurs à "travailler", c'est à dire à prouver qu'ils acceptent inconditionnellement le projet que la société a pour eux.
(note d'Axel Randers)
Le texte intégral est sur Le site Kropot
Publié dans La place, Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |