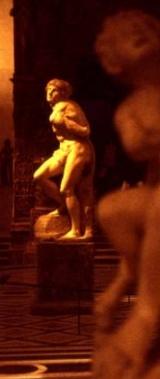samedi, 05 septembre 2009
Attendre que la Nuit...
Attendre que la Nuit, toujours reconnaissable
A sa grande altitude où n’atteint pas le vent,
Mais le malheur des hommes,
Vienne allumer ses feux intimes et tremblants
Et dépose sans bruit ses barques de pêcheurs,
Ses lanternes de bord que le ciel a bercées,
Ses filets étoilés dans notre âme élargie,
Attendre qu’elle trouve en nous sa confidente
Grâce à mille reflets et secrets mouvements
Et qu’elle nous attire à ses mains de fourrure,
Nous les enfants perdus, maltraités par le jour
Et la grande lumière,
Ramassés par la Nuit poreuse et pénétrante,
Plus sûre qu’un lit sûr sous un toit familier,
C’est l’abri murmurant qui nous tient compagnie,
C’est la couche où poser la tête qui déjà
Commence à graviter,
A s’étoiler en nous, à trouver son chemin.
Jules Supervielle
| Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 04 septembre 2009
La formation de la société européenne
L’Europe peut être une société traditionnelle d’avenir
photo Sara
EDITO - L’Europe peut être une société traditionnelle d’avenir, dont le peuple est l’élite, et dans laquelle la ociété repose sur un socle commun. L’Europe peut être une société traditionnelle d’avenir dont les citoyens connaissent, comprennent, ont l’intelligence de toute la société au niveau de sa complexité. Mais la formation qu’une telle exigence requiert est un défi presque impossible...
Les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes
Dans une société traditionnelle, chacun connaît les rouages de toutes les activités, la composition de tous les objets. L’être humain sait de quoi est constitué chaque pan de sa maison, il sait comment chaque chose a été fabriquée.
Dans une société moderne, l’environnement matériel est si complexe que l’individu ne connaît que l’apparence des choses. Il ne sait pas précisément de quoi est composé la sauce qu’il met dans son plat ; il ne comprend pas comment le conservateur a été inséré dans les pâtes, ni de quoi est fait le plastic du paquet. S’il allume son ordinateur et peut faire jouer de la musique ou jouer en ligne à un jeu vidéo, il est hors d’état de décrire tant l’objet ordinateur lui-même que le système de la Toile ou encore quelle est la matérialité de la musique qu’il entend et qu’il ne voit que sous forme de signe sur l’écran.
Ces sociétés reflètent donc deux sortes d’intelligence. D’une part l’intelligence globale, qui est celle de la société traditionnelle, et qui fait de chacun de ses membres un être complet et autonome, habité de toute sa culture et capable de la transmettre entièrement. D’un autre côté, l’intelligence éclatée, disséminée parmi les humains qui composent la société et qui seraient incapables de recréer leur monde ailleurs. Bien entendu, entre les deux modèles il y a sans doute un milieu, qui allie les deux intelligences sans épouser leurs limites.
Le défi européen
Le défi, justement, pour l’Europe, est de créer des citoyens qui connaissent, comprennent, ont l’intelligence de toute leur société au niveau de sa complexité. Mais la formation qu’une telle exigence requiert est un défi presque impossible.
Nous devons pourtant relever ce défi : nous le devons absolument, car c’est ainsi seulement que nous pourrons faire cohabiter les deux créations occidentales : la technique et la démocratie.
La dérive, c’est la réduction de ces deux créations à la troisième, néfaste : le consumérisme. Le citoyen qui ne connaît que les manettes extérieures des machines, les slogans pré mâchés des idées, n’est qu’un consommateur. Il consomme sa citoyenneté, et par là même il l’annihile.
Celui qui connaît le fonctionnement intrinsèque des choses, physiques et intellectuelles, de son environnement, celui-là créée et recrée le monde, le nourrit et s’en nourrit, à chaque acte, à chaque parole. Celui-là est le créateur conscient de la société dans laquelle il vit. En cela il lui permet de durer plus longtemps. Il l’a intégrée dans ses fondements, ce qui ne l’empêche pas – au contraire – de la critiquer.
Le peuple peut être l’élite...
Les élites et les peuples
Une éducation citoyenne réussie donne à chacun une confiance dans sa valeur et dans celle de l’autre. La société démocratique est réussie si elle donne à chacun, à tous les gens d’Europe, les moyens de vivre, d’être heureux, de jouer un rôle positif dans la société et d’y inscrire le parcours individuel de leur choix.
Cette exigence fait que les Grecs, et Rousseau après eux, estimaient qu’une démocratie ne fonctionne bien que lorsqu’elle concerne des communautés petites et homogènes. Là seulement tous sont citoyens, tous sont capables de l’être. Pourtant, il faudra relever le défi dans une société immense et hétérogène, la société européenne.
Si nous ne faisons pas cela, nous aurons deux peuples d’Europe : une aristocratie transeuropéenne, et le peuple, composé des peuples d’Europe… Outre le fait que cette situation ne satisfait a priori pas nos valeurs, il est fort douteux qu’une telle société puisse pérenniser : en effet, si le sentiment qu’il n’y a pas de place au soleil pour tout le monde domine, alors la société ne sera pas défendue par la majorité, et elle ne perdurera pas. Une fracture sociale, c’est la mort. Grâce à une éducation gratuite d’excellence pour une société sans caste, l’Europe sera digne de ses citoyens, et ses citoyens seront à même de la rendre paisible et riche. Seules les sociétés qui échouent à former leurs citoyens ont besoin d’une élite.
Education et responsabilité pour un projet commun
Plus nous sommes éduqués, plus nous avons de libertés, et plus sommes en mesure de les conserver. Nous devenons responsables. Sans responsabilité intrinsèque à chaque citoyen et aux relations qui les unissent, alors, d’une part le public détruira le privé (hyperprésence des acteurs sociaux, réglementation à outrance pour pallier aux aberrations et aux plaintes), et d’autre part, les replis communautaires, qui s’installent forcément dans un espace vidé du principe d’universalité, figeront les identités, et par là, détruiront la liberté d’expression et de développement. Alors la démocratie tournera à l’ochlocratie. L’ochlocratie (le pouvoir de la foule) s'oppose à la démocratie (le pouvoir du peuple), en privilégiant la somme des intérêts les plus individuels et les plus grossiers aux dépens de l’intérêt général et du développement de chacun. C’est, comme l’écrivit John Macintosh en 1791, « le despotisme de la cohue et non le gouvernement du peuple ».
C’est pourquoi l’éducation ne doit pas tirer vers les particularités, vers le bas, mais bien vers le haut. L’Europe doit être culturelle. Elle ne peut se satisfaire d’être constituée d’une population hallucinée par la télévision, avide de droits sur mesure pour les « communautés », de viandes de milliards d’animaux sacrifiés à l’autel de l’hyperconsommation, et de jeux et divertissements de masse. A cet égard il est urgent de réagir ; il est urgent de naviguer selon un rêve commun, celui de la formation de tous les citoyens à la technique, à la culture, et au projet européen.
Le socle commun à la Cité européenne
L’avenir repose sur le passé
Nous vivons, comme la plupart des sociétés du monde d’aujourd’hui, dans une société de la connaissance, c'est-à-dire une société dans laquelle information et moyens techniques sont entremêlés et indissociables. Pour vivre en phase avec une telle société, nous avons besoin d’un bagage technique solide. Mais que peut on attendre, à long terme, d’une société de la connaissance si cette connaissance n’est que fonctionnelle ? La connaissance profonde des idées, des arts et de leur histoire, est essentielle, pour que notre société soit aussi culturelle, chargée de sens, de desseins.
C’est pourquoi il faudrait que la formation des Européens repose sur un socle commun à tous les pays, axé autour de deux angles : la formation technique et la formation culturelle. Ce serait une erreur de privilégier l’un de ces angles en dévalorisant l’autre. Les techniques, les langues, le droit et l’histoire sont des disciplines qui existent depuis toujours en Europe, et correspondent à la fois à la connaissance du passé, aux nécessités du présent et à la possibilité de l’avenir.
Techniques, informatiques
La formation technique est une condition de la survie individuelle et collective.
Dans une société de la connaissance, une personne dénuée de connaissances techniques, incapable de se mettre à jour, est hors d’état de tenir un rôle valorisant. La formation aux techniques informatiques, aux possibilités multiples de communication par la Toile, y est dès lors nécessaire à l’autonomie du citoyen.
Dans une société très développée techniquement, une connaissance adéquate, bien que non spécialisée, des fonctionnements industriels et des enjeux énergétiques, paraît nécessaire pour que le citoyen puisse réfléchir aux sujets qui concernent l’avenir de la planète et de l’humanité. Le domaine réservé des spécialistes est donc une catastrophe démocratique. En démocratie, c’est le peuple qui mène la barque par son vote. S’il a méconnaissance des enjeux qui émanent de son vote, n’est-il pas hors d’état d’exercer son pouvoir ?
Langues
La formation linguistique doit consister en deux choses. La première nécessité linguistique de tout Européen est de connaître sa langue parfaitement – ce qui passe souvent par des études littéraires classiques. On oublie que ce fait n’est pas si évident, et qu’une connaissance aléatoire et non culturelle de sa propre langue est un frein à une insertion épanouissante dans la société : l’inégalité face à la langue et à l’expression, difficile à mesurer, se constate cruellement dans les rapports sociaux.
La seconde formation linguistique nécessaire consiste à être en mesure d’utiliser plusieurs langues avec aisance. Dans un monde multilingue, le monolinguisme est également un barrage à l’insertion et à un engagement entier dans la société. La possession de deux langues dès l’enfance me paraît être un minimum.
Droit
Le système du droit est celui sur lequel l’Europe est fondé, et qu’elle a fortement contribué à implanter dans le monde et les relations internationales.
Notre société est bâtie sur le droit, et régie par le droit au jour le jour. Pourtant, ces deux aspects du droit, théorique et pragmatique, ne sont pas enseignés à l’école. Le droit ne fait pas même l’objet d’une initiation.
Il faudrait instaurer cette double formation au droit, théorique et pratique, dès le secondaire.
L’étude de la théorie du droit (les fondations du droit, les aspects et enjeux d’un Etat de droit) donnerait aux citoyens européens une culture sur les piliers même de leur société. Tandis qu’une formation sur son utilisation concrète dans la société donnerait à chacun les connaissances pratiques qui lui permettent de diriger sa vie dans un monde entièrement régi par le droit, et comblerait le gouffre tragique qui sépare « ceux qui savent » de ceux qui ne sont pas initiés.
Histoire européenne
N’est-il pas essentiel, pour la cohésion de la société, de recevoir une formation géographique, historique et culturelle sur toute l’Europe ?
La compréhension intellectuelle et culturelle du monde dans lequel nous vivons permet de consommer mais aussi de créer, de savoir mais aussi de penser. Sans la connaissance de l’histoire, le citoyen est stupide, malmené par les miasmes et illusions du présent, tellement forts qu’ils annihilent tout. Un bagage solide concernant le passé permet de n’être pas (trop) entraîné par les flux de l’immédiateté, et de garder le cap de l’avenir.
C’est essentiel aussi pour l’avenir lointain de l’Europe.
Il semble illusoire de penser que l’on peut développer une vision commune si le sens d’un passé ne nous lie pas, même si les interprétations de ce passé demeurent variées et conflictuelles. Nous avons besoin de quelque chose de commun qui accompagne les Institutions, qui leur insuffle vie et sens, et les rende ainsi durables. Ne pas ancrer l’Europe dans son vieux passé, aussi éclaté qu’il soit, c’est vouloir construire autre chose que l’Europe.
Nous franchirons la muraille !
L’Europe véritablement démocratique exige des citoyens égaux en droits, mais aussi en formation. C’est ainsi que l’Europe sera digne de ses citoyens ; c’est ainsi que ses citoyens seront au niveau de l’Europe, et préviendront l’oligarchie.
Le défi est immense. Il semble impossible. Que l’Europe estime cela impossible, et elle ne vivra pas longtemps comme une démocratie. Qu’elle prouve que c’est possible, et elle vivra son rêve européen et démocratique. “L'épaisseur d'une muraille compte moins que la volonté de la franchir “ - Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse
Edith de CL in Newropeans Magazine, 2006
Publié dans La place, Le corps | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 02 septembre 2009
Sonnet sans titre
Gange par Sara
Assis sur un fagot, une pipe à la main,
Tristement accoudé contre une cheminée,
Les yeux fixés vers terre, et l'âme mutinée,
Je songe aux cruautés de mon sort inhumain.
L'espoir qui me remet du jour au lendemain,
Essaie à gagner temps sur ma peine obstinée,
Et me venant promettre une autre destinée,
Me fait monter plus haut qu'un empereur romain.
Mais à peine cette herbe est-elle mise en cendre,
Qu'en mon premier état il me convient descendre
Et passer mes ennuis à redire souvent :
Non, je ne trouve point beaucoup de différence
De prendre du tabac à vivre d'espérance,
Car l'un n'est que fumée, et l'autre n'est que vent.
Marc-Antoine de Saint-Amant
XVIIème siècle
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 01 septembre 2009
Olonne
Sonate au clair de lune trébuche un peu sur le piano d’en haut tandis que les Sables par la fenêtre s’enlisent dans la brume. Ville du bord de mer, ville d’histoire et d’avenir aussi sans doute, on dirait de temps en temps que tu parles et que tu dis des mots qui chantent dans nos mémoires à venir.
On voudrait ainsi réinventer la langue, pourquelle soit plulibre. Pourquelle révèle les sens et révolte les cœurs enfumés. Avant qu’un monde ne s’étouffe complètement en toi, vibre un peu, Langue, et tu reprendras vie.
Sonate au clair de lune s’achève sur le piano d’au-dessus tandis que sur les Sables de l’autre côté des volets claque la pluie. Ville ouverte sur l’Atlantique, cœur fermé sur une enfance naufragée, on dirait de temps en temps que vous vous épousez et que vous enlacez des notes qui dansent sur nos rêves du passé.
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
Le théorème fondamental de l'analyse
Nous pouvons télécharger le document pdf avec lequel Laurent Moonens avait fait ses premiers pas dans le premier numéro d'AlmaSoror, en septembre de l'an 2006. Plongeons, plongeons, plongeons dans le théorème fondamental de l'analyse !
En savoir plus sur le docteur Moonens ICI
Comprendre comment il est devenu docteur ICI
Lien vers sa page personnelle ICI
Publié dans Paracelse | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 31 août 2009
Les enfermés
La question de la réparation du crime et de la dignité corporelle
phot Sara
Condamnation et enfermement
La Justice envoie beaucoup en prison. Il est frappant de penser que l’enfermement n’est pas réservé à ceux qui portent atteinte à la vie et à la dignité d’autrui ; des gens qui ne représentent aucun danger pour les autres croupissent de longues années en prison.
S’agit-il de faire payer à quelqu’un sa dette envers la société ou de protéger les membres de la société d’un individu violent ? Ces deux actions se confondent-elles ?
Les citoyens, au nom desquels on enferme, sont-ils seulement en mesure de répondre à ces questions ?
Réparation, dépossession
Les moyens de réparer un tort – travaux, amendes - ne manquent pas.
Pourquoi la société ne demande-t-elle pas plus souvent au « coupable » de réparer son tort, au lieu de lui faire subir une exclusion et de porter atteinte à sa dignité pendant un certain nombre d’années ?
Enfermer, c’est prendre possession du corps de l’autre. Dès lors, la prison ne devrait-elle pas être réservée aux gens dont la liberté de mouvement constitue une menace pour les corps, la vie, la santé des autres ? Peut-elle servir à autre chose qu’à protéger la société du meurtre et du viol ?
Respect et protection
Si nous admettons que la peine de prison n’est ni une punition – une société humaniste ne punit pas en enfermant les corps et en annihilant l’intimité -, ni une réparation – est-ce réparer, que de subir un enfermement ?-, alors elle ne constitue rien d’autre qu’une « solution » extrême et désespérée de protéger les gens. Dès lors, nous devrions faire en sorte que les criminels dangereux soient traités au mieux. Assurer à la personne que l’on enferme pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d’années, un confort qui traduise le respect que nous accordons à la vie humaine et permette au prisonnier de vivre, au sens entier du terme : penser, se déployer dans l’espace, contempler la vie.
Espace vital
La question du (statut du) corps, animal ou spécifiquement humain, est centrale dans beaucoup de nos activités. On s’approprie le corps des animaux. On enferme de force les « malades mentaux ». On prive les prisonniers de leur liberté de mouvement.
Jusqu’à quel point la société peut elle prendre possession du corps et de l’intimité du criminel ou du déviant ?
Devrait-on définir le droit à un espace vital minimal, inaliénable ? Quel serait-il ?
Cette question, nous nous la posons de plus en plus au sujet des animaux. Mais nous devrions aussi considérer la prison sous cet angle corporel : quelle étendue spatiale et quelle possibilité d’intimité laissons-nous à ceux que nous enfermons ?
La question de la prison devrait tous nous préoccuper.
L’utilisation de la prison révèle notre rapport au corps humain, au corps d’autrui, et notre vision de la justice.
Edith de Cornulier-Lucinière
Publié dans La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 30 août 2009
Le Forçat innocent
phot Sara
Solitude au grand coeur encombré par des glaces,
Comment me pourrais-tu donner cette chaleur
Qui te manque et dont le regret nous embarrasse
Et vient nous faire peur?
Va-t'en, nous ne saurions rien faire l'un de l'autre,
Nous pourrions tout au plus échanger nos glaçons
Et rester un moment à les regarder fondre
Sous la sombre chaleur qui consume nos fronts.
Jules Supervielle
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 28 août 2009
La ville de perdition
« La ville est morte, faite de choses mortes et pour des morts. Elle ne peut pas produire ni entretenir quoi que ce soit. Tout ce qui est vivant doit lui venir de l’extérieur. Ce qui est une évidence pour la nourriture, mais également pour les hommes. On ne peut assez répéter que la ville est une vaste mangeuse d'hommes. Elle ne se renouvelle pas de l'intérieur, mais par un import constant de matière fraîche extérieure. »
Sans feu ni lieu, Jacques Ellul
Je me suis souvenu cette nuit, alors que la ville illuminée de Zurich révélait ses visages nocturnes, ceux qu'elle cache le jour parce qu'ils sont trop bizarres, je me suis souvenu des livres qui parlent de la ville, de la ville de perdition.
J'ai eu un ami, dans le temps, qui s'appelait Frédéric et qui venait d'une campagne lointaine, là-haut dans la montagne, pas de là où les monts deviennent bleus et dominent les nuages, mais à la frontière des moyennes et des hautes montagnes.
Frédéric était venu à la ville pour travailler et il avait connu cette empire urbain qui prend certains coeurs, les entraîne dans une valse effrénée qu'ils ne peuvent plus jamais abandonner.
Au bout de quelques années, Frédéric était devenu un citadin dépravé, et aux yeux de sa famille des hautes collines, un étranger.
Il en souffrait. Parfois, à la fin des dîners, quand les autres étaient partis et qu'il ne restait que ceux qui n'avaient pas de masque social, il en pleurait.
Alors on buvait ensemble jusqu'au comas éthylique.
Cette nuit, j'ai repensé à Frédéric ; j'ai repensé à tous les livres que j'ai lu et qui parlent de cette perdition. La ville qui mange les gens, avale les âmes et les vies.
Des livres d'auteurs tchouktches. Peuple de Sibérie presque entièrement détruit, mais dont des voix émergent encore, en langue tchouktche ou en langue russe, pour conter les contes cruels des individus échappés d'un monde rassurant et mort, broyés dans la grande ville. Avez-vous lu Unna, de Youri Rythkéou ?
Des livres d'auteurs quechuaphones, conseillés par Katharina F-B, notamment les nouvelles de Porfirio Meneses (Achikyay willaykuna), mais d'autres aussi, qui racontent l'Indien venu à la ville et mangé par elle.
Le livre d'Alan Paton, Cry, the beloved country. Un pasteur noir quitte son pays pour venir à la ville magique, Johannesburg. La ville qui a dévoré son fil unique. Car Absalom, fils de pasteur, est venu à la ville, a vu des prostituées, a essayé de travailler, à subi le racisme, a tué un Blanc.
Noirs & Blancs se donnent la main pour conjurer l'horreur de la grande ville raciste, violente, luxurieuse.
C'est si simple de se perdre dans la ville. Il suffit d'un moment de faiblesse et alors on tombe de l'autre côté, du côté sauvage. Celui que chante Lou Reed. Le côté dont on ne revient jamais, parce qu'il entraine les sens au delà des sens interdits dans une danse qui mélange les sens.
J'ai essayé de me remémorer la chanson de Simon & Garfunkel, The Boxer. J'ai demandé à mes frères de m'apporter un disque pour la réécouter.
J'ai repensé à Rocky 1, le grand film de Sylvester Stallone, et à Fat City, l'immense film de John Huston.
Un moment de faiblesse, c'est la rupture. La sagesse est morte. La société vous quitte. Vous marcherez désormais dans son ombre.
J'ai repensé à Breakfast at Tiffany's. Truman Capote se projette dans son narrateur, jeune gars du Sud qui débarque à New York pour être écrivain et découvre, par l'intermédiaire de sa voisine, un monde de luxe, de paillettes, de tromperies, d'illusions, où, de temps en temps, au bord d'un instant fragile, en instance, une vérité bleu ciel éclate.
Depuis les Romains, le thème de la ville de perdition est inépuisable. Pourquoi le trouvé-je magnifique ? Parce qu'il ressemble au thème de l'enfance perdue dans la noyade adulte.
De Quincey et ses Confessions d'un mangeur d'opium : les jeunes filles (Ann... ma soeur Ann...) qui s'y engloutissent encore plus que lui, parce qu'elles sont encore plus pauvres, et du mauvais côté du genre humain – du côté violé.
Elise ou la vraie vie, belle histoire d'amour de Claire Etcherelli. Elise quitte sa ville de province pour venir être ouvrière à Paris. Elle y découvre la lutte des classes et la lutte des races. Elle tombe amoureuse d'Arezki, algérien menacé, qui l'aime aussi.
L'attrait des plaisirs, de la gangerosité, de la luxure. Nuits sauvages et incendies de corps. Aubes blanches et gueules de bois. Alcool, sexe, breuvages, étreintes... Poudre dans le nez et poudre aux yeux.
Tout cela m'a bien détruit. Tout cela a bien détruit mon cher Frédéric. Où est-il aujourd'hui ? Il erre sans doute quelques part, dans notre ville, ou dans une autre, encore plus grande.
Nous nous retrouverons au paradis des anges déchus, auquel nous ne croyons même pas.
La ville corruptrice qui transforme les jeunes innocents en maîtres de crime ne mourra jamais. Nul doute qu'elle s'exportera sur Mars, et bien plus loin, dans des temps à venir.
On voudrait dire à ceux qui jugent : la ville de perdition, vile, servile malgré elle, est pourtant mille fois plus artistique que vos sentiers battus.
Axel RANDERS
(2007)
Publié dans Chronos, L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 26 août 2009
Ave Imperator ! Morituri te salutant !
« S'il faut donner son sang, Allez donner le vôtre, Vous êtes bon apôtre, Monsieur le président »
Boris Vian
« Du combat, seuls les lâches s'écartent »
Homère
Dans l’Antiquité, puis au Moyen-Âge, les chefs étaient au premier rang dans les batailles. Peu à peu, les dirigeants apprirent à faire la guerre sans risquer leur vie.
Lors de la campagne française en Russie, le prince russe, Bagration, finissait certaines batailles au corps à corps… Dans le camp d’en face, l’empereur Napoléon restait en retrait du champ de bataille. Il risquait beaucoup moins sa vie que ses prédécesseurs ; mais les canons sifflaient sur sa tête et il pouvait à tout moment exploser avec sa longue-vue. Pourtant, il fuit en cachette la Russie, pour rejoindre Paris, où il reprit sa vie de palais pendant que ses soldats mouraient de faim, de froid et de fatigue dans la neige russe. Il ouvrait ainsi une ère très agréable aux chefs : celle où leurs décisions ne les engageaient plus à mourir.
Certaines scènes appartiennent à nos époques, comme celle d’un chef des armées qui dirige les opérations depuis sa maison de campagne, n’ayant aucune expérience matérielle, physique et psychologique de ce qu’il prône. Il nous paraîtrait aberrant que Messieurs les présidents de la république des Etats-Unis d’Amérique, d’Israël, du Liban, soient en train de se battre aux côtés de leurs soldats, de lâcher eux-mêmes les bombes sur les villes et sur les populations.
Saint-Exupéry écrivait : « La guerre, ce n’est pas l’acceptation du risque. Ce n’est pas l’acceptation du combat. C’est, à certaines heures, pour le combattant, l’acceptation pure et simple de la mort ». Cette parole est vraie pour ceux qui font la guerre ; elle ne l’est pas pour ceux qui la décident, ni pour ceux qui la votent à l’Assemblée, ni pour le chef des armées. Pour eux, il ne s’agit pas de l’acceptation de leur propre mort, mais de celle des autres.
La répartition des rôles et des métiers a ses utilités, ses justifications, certes.
Mais le sacrifice de la vie des autres n’exige pas le même engagement personnel que l’acceptation de sa propre mort… L’observation des hommes et des animaux nous rappelle assez comme l’horreur de la mort et l’amour irrationnel de la vie sont répandus ; la gloire de ceux qui décident la guerre, et la mort de ceux qui la font, laissent rêveur.
Comme les chefs d’Etat, la plupart des citoyens ne connaissent pas la guerre réelle, directe, celle qui fait irruption dans la vie pour balayer toutes les choses aimées. Que signifie « intervenir en Afghanistan, en Irak, en Serbie », pour un citoyen dont le rapport à la guerre se réduit à regarder une télévision ? La perte de soldats français en Afghanistan ne faisait pas même l’objet d’une ligne dans les grands journaux français. Le peuple français ne s’intéressait pas aux conséquences des décisions prises en son nom, puisqu’il n’était pas en danger.
« Se faire tuer » est le métier du soldat ; les citoyens des nombreux Etats engagés en Serbie pouvaient approuver de concert les interventions meurtrières sans réfléchir outre mesure. S’ils avaient été concernés par la mort, sans doute la défense guerrière des droits de l’homme aurait paru moins alléchante, plus discutable.
A la barbarie des chefs sanguinaires des despotismes d’antan, succède l’indifférence des technocrates décisionnaires. Dès lors, comment penser la guerre ? Faut-il la refuser complètement ? Ou, considérant qu’elle est inéluctable, faut-il l’organiser ?
Lorsqu’on compte les morts au combat, comment accepter que le chef des armées ne déplore pas la moindre foulure, ni même une tâche de boue sur ses costumes ?
Quelle est la valeur d’une décision qui met la mort en jeu, quand le décisionnaire sait que lui et les gens qu’il aime seront totalement épargnés ? Dans quelle mesure des chefs d’Etat et des ministres, désolidarisés, dans les faits, de ceux qui mourront d’appliquer leurs décisions, peuvent-il les représenter officiellement ?
Quelle considération donner à des décisions prises par des hommes protégés, sacrifiant, au nom des droits de l’homme ou au nom d’autres idéaux paisibles, la vie d’autres hommes ? Y a-t-il une légitimité à voter la mort des autres, même au nom des idéaux les plus élevés, quand soi-même on ne s’engage pas dans la bataille ? La réponse à ces questions abyssales oscille entre la vie et la mort.
Edith de Cornulier-Lucinière, Paris
Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 24 août 2009
Soirs d'exil
phot Sara
Venez sous cette lampe amie et près du feu.
Parlez-moi du Berri, de la mousse câline,
De l' étang lumineux sur qui le jonc s'incline,
Paupière de velours où brille un regard bleu.
Je vous dirai l'ardeur de nos Juillets en feu,
Les vignes d'Août saignant à flots sur la colline,
Et, quand le vent le tord d'une étreinte féline,
Le grand pin qui nous parle avec la voix d'un dieu.
Au dehors, c'est la nuit, l'hiver, Paris hostile;
L'heure morne s'égoutte aux beffrois de la ville:
Évoquons la patrie et le passé charmant!
Un mirage en nos yeux met sa lueur qui tremble,
Et nous rêvons, muets, avec le sentiment
D'être moins exilés quand nous sommes ensemble.
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 23 août 2009
été

Une statue bleue et blonde de la Vierge. Le soleil descend sa douceur chrismale dans le calcaire rose du matin.
Du chant grégorien dans la maison, et jusque dans la rue. Les cris de mouettes, et dehors, vers la mer, hauts vols d’oiseaux, et leurs cris. Bleu du ciel et blanc des nuages, la plage est presque vide et le vent se balade dans l’air chaud. L’après-midi s’est arrêté pour toujours ?
Monk David
Publié dans Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 19 août 2009
What Has Happened To Lulu?
What has happened to Lulu, mother?
What has happened to Lu?
There's nothing in her bed but an old rag-doll
And by its side a shoe.
Why is her window wide, mother,
The curtain flapping free,
And only a circle on the dusty shelf
Where her money-box used to be?
Why do you turn your head, mother,
And why do tear drops fall?
And why do you crumple that note on the fire
And say it is nothing at all?
I woke to voices late last night,
I heard an engine roar.
Why do you tell me the things I heard
Were a dream and nothing more?
I heard somebody cry, mother,
In anger or in pain,
But now I ask you why, mother,
You say it was a gust of rain.
Why do you wander about as though
You don't know what to do?
What has happened to Lulu, mother?
What has happened to Lu?
Charles Causley
Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 18 août 2009
Requiem pour la liberté
Il est une question qui ouvre des abimes. Pourquoi attachons-nous les bêtes
Ma première abysse : le souvenir d’un prisonnier américain, vu sur la télévision d’un voisin, enchaîné, comme dans les bandes dessinées de Lucky Luke. Le pénitencier dans lequel il vivait emmenait ces hommes, pour la plupart noirs, travailler dans les carrières ou d’autres types de grands travaux.
Il racontait à la caméra : « Chez moi il y avait un chien qui était attaché à une chaîne devant la maison. J’ai écrit à ma famille pour leur dire de détacher le chien. C’est trop horrible d’être enchaîné ».
Pourquoi laissons-nous les chiens sous la table lorsque nous mangeons tous ensemble un festin ? Les grondant lorsqu’ils tentent de participer.
Parce qu’ils sont sales ?
On l’a dit de beaucoup d’humains qu’ils étaient sales aussi – trop sales pour toucher ce que nous touchions.
Parce qu’ils ne comprennent rien ?
Pour cela on gardait les enfants et les Indiens loin des endroits de fête et de décision.
Parce qu’ils ne ressentent rien ?
Certes, ils ne ressentent pas plus que ces bébés qu’on opérait sans anesthésie, pensant qu’ils ne ressentaient pas la douleur.
Lorsqu’on parle des sentiments, de la conscience, de la propreté, de la profondeur des autres, parle-t-on d’autre chose que de soi ?
Je sais que mon chien ressent parce que je sais ce que c’est que de ressentir.
Je sais que mon chien aime parce que j’ai aimé.
Je sais que mon chien jalouse parce que j’ai jalousé.
Je sais que mon chien a sa dignité parce que j’ai le sens de ma dignité.
Je sais que le cochon aussi. Et le bouc. Et le mouton. Et l’éléphant. Et le rat.
Et le poisson ? Je ne sais pas.
Je n’ai pas d’écailles, pas de nageoires… je suis modelée par mes vertèbres alors je sais que je ne sais pas.
Que ressentent donc ceux qui ne voient pas autrui ressentir ?
Il semble que chaque être doit être à sa place pour la tranquillité d’esprit de Monsieur et Madame : le chien sous la table, la chèvre à l’autre bout du champ, l’enfant en bout de table, etc.
Or, on voit mal de quelle morale, de quelle nature, se dégagerait une place « normale », naturelle des êtres vivants…
Cette histoire de places m’interpelle. Deux sujets font tressaillir les gens, du fond de leurs tripes : ce qu’ils dénoncent comme la « confusion des genres » et « l’anthropomorphisme ».
Or, on pourrait leur rétorquer qu’eux, font du racisme du genre et de l’anthropocentrisme. Ces batailles de mots ne devraient pas oblitérer les vraies questions : pourquoi sommes-nous affolés de l’intérieur lorsqu’on « change la place » des hommes et des femmes, des humains et des bêtes ?
José Vengeance Dos Guerreros
Publié dans Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 17 août 2009
Université d’antan, amis de demain
Je me souviens de l’université et de ses déchirantes disputes qui nous tenaient éveillés jusque tard dans les bars de la nuit de Genève. Français, Allemands et Suisses Allemands, quelques Belges, nous formions un groupe européen ambitieux et arrogant. Nous pensions pourtant que nous étions humbles et généreux.
A cette époque, je croyais en l’avenir, sans doute parce que la jeunesse me tenait éveillé tard dans les bars de la Nuit de Genève, que la maison familiale zurichoise paraissait lointaine et que les filles qui se criaient les plus féministes se pendaient à mes bras méchants sans retenue. Depuis j’ai connu la vérité de l’arrogance – sa face cachée, laide – et la vérité de l’amour vrai. Alors ma jeunesse m’apparaît comme une fougue chargée d’erreurs.
Nous étions de gauche comme les jeunes de demain seront de droite : avec la certitude d’être l’apogée de la pensée et d’avoir raison pour les siècles des siècles. Hélas, la raison, la certitude et le mépris passent moins vite que les idées qu’ils véhiculent.
Je ne me rappelle pas avoir beaucoup réfléchi à la mort. Je ne m’imaginais pas malade, encore moins mourant. J’avais de temps en temps peur d’un accident de motocyclette et quand je croisais quelqu’un qui me semblait, en âge et en style, proche de moi, en fauteuil roulant, aveugle, handicapé, je détournai les yeux, traversé d’un doute effrayant. Mais ce doute se noyait l’instant suivant dans une occupation ou une pensée vivante.
Ces gens d’alors, je ne les revois plus beaucoup.
Puis j’ai enseigné à la faculté. Ma carrière s’annonçait bien, quoique je précise à tout un chacun que j’étais bien trop intègre, audacieux et rebelle pour faire carrière. Puis je suis tombé malade. Alors le rideau de fumée qui s’installait toujours entre moi et la vie s’est déchiré. Je me suis trouvé seul face à moi-même. La confrontation fut rude. Nous fûmes tous les deux déçus : l’Axel social et l’Axel profond. Le premier découvrait un monde de sentiments et de paradoxes qu’il aurait voulu ignorer. Le second comprit qu’il n’y avait rien à tirer du premier et qu’il faudrait s’en sortir avec ses seules forces vitales, animales, ancestrales. Alors je rencontrai de vrais amis.
D’abord, Esther. Esther, ma plus belle ennemie. Elle était seule, en longue robe, au fond d’un grand salon de Genève quand je la rencontrai. Je venais d’apprendre ma maladie. Elle ressemblait à la fois à un rêve de jeunesse et à un ange de mort. Elle trônait seule, reine méprisée de cette soirée faussement élégante. Elle seule était élégante, c’est sans doute pour cela que personne ne lui parlait. Quel événement nous attira l’un vers l’autre ? Je l’ai oublié. Nous parlâmes et j’adorai le son de sa voix. Ses mots sonnaient étranges. C’était la première rencontre entre un intellectuel militant d’extrême gauche et une catholique traditionaliste de droite en déshérence.
Esther m’accompagna mois après mois, le long de ce parcours de malade en état perpétuel d’aggravation. Je rêvai bien sûr assez vite à une histoire, mais Esther ne se détourne que très rarement de sa vie spirituelle, et lorsque cela lui arrive les heureux élus sont des femmes et des transsexuels. Elle qui, raide et intransigeante, défend sans cesse la famille traditionnelle, l’ordre moral et religieux, la patrie et la fidélité aux cultures européennes, préfère sombrer dans les bras de dépravées des bas fonds de la banlieue parisienne ou bien dans les bras d’autres échouées du catholicisme tridentin. Mais je lui pardonnai le dépit que ces préférences étranges me procurèrent et Esther, encore aujourd’hui, est l’Amie de mon cœur.
Ensuite, Edith. Je la rencontrai par Esther, qui m’en parlait beaucoup. Elle, entre chien et loup, entre gauche et droite, entre religion et athéisme, entre spiritualité et matérialisme, entre confort et misère, entre mondanité et solitude, sut parcourir les quelques ponts qui séparaient Esther et moi et nous accompagner, à travers disputes et incompréhensions, sur les chemins de l’amitié. Longs et incertains, ces chemins n’en sont pas moins les plus beaux.
Enfin, Mayeul. Encore un Français, mais lui a une mère suisse allemande. Nous conversons toujours en allemand. Mayeul est contrebassiste. Il a perdu son père anarchiste dans une manifestation violente quand il avait treize ans. Il visite sa sœur en prison chaque semaine. Il me visite à l’hôpital chaque semaine aussi. Mayeul a sa musique qui l’a tenu loin des drames et qu’il joue pour nous, ses amis et ses proches cassés. Mayeul, tu sais que tu auras compté plus que tout dans ma vie. Si j’ai vécu d’une belle façon, c’est grâce à toi. Je te dois les conseils du temps de Julie, le soutien et des reproches durs mais bons après notre séparation, et cet accompagnement fidèle, incorruptible depuis la maladie. Mayeul, il est difficile de te souhaiter de belles aventures dans la vie car trop de gens autour de toi sont morts vivants, ou si blessés. Mais sache que tu es notre arbre de vie. J’espère qu’un jour, nous partis, tu vivras enfin heureux, entouré de gens sages et attentifs. La vie que tu méritais et qui ne t’as pas été donnée.
Ces souvenirs des arrogances universitaires, de la fracture entre mes deux vies, de la naissance des vraies amitiés, toujours la présence de mon fantôme adoré Julie… J’ai écrit tout cela avant que naisse l’aube, ne dormant pas. Je le poste maintenant sur mon journal en ligne, je l’envoie par ma fenêtre de la Toile, et qui sait peut-être d’autres dépités trouveront dans ces souvenirs si particuliers et si communs l’image de leur propre route, regrettable et nostalgique.
Ah, vieillir.
AXEL Randers
Publié dans L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 15 août 2009
Petite brouette de survie
 phot Sara
phot Sara
J’aime les grands classiques de la littérature jeunesse. Je suis sorti pourtant hier de ces belles avenues pour découvrir un très étrange livre : petite brouette de survie de Tieri Briet et Alejandro Martinez, aux Editions Où sont les enfants ?
Un texte étonnant illustré par des photos. Une sorte de road movie pour les petits.
Un enfant ouvre le frigo de la cuisine familiale et trouve Oscar, un vieux poisson. Les lèvres du poisson tremble. Il murmure d’une voix préhistorique : « Ramène-moi jusqu’à la mer ».
L’enfant prépare donc sa brouette, qui devient un carrosse à une roue. Il demande la route de la mer à sa maîtresse. Puis il part avec Oscar.
Je cite quelques phrases :
« Maîtresse avait dit : « la mer est côté Sud. » A l’Ouest, il y avait l’océan. Et si je me perdais, il suffirait de suivre la rivière ». On voit que la Petite Brouette de Survie est un Water-Road Movie…
« Oscar ignorait tout des flammes et du feu. « Je suis un animal venu des eaux, répétait-il. Mes allumettes lui faisaient peur, et la folie des hommes aussi ».
« Parce que la mer est partout, tu verras, même dans le cœur des gens qui vivent autour. »
Les phrases d’Oscar « ressemblaient à des poèmes venus d’une autre langue. Très ancienne langue animale, difficile à comprendre. »
Et à la fin du livre : « Au revoir, vieux poisson… Si tu reviens dans mon frigo, tu me raconteras la traversée du fond des eaux. »
Je crois que le monde entier est contenue dans cette immense petite histoire : le vent, la mer, la préhistoire, l’enfance et la vieillesse, les relations entre les hommes et entre les espèces. Et aussi le rêve, le voyage, la route.
Et puis l’amitié. Le Feu. La Spiritualité.
Publié dans L'oiseau, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |