Rechercher : maison
L'homme et la brique
Un père pontier à l'usine à Flins, une mère serveuse à L'oie d'Or, et moi j'ai créé une briqueterie artisanale. Cuite ou crue, peinte ou nue, ocre ou grise, ma brique est terre et elle rendra douce ou mystérieuse l'ambiance où vous ferez grandir vos petits. Murs et murets, tables et bar intérieur de cuisine, voyez tout ce que vous pouvez aménager grâce à notre métier, si ancien, si bien ancré dans notre présent.
Au commencement était l'argile. L'eau de kaolin vient s'y mêler. Le pétrissage, puis le séchage, distillent leurs odeurs et leur poussière, qui hanteront les rêves de mes fils Hugues, Kévin et Bastien quand ils seront grands – quand ils seront vieux. J'ose espérer que l'un d'eux reprendra la maison Pontguillaume. J'ose espérer qu'ils s'entendront toujours aussi bien qu'hier soir, lorsqu'ils jouaient au ballon au coucher du soleil.
Il faut disposer les briques dans le four, et j'aime à voir mes apprentis, au début gauches et hésitants, devenir, avec les mois qui passent, les rois de la cuisson. Ils apprennent à aimer la vision infernale du rougeoiement pendant que les rectangles de terre chauffent, chauffent, chauffent...
Des tuiles ? Quelquefois. Quand les commandes de briques s'effondrent, que la demande en tuiles demeure, oui, nous créons de belles tuiles pour une clientèle amatrice de toits rouges et oranges. Mais la brique reste notre plume de paon.
Nous vivons au bord du fleuve. C'est le signe d'un contact avec l'eau, qui irrigue la terre et la rend ferme et molle et friable. C'est le signe d'un contact avec la lune, qui dirige les élans des eaux de la planète, la Terre.
Je ne parlerai pas des soucis qui rongent mon être. Il suffit de dire que tout n'est pas rose. Les femmes savent faire souffrir, les hommes oublient les services rendus. Mais les enfants qui jouent le soir, le regard aimant du chien, l'odeur des briques, le souvenir du père et de la mère partie trop tôt, tout cela fait de moi un homme qui vous dit : merci.
Micka Pontguillaume
Sur AlmaSoror, on peut lire aussi le témoignage de Calélira sur sa ville d'enfance, Equihen.
vendredi, 18 juillet 2014 | Lien permanent
Frappée en novembre
Suite à deux rencontres avec François Bernheim, au Café de l'Etoile manquante et dans le salon Colette de l'Hôtel de Massa, j'ai accepté d'écrire pour le site Mardi, ça fait désordre, un texte sur ce qui m'avait frappée au mois de novembre.
Le voici ici aussi :
Le mois de ceux qui ne sont plus parmi nous
Novembre, tu es revenu enterrer l’été. Tu es arrivé comme on t’attendait, tu t’es comporté à ton habitude, avec ta froideur implacable et ta pluie pénétrante. Je t’ai laissé me traverser sans réfléchir aux conséquences de mon inaction. Je t’ai laissé agir sur ma vie, sur tout ce qui m’environne. Puisqu’on me demande aujourd’hui ce qui me frappa en ce mois, je dirai que c’est avant tout la grande absence des morts.
Ils ont cessé de vivre et aussitôt nous avons cessé de les considérer. Nos corps ont faim et soif de nourritures et de boissons, cette vitalité nous sépare d’eux et aucun amour hélas ne résiste quand l’appel du ventre de l’un répond à la dés-existence de l’autre.
Mais les morts ne sont pas les seuls laissés-pour-compte de nos vies. Les absents leur ressemblent beaucoup à cet égard. Même celle que j’aimais, à laquelle j’étais liée me semblait-il d’une manière inextricable, depuis qu’elle a claqué la porte de la maison familiale, elle disparaît. Son ombre obscurcit nos dîners, nos palabres, mais son ombre n’est pas sa personne. Sa personne n’a plus sa place à notre table.
J’aimerais dîner à une table éternelle, à la table des anges et des fantômes, où tous, vivants et morts, présents et absents, trinquent ensemble, en chantant des airs égrillards ou grégoriens. J’aimerais prendre place au grand banquet macabre des amours mortes et des liens défaits.
jeudi, 22 décembre 2016 | Lien permanent
Antigua
Tu disais des poèmes aux quatre saisons. Tu n'es plus. Il faut bien que quelqu'un te succède à cette valse de mots.
Alors voici, après Le vieux majordome, le poème de l'hiver 2017 ;
après Fazil, le poème du printemps 2017 ;
après Dans la chambrée, le poème de l'été 2017 ;
après Silentium, le poème de l'automne 2017, ;
après Héroïne, le poème de l'hiver 2018 ;
après Tbilissi, le poème du printemps 2018 ;
après Portrait d'été, le poème de l'été 2018,
après Pluie d'étoiles, le poème de l'automne 2018 ;
Après Spectre, le poème de l'hiver 2019 ;
Après Les champs de persil, poème du printemps 2019,
Voici Antigua, pour l'été 2019 :
Une bière, blonde comme les blés des mois brûlants,
Ta main sud-américaine, ta voix de rocaille,
Une langue indienne chante derrière le bar,
La montagne luit de l'autre coté du porche.
Je n'aurais jamais dû quitter
Antigua et son rêve azur.
Le meilleur de moi est resté
A Antigua du Guatemala.
Palmes vertes bruissant dans le jardin de ton grand-père
Et ces mangues mûres dans la corbeille,
Des domestiques, des maîtres, des étrangers,
Les maisons envahies par la torpeur.
Je n'aurais jamais dû briser
Le rêve azur de ces mois là.
Je serais devenue moi-même
A Antigua du Guatemala.
Et comme on dit dans tant de mythes
Qu'il ne faut jamais regarder derrière soi,
Que m'a-t-il pris de revenir
Dans l'Europe aux noirs plaisirs ?
Il ne faut jamais s'en aller
Quand la bière pétille l'accueil souriant.
J'avais une chance à embrasser
A Antigua du Guatemala.
mercredi, 26 juin 2019 | Lien permanent | Commentaires (1)
Bâtir pour tuer l'espérance : l'architecture d'aujourd'hui
Merci à monsieur Guillaume Blanc pour son article désespéré et lucide sur l'architecture des bâtiments publics d'aujourd'hui et l'état de l'université :
Au cœur d'une université d'excellence.
En gare de Nantes, tout à l'heure, ma compagne de voyage et moi-même soupirions en observant la misère profonde des bâtiments de béton qui poussent d'année en année, de manière désorganisée, sans plan, sans vision... et qui sont si laids qu'ils donnent envie de mourir.
Je me suis souvenue d'il y a quelques années, j'étais avec cinq inconnus dans un compartiment ; arrivés en gare de Paris-Montparnasse, l'un des voyageurs a ricané en évoquant la laideur des immeubles et chacun a acquiescé. Ce fut notre seul échange, après quatre heures silencieuses sur les rails à travers la France.
Une illustratrice de ma connaissance, qui a animé beaucoup d'ateliers dans des écoles des périphéries des villes, m'avait raconté cette fillette pour qui les maisons, les immeubles, n'existaient pas. Pour elle, tout était "des bâtiments". En effet, cette enfant vivait dans un bâtiment, étudiait dans un bâtiment, était soignée dans un bâtiment, sa vie se déroulait au milieu des bâtiments, dans des bâtiments, tous en béton, tous laids, tous désespérants.
Sur AlmaSoror nous avons déjà souffert avec vous, dans des bâtiments, par les bâtiments :
entasser un nombre maximal d'êtres humains
Errants des mégapoles d'Europe
Tristesse balnéaire, séniors en culottes courtes
mercredi, 02 octobre 2019 | Lien permanent
La musique modulaire du bonheur
Oublie la superstition, cette croyance diabolique que tu seras puni de ce bonheur par un coup de poignard dans le cœur. Non, il n'est pas nécessaire de subir un petit ou un gros malheur par ci par là pour justifier le bonheur. Le bonheur n'est pas puni. Il est ce climat harmonieux, ce soleil délicieux, ce fleuve enthousiasmant dans lequel tu peux te baigner le plus clair de ton temps. Toi. Oui, toi qui lis cela. Un bonheur sans tache, qui perdure, persiste, demeure, s'accroît, est une aventure possible. Le bonheur parfait existe-t-il ? Mystère. Le bonheur profond, lui, oui. Ce bonheur que l'on sent pétiller dès l'éveil et qui rend léger le corps, douces les odeurs, agréable la routine, charmants les imprévus.
Il faudrait savoir se servir de notre synthétiseur intérieur. Programmer des petites bulles de joie qui s'introduiraient dans la mélodie aléatoire des jours. Il faudrait.
La vie peut être belle pendant quatre-vingt dix ans d'affilée. Les lieux, esthétiques ; les sentiments, enivrés ; les émotions, quiètes ; les sensations, agréables et stimulantes. Oui. Une montagne à gravir, une rivière à descendre. Moi, ce que j'aime par dessus tout, c'est la monotonie de la beauté (mais peut-être que toi, tu n'aimes pas). Comme une route cerclée d'épicéas dans un climat hivernal, tout autour, la neige, un frère qui conduit bien et le chauffage dans la voiture. La perfection se poursuit durant des heures et tout va bien.
À chacun son rêve d'harmonie. Moi je ne m'apaise jamais aussi bien qu'au creux d'une musique ambient nordique ou un chant grégorien de Solesmes.
Le très grand danger d'un bonheur au long cours, c'est l'ennui. L'homme (ou la femme, sa sombre égale) est-il capable de supporter une vie dans laquelle le lever est agréable, le compte en banque rebondi, les amis chaleureux, la famille en bonne santé et de bonne humeur, les lectures intéressantes, les musiques stimulantes, les paysages variés, les maisons élégantes, la vie professionnelle enthousiasmante, les loisirs revigorants et sereins ?
(P.S. : ce qui est bien avec la programmation informatique ou le synthétiseur modulaire, c'est qu'on peut programmer le chaos et l'entendre surgir par faisceaux de beauté).
SUR NOS TERRES
dimanche, 07 novembre 2021 | Lien permanent
Trois assertions communes et fausses (matérialisme, patriarcat, individualisme)
Ces affirmations constamment répétées et entendues partout sont si fausses que c'est presque merveilleux qu'elles rencontrent autant de succès.
« Nous sommes dans une société matérialiste. »
C'est faux. Une société matérialiste respecterait les matériaux, les objets, les métiers manuels. Nous sommes dans une société de consommation qui détruit le matériel. La société de consommation n'est pas matérialiste. Elle n'est pas non plus spirituelle. Elle est échangiste (la valeur d'échange a pris le pas sur les valeurs morales et sur les biens matériels eux-mêmes).
Nous avions copié un passage d'un livre de Philippe Ariès à ce sujet.
« Nous sommes dans une société patriarcale. »
C'est faux. La plupart des enfants vivent sous l'autorité de leur mère. Le père n'est plus celui que les noces démontrent. Il a au mieux la moitié de l'autorité parentale, mais les mères l'ont beaucoup plus universellement.
Cela dit, une société matriarcale n'est pas moins machiste qu'une société patriarcale.
« Nous sommes dans une société individualiste. »
C'est faux. Nous sommes dans une société très collectiviste : les enfants naissent dans des institutions médicales, l'éducation obligatoire commence désormais à 3 ans (en France), la plupart des gens meurt dans des institutions collectives (hôpitaux, maisons de séniors) et nous passons nos vies dans des organisations qui ne laissent qu'une faible place à la responsabilité individuelle et encore moins à l'autonomie. Tout ce qui concerne l'éducation, la santé, le transport, est aménagé, décidé, dicté par l'Etat. L'individu aujourd'hui n'est rien, il a quelque pouvoir sur lui-même, mais très peu sur ses enfants et sur ses biens, il n'est donc pas un pilier de notre société.

En illustration, cette photo prise en janvier 2022 d'une personne patriarcale, individualiste et matérialiste, donc forcément frustrée dans notre société liquide, collective et antimatérialiste
vendredi, 11 février 2022 | Lien permanent
Encore un peu de temps...
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ;
mais vous, vous me verrez, parce que je vis, et que vous vivez.
Evangile selon StJean
Morceau d'un commentaire de Saint Jean d'Avila, docteur de l'Eglise :
De même que Jésus Christ prêchait, le Saint Esprit prêche à présent ; de même qu'il enseignait, le Saint Esprit enseigne ; de même que le Christ consolait, le Saint Esprit console et réjouit. Que demandes-tu ? Que cherches-tu ? Que veux-tu de plus ? Avoir en toi un conseiller, un pédagogue, un gardien, quelqu'un qui te guide, qui te conseille, qui t'encourage, qui t'achemine, qui t'accompagne en tout et pour tout ! Finalement, si tu ne perds pas la grâce, il sera tellement à ton côté, que tu ne pourras rien faire, ni dire, ni penser qui ne passe par sa main et son saint conseil. Il sera pour toi un ami fidèle et véritable ; il ne t'abandonnera jamais si tu ne l'abandonnes pas.
De même que le Christ pendant sa vie mortelle opérait de grandes guérisons et répandait sa miséricorde dans le corps de ceux qui avaient besoin de lui et l'appelaient, de même ce Maître et Consolateur opère des œuvres spirituelles dans les âmes où il demeure. Il guérit les boiteux, il fait que les sourds entendent, il donne la vue aux aveugles, il ramène les égarés, il enseigne aux ignorants, il console les affligés, il encourage les faibles (cf Mt 15,31). Le Christ faisait ces œuvres si saintes parmi les hommes, et n'aurait pas pu les faire s'il n'avait pas été Dieu ; il les faisait avec la nature humaine qu'il avait assumée, et nous disons donc qu'elles ont été faites par un Dieu-homme. De même ces autres œuvres que fait ici-bas le Saint Esprit dans le cœur où il demeure, nous les appelons œuvres du Saint Esprit avec l'homme, considéré comme élément secondaire.
Ne peut-on considérer comme malheureux et infortuné celui qui ne possède pas cette union, celui qui ne possède pas un tel hôte dans sa maison ? Dites-moi, l'avez-vous reçu ? L'avez-vous appelé ? L'avez-vous importuné pour qu'il vienne ? Que Dieu soit avec nous ! Je ne sais pas comment vous pouvez vivre privés d'un si grand bien. Voyez tous les biens, toutes les grâces et les miséricordes que le Christ est venu faire aux hommes : ce Consolateur les répand toutes dans nos âmes.
samedi, 04 juin 2022 | Lien permanent
Extrait du journal de H.Le-L.
Mercredi 30 mai 2018
16h, après une sieste ratée (sans sommeil, en ayant trop chaud car le soleil inonde la rue de l'Agent Bailly de torride torpeur), je lis un passionnant article de Cécile Rastoin, alias sœur Cécile de Jésus Alliance, sur Judith Butler. Ça tombe bien, car en ce moment je pense nuit et jour à ma psychanalyste, Lemon L., une femme juive, très intelligente (également très chaleureuse), adepte de la théorie du genre initiée par Butler. Je m'oppose en fait à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Cécile Rastoin énonce que pour les juifs, la parole est performative et d'ailleurs Lemon L. m'a dit une fois : que votre parole soit performative (à propos du fait de trouver et acheter une maison). Ma question soudaine : crois-je à la parole performative ? Je ne suis pas certaine d'y croire vraiment. Je n'ai pas cette foi en la parole, que pourtant j'adore. Si le Verbe se fait chair, il prend aussi les lourdeurs de la chair et subit les lenteurs et les incapacités profondes de la matière.
Lorsque j'étais adolescente, je subissais les railleries et les incompréhensions parce que je ne mangeais pas de viande par protestation envers le mépris total des animaux. Aujourd'hui, je suis lassée par les mêmes personnes qui sont devenues, sans s'en rendre compte, en croyant que cela leur est naturel, très sensibles au sort des animaux et qui le clament ou culpabilisent les autres. Alors c'est normal si ces pensées qui paraissaient subversives (théorie du genre, liberté sexuelle), me fatiguent maintenant qu'elles se répandent dans les institutions et deviennent officielles, obligatoires, mises en avant par les élites. Dans vingt ans, quand le tout-Paris critiquera ces années d'immigration massive et de glorification du "multiculturalisme", je serai peut-être parmi ceux qui rappelleront que les immigrés nous ont aussi beaucoup apporté.
Oui, toute pensée qui devient dominante a commencé par être ridicule et subversive et se glorifie du "martyre" qu'elle a subi sans se rendre compte qu'elle le fait subir à son tour. Alors, pas d'énervement. Reste calme. Tout change, sauf la mode agaçante, qui obscurcira toujours la vérité par son manque de subtilité.
mardi, 18 janvier 2022 | Lien permanent
Métrodore : ouverture

Voici l'ouverture de Métrodore, un roman en suspension entre l'enfance et le monde adulte, entre hier et aujourd'hui.
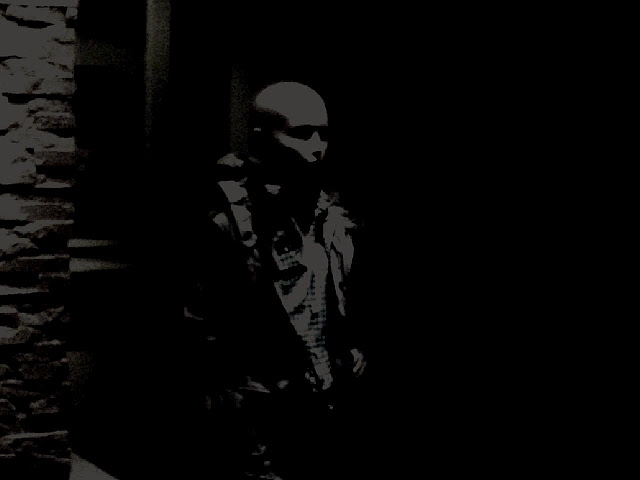
J’ai seize ans et je ne mange plus. Il paraît que ça n’arrive qu’aux filles qui ont des problèmes avec leur mère. Je suis un garçon et je n’ai pas de problèmes. Je suis seulement fatigué de vivre. La nourriture me dégoûte. Les gens me dépitent. Les professeurs me répugnent. Le lycée m’insupporte. Les magasins criards, la grisaille des rues, les ordinateurs me désespèrent. Je hais la société. Je m’appelle Jude Parizet et je vous hais.
Alors, vous m’avez amené ici, dans cet hôpital blanc. Les infirmiers me sourient : j’ai envie de leur cracher à la gueule. Les médecins me parlent d’un ton gentil : je les devine fiers de leur diplôme de médecine, fiers de s’occuper des jeunes en difficulté. Je les terrasse de mon mépris, mais ils s’en fichent : ils croient par-dessus tout qu’ils ont raison.
L’hôpital est blanc comme la mort, noir comme la peur, gris comme l’hiver. Le pavillon Michel-Foucault accueille des garçons et des filles entre treize et dix-sept ans. Nous errons dans les couloirs, nous marchons sur le carrelage des toilettes et le linoléum des pièces lugubres. Des néons jaunes éclairent l’escalier ; des néons blancs éclairent les murs blêmes. De nombreuses affiches empirent la laideur des murs. Une immense photographie du philosophe Michel Foucault orne le mur du vestibule. L’homme a l’air sadique et arrogant. Sur les murs des couloirs et de la salle de jour, de grotesques affiches montrent des jeunes en train de s’embrasser, de parler, de jouer au ballon. Sous les photos sont inscrits des slogans affligeants : « Moi, je dis non à la violence », « Moi, je dis non à la drogue », « La lecture est le plus beau voyage du monde ». Ils nous prennent pour des idiots.
D’autres jeunes sont là. Une petite dizaine. Certains n’ont pas le droit de venir dans la salle de jour ; nous les apercevons se faufiler comme des ombres, accompagnés par des infirmiers qui les mènent comme des enfants.
Nous, qui avons le droit de passer du temps dans la salle de jour, nous sommes libres de nos mouvements à l’intérieur du pavillon Michel-Foucault. Beaucoup sont des filles, encore plus maigres que moi. J’ai peur d’en voir une mourir. Ce serait triste à voir, une mort dans un hôpital. Quelle horreur d’agoniser dans un couloir de plastique et de béton. Si mourir, c’est quitter à jamais le monde où nous avons aimé et souffert, une mort au bout d’une plage, une mort en haut d’une montagne, c’est une mort bien plus belle.
Pourquoi sommes-nous ici ? On nous a enlevés de la vie normale pour nous enfermer dans cet hôpital parce que nous avons un problème avec l’idée de devenir adulte.
Les adultes se sont habitués à leur vie dans la ville, loin du ciel bleu, des arbres, des grandes forêts, des animaux sauvages, des océans. Ils se sont habitués à leurs habits étriqués, qui leur donnent l’air de petits pions. Ils se sont habitués à se lever au bruit strident du réveil, à se laver dans leur petite salle de bains, à utiliser des produits conformes aux normes pour se laver, pour manger, pour nettoyer leur maison…
Ils se sont habitués à se lever matin après matin.
Les adultes se sont habitués à remplir des papiers, à suivre des milliers de règles administratives, juridiques. Jour après jour, chaque fois qu’ils achètent, qu’ils vendent, qu’ils se marient, qu’ils divorcent, qu’ils ont des enfants, qu’ils en perdent, qu’ils partent en vacances, ils remplissent des papiers administratifs. Machinalement, ils écrivent dans les petites cases leur numéro de Sécurité sociale (un numéro d’au moins dix chiffres), leur sexe (masculin ou féminin, tant pis pour les anges), leur âge (comme si c’était important), leur lieu de naissance (pourquoi ?), leur statut social et leur statut familial. Ils ont des comptes en banque, des contrats d’assurances, des cartes d’assuré, des cartes d’électeur, des cartes bancaires. Sur tous ces papiers, des chiffres et des mots sans poésie.
Les adultes peuvent rester assis au bureau toute la journée alors que dehors brille un soleil magnifique. Ils peuvent parler des heures de l’actualité politique alors que Charles Baudelaire a écrit des poèmes qui traversent le temps. Ils peuvent prendre le métro tous les jours, dans de longs couloirs souterrains, pour se rendre de leur maison au travail et de leur travail à la maison. Ils peuvent subir cette vie pendant quarante ans sans jamais se révolter plus de deux jours.
J’ai seize ans, dans deux ans je serai un adulte.
Pourquoi voulez-vous que je mange ?
Edith de Cornulier-Lucinière

samedi, 05 janvier 2013 | Lien permanent | Commentaires (1)
Étranges jours d'Europe
(Étranges jours d'Europe, dont le mystère est absent)
Premier jour
... chut !
…
Second jour
Seigneur, Ô maître des moissons, créateur du temps. Dans le silence qui s'installe, je me souviens que des vieilles personnes m'avaient parlé de vous.
J'étais enfant, je les croyais. Mais leurs paroles punitives et menaçantes m'ont révoltée. J'ai rejeté ce vin amer.
Je vous ai relégué dans ce pays imaginaire de l'inexistence.
Troisième jour
Voici que le silence des hommes avance à chaque seconde, voici que leurs machines se taisent. Les oiseaux soudain recommencent à chanter.
Désœuvrée, je me tourne vers vous.
Vous qui n'existiez plus.
Quatrième jour
Vous ?
Dieu.
Que me direz-vous ? Je vous attends.
« Ne crains pas le silence ». La réalité finit de s'enfuir. Nous sommes assis. Nous attendons le dernier rêve.
Cinquième jour
Les paupières se closent imperceptiblement. Monte un air de guitare espagnol, et soudain, palpite à nouveau le temps présent.
Quel est ce souffle qui gronde à quelques mètres de moi ? Peu importe que ce soit la bonté puissante de l'océan ou la rage désordonnée des machines roulantes.
Ferme les yeux, que revienne à la conscience, comme une vague lente et bleue perlée d'écume, le paradis perdu.
Sixième jour
Une à une, lentement, je descends les grandes marches du port de Port Saint-Rêve des Morts. Des fanions fanent aux persiennes fermées ; d'une maison de calcaire, s'évapore un fumet délicieux, de thym, de poisson frit, de légumes d'entre deux saisons.
Au loin, à peine visible, de l'autre côté de la mer sans autre bateau que le dragueur éternel du soir, scintille la baie ovale de Saint-Jean, où les réverbères de Saint-Jean en Ville viennent de s'allumer, tous ensemble, à l'instant.
Septième jour
Et dans ces jours brûlants, sans négoce, sans agitation, sans activité, où l'ennui s'étire comme un gros chat sur la pierre chaude, l'âme s'interroge sur sa propre innocence, dont elle pressent qu'elle est factice. Ô souffrance ! Tu ne donnes aucun passe-droit vers l'absolution.
Des petits enfants ramassaient des cailloux et les rangeaient dans leurs poches il y a quelques mois, quand il n'étaient pas tous enfermés à l'intérieur des maisons.
Huitième jour
Et sous ces nuits glacées, que le sommeil visite en amant infidèle, où l'angoisse s'étend comme un empire antique sur des friches d'enfance, le corps visite sa propre chair, dont il entend l'appel de mort. Ô vacance de la joie ! Tu fais de l'être un linceul pensant.
Noix, pommes, œufs, en rémission d'une fête de cuisine, frissonnent dans le vent léger de la porte entrouverte, trésors précieux au renouvellement inassuré.
Neuvième jour
Mendiant de l'aurore, tu cueilles l'ozone et le bouton d'or des prés, tu déambules à travers les zones désertées par la foule. Mendiant de la douleur, tu ramasses les fardeaux oubliés.
Dixième jour
Le dixième jour est celui de l'espérance. Nous quittons l'ère de la déploration. Surgissent les vagues de l'amour. Rayonnent les astres du lendemain. C'est parce que nous avons renoncé à marcher et accepté de mourir que la mort a quitté son masque de menace.
Elle n'est plus qu'une compagne de vie, comme la vie est compagne de mort, elles ne sont plus que les deux faces de notre sourire raffermi dans la joie éphémère.
Onzième jour
Je tourne autour du polynome sans discerner sa trace, je glisse sur des vagues d'algèbre, surf aux écumes poétiques, en quête de Dieu.
Maître, seigneur des empires, père des individus. Dans le chant des pinsons, je crois me souvenir qu'on entend un peu de Vous.
Douzième jour
Ulysse navigue autour de la galaxie en son vaisseau de plexiglas.
Le jour a éventré la nuit, la nuit se casse.
Treizième jour
Et nous nous enfonçons dans le temps arrêté, arrêté dans l'espace.
Quatorzième jour
L'espace a mangé toute la place ! Le temps devient une toute petite bille, un point, une particule, et hop ! Disparaît.
Il n'y a plus d'heures pour flotter dans la poussière, il n'y a que la lumière et l'absence de lumière, il n'y a que les ténèbres et l'absence de ténèbres.
Quinzième jour
Fils de Dieu, assis à la droite du maître de maison, dans la salle du banquet, donne-nous ta leçon de ténèbres. Immobiles, nous marchons vers Pâques, qui n'est ni un lieu, ni un jour, mais le redressement du monde.
Silencieux, au milieu du silence, nous écoutons les éperviers interrompre le silence.
Seizième jour
Comme une biche essoufflée recueille la rosée, ainsi ma vie te cherche, toi, la Joie.
À l'ombre de la croix des bras de la fenêtre, je lis ce même livre, vieux comme Adam peut-être.
Dix-septième jour
Fils de l'homme, ou fille, debout face aux toits de la ville, sur la courte terrasse fleurie, regarde les hirondelles nicher sur les cheminées ! Constate que les maisons les plus douces aux humains le sont aussi pour le duvet de l'animal sauvage.
Immobiles, au milieu des latences, nous contemplons l’œuvre du vent sur les feuillages.
Dix-huitième jour
On ne sort plus dehors.
Dehors, les uniformes détruisent les vies fragiles par abus de pouvoir, ils jouissent et chaque passant doit faire profil bas. Il n'y a plus de foule, ni de groupe, des humains isolés comme des loups omégas cherchent à passer entre les mailles du filet.
Le filet de la dictature policière.
Dix-neuvième jour
Les grosses bouches des ministres vomissent des phrases malformées dans les écrans des maisons.
La langue française a fui la bassesse du pouvoir, elle chuchote en secret dans les greniers.
Vingtième jour
À travers tes yeux plissés, accoudé au pan de la fenêtre, vois la procession des enfants qui portent le buis en chantant : Bénis soit Celui qui vient, hosanna dans les hauteurs !
Vingt-et-unième jour
Vogue, vaisseau de l'oubli, dans les célestes corridors de l'invisible.
Vingt-deuxième jour
Plane, éternel enfant, parmi les nuées roses et grises.
Vingt-troisième jour
Tu es reine pestilentielle, ô bacille de la délation, qui ne meurs ni ne disparais jamais, attendant patiemment dans les armoires etc, mais lorsque tu reviens ce n'est pas l'entraille du rat que tu colonises, mais le cœur de l'homme.
Olfactive ? Si peu... Ta pestilence est absconde.
Vingt-quatrième jour
De l'autre côté des façades, dans les patios cachés, fraîchement repeints, les écrans meurent, les lois d'exception s'oublient, l'état d'urgence se ridiculise, les verres s'emplissent à demi et se sirotent dans la lenteur. La douceur des patios vaincra l'algocratie.
Vingt-cinquième jour
Résipiscences, vous n'êtes qu'hypocrisie.
Vingt-sixième jour
Voix bretonnes, voix tchèques, voix albanaises, voix germaniques, voix qui s'intriquent en une plainte contrapuntique, et mon ouïe française qui flanche d'angoisse.
Vingt-septième jour
Et mon cœur français, qui bat la cadence de la honte.
Vingt-huitième jour
Mon cœur ? Il pompe le sang.
Ma honte ? Elle prééxiste. C'est elle qui prépare les êtres à toute soumission à venir.
Vingt-neuvième jour
Il est midi depuis quelques heures dans cette ville atlantique silencieuse.
Trentième jour
Soudain minuit sonne. L'ombre nous voile. La lune rit.
Les antennes frissonnent sous la nuit en impulsion.
Trente-et-unième jour
Quand le jour reviendra, nous serons en prison.
Incarcérés à domicile, entre fascination et répulsion.
Trente-deuxième jour
Attendez-moi, houlques laineuses qui valsez dans les champs ! Je viendrai mourir libre au milieu de vos froufrous !
Trente-troisième jour
Tilleuls, vous exhalerez vos parfums du soir.
Trente-quatrième jour
Je courrai à en perdre haleine dans les hautes herbes vierges.
Trente-cinquième jour
Je mourrai en riant.
Trente-sixième jour
Les psaumes me suivront.
Chantés par des hommes aux voix graves, les psaumes m'absoudront.
Trente-septième jour
Mon cerveau, confiture d'oublis.
Trente-huitième jour
Mon corps, rouille aux articulations.
Trente-neuvième jour
Mon sternum bisexuel désire et la dame de pique et le valet de cœur.
Quarantième jour
Au quarantième jour, la quarantaine s'achève. S'ouvre l'ère du combat, pas encore perceptible.
Il était une fois, dissimulés dans des corps flasques, toutes les grandeurs des hommes qui s'éveillaient secrètement à l'évolution qui vient.
Quarante-et-unième jour
Léthargie, léthargique essence de l'être en dissolution, noyade dans les couleurs de Schoenberg.
Quarante-deuxième jour
Endormissement, éblouissement, droguée par la fête des belles eaux de Messiaen.
Quarante-troisième jour
Non. Non... Non ! Nooooon ! Noooon ! Non !
Quarante-quatrième jour
Éclats d'obus sur mon cortex, je vacille, je ressuscite.
Quarante-cinquième jour
Voici venir le soir et l'espérance du salut.
Quarante-sixième jour
Douce grâce, stupéfiant Amour. Nous tournons les yeux vers vous, nous, serviteurs de l'invisible. Armée de solitudes, dans nos uniformes de la banalité. Touchez notre mutisme, regardez notre attente. Nos bras levés vers vous, union inaccessible.
Quarante-septième jour
Marcher après l'immobile terreur, tomber dans la pluie sur le béton sale.
Quarante-huitième jour
Le sol se troue, la rue tombe, le fleuve surgit.
Quarante-neuvième jour
La ville vogue sur les trombes d'eau réjouie.
Cinquantième jour
Les vers n'éclosent plus depuis que la matrice a prononcé en silence le jugement sur mon œuvre.
Cinquante-et-unième jour
En mai, fais semblant de ne pas faire ce qu'il te plaît. Ainsi tu plairas aux policiers et ta liberté, intacte, s'éveillera en secret.
Cinquante-deuxième jour
Sursis du végetal, tandis que Cassandre raconte les horreurs qui s'avancent vers nous, je contemple à travers mon rêve ces feuilles de diffenbachia qui dilatent leur verdure au-dessus des fougères, le béton est mort, vive la chlorophylle !
Cinquante-troisième jour
Se frapper soi-même pour ne pas tuer les gens qu'on aime et ainsi les faire souffrir un simili-martyr sans hématome.
Cinquante-quatrième jour
Noirceur incolore, blancheur élégante, arc-en-ciel fugitif, tout vacille aux dernières secondes de l'entendement.
Cinquante-cinquième jour
Étranges jours d'Europe !
<
jeudi, 19 mars 2020 | Lien permanent














