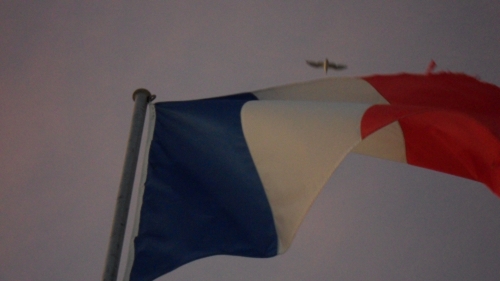mardi, 28 février 2012
Réponse à une question de Tieri
Tieri : La photo de toi avec une valise qui t'en va vers la mer. Cette photo me fait peur. Est-ce que ça va, Edith, est-ce que ta vie ressemble à tes rêves ?
Édith : Dans la valise dorment de vieux souvenirs. Comme ils sont vieux ! Comme ils pèsent lourds ! Ils t’ont fait peur ; ils m’avaient fait peur à moi aussi auparavant. Ils font peur à tout le monde.
Un matin, je me suis éveillée avec une idée nouvelle. J’ai bu un café plus chaud que d’habitude, puis je suis allée marcher sur les quais des gares perdues. De vieux hangars proposaient des caisses emplies de vêtements. J’ai pu ainsi me procurer le complet veston ayant appartenu à un vendeur de mangoustes au XIXème siècle.
Il ne me manquait plus que la valise. J’ai flâné à travers les vieilles usines, dont les portes de verre ébréché, habitées de toiles d’araignées, laissaient passer des rayons de soleil luisants. A travers poussières et vieux objets, mon œil chercha. Je la vis, mince, élégante, oubliée sur une table. Une vieille liseuse de cartes m’expliqua qu’elle avait contenu des lettres d’héritage au temps où elle appartenait à un notaire. Je la ramassai : elle serait ma valise.
Quelques heures plus tard, je rencontrai enfin l’endroit idéal, non loin du phare, à l’endroit où finit la promenade de la côte. « C’est là », pensais-je avec certitude.
Je descendis sur la plage. J’ouvris la valise ; de vieilles odeurs se répandirent dans le vent et le sable. Je la laissai respirer à l’air libre. Cela me prit plusieurs heures de rassembler tous mes vieux souvenirs. Lorsque enfin ils furent tous transvasés dans la valise, je versai quelques larmes, pour les habituer au sel. Puis je refermai le linceul.
Quelques pas suffirent pour chasser la nostalgie. Comme la mer était belle ! La matinée tirait sur sa fin, mais midi m’attendait au loin, à l’horizon. A mesure que je m’enfonçai dans la mer, le soleil versait de nouvelles idées dans ce drôle de labyrinthe-ver de terre qu’on appelle cerveau. A midi, j’atteignis l’horizon : il ne restait plus rien de mon ancienne identité et de mon ancienne vie : j’avais tout oublié. Tout, sauf cette promenade qui durait depuis l’aube. Je laissai la valise aux hautes vagues du zénith et me noyai.
J’eus des difficultés à ouvrir les yeux, car le sel avait collé le sable aux paupières. Une mouette tournait au-dessus de moi en hurlant. J’étais échoué à l’extrême sud de la plage. Plus rien n’était semblable à ce que j’avais été avant : neuf était mon cœur, neuve était ma mémoire, avec des images et des mots qui venaient d’ailleurs. Déboussolée, je dus faire plusieurs signes de croix pour retrouver les points cardinaux. Après quoi je sus qu’il fallait que je tourne vers la gauche pour rejoindre le chemin des corps perdus. En fin d’après-midi, je retrouvai mon studio. La cafetière contenait le reste du café du matin.
Je suis heureuse avec mes nouveaux souvenirs. Je les décrypte, quand je n’ai rien à faire. Je m’amuse à reconstituer cette vie inconnue que le soleil m’offrit, légère, lointaine, ésotérique. Ma nouvelle mémoire est infinie.
Quelques points de cette histoire restent obscurs. Qui a pris la photographie troublante ? Une dame, sans doute, avec un cœur de mère et un chagrin de sœur. J’ai voulu retourner vers les quais des gares perdues. Ils avaient disparu. Sans doute les nouveaux carrefours des routes avaient brouillé les repères anciens. Qu’importe ! Nos vies passent comme des papillons. Les morts se succèdent : il reste une ombre, notre ombre qui marche dans l’Instant présent.
ADDENDUM
Depuis cet échange, qui eut lieu en mars 2010, Orso est né !
Publié dans Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (9) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 25 février 2012
Jean-Christophe : expérience de lecture commune
Le mardi soir, quelques amateurs viennent lire ensemble, à haute voix, Jean Christophe, dans une petite pièce du fond d'une cour du boulevard du Montparnasse.
L'inspiration de ces soirées est venue de la lecture de Chez le Prophète, une étrange petite nouvelle de Thomas Mann, et de l'influence d'une soeur qui avait tenté, ailleurs, avec d'autres, la lecture collective.
L'idée de départ était de lire ensemble un grand roman, le premier des "romans-fleuve" du XX°siècle, de 1500 pages, qu'aucun de nous n'aurait eu le courage d'entamer seul et de poursuivre le roman jusqu'au bout, envers et contre tout. Nous ne savions à quoi nous attendre. Nous étions peut-être inquiets. Pourtant, c'est une belle lecture, la découverte d'un style ample, onctueux, clair, bien campé entre la beauté de la phrase classique et la simplicité de la phrase contemporaine.
Tous les lecteurs ne viennent pas tous tous les mardis. Certains sont assidus, d'autres dilettantes ; la soirée se déroule au fil des voix qui se succèdent. Voix masculines et féminines, voix qui mettent le ton ou refusent délibérément de le faire, voix qui habitent le personnage de Christophe et lui donnent un charisme mouvant, changeant. La place du lecteur est celle à côté de laquelle une lampe de chevet est posée. Le reste de la pièce est dans une demi-pénombre. Quelques victuailles hantent la table, toujours un fromage, un vin et parfois d'autres propositions.
"Sur la littérature universelle plane un nuage d'alcool", émit Michael Krüger. Et dans nos esprits alcoolisés plane la littérature universelle.
Nous aurons connu Romain Rolland. Nous l'aurons laissé nous emporter dans son roman-fleuve, dans son fleuve romanesque et nous y aurons nagé sans peur de s'éloigner des rives du temps. Pourquoi ? Parce qu'il est bon d'oublier les choses utiles, pour se délecter de l'inutile, le splendide inutile, l'éternel inutile, si essentiel aux âmes avides d'horizon.
Mais, pour l'heure, la route n'est pas finie. Douze séances ont eu lieu. Il nous reste encore un long chemin pour arriver au bout de ce roman dont le dernier mot est "naître".
Nous sommes entrain de naître.
La page de notre aventure se trouve ici.
Publié dans La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 24 février 2012
Carvos Loup : Fenêtre 326°
Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

Et c'était le début d'une longue histoire de solitude, de langueur et de ballades à travers champs d'aurore et zones d'ombres.
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mardi, 21 février 2012
Le benêt de Saint-Vivien

Phot. Sara
Je ne suis jamais retournée à Saint-Vivien. De temps en temps, au terme d’une journée trop remplie, je me tiens à la fenêtre, fatiguée ; mon esprit vagabonde. Je laisse alors remonter des images d’un temps qui ne reviendra pas. Une époque enfuie, une époque dont il ne reste pas même des ruines. Plus un être, plus un objet ne me demeure. Mais comme les souvenirs sont vivaces a! Et de temps en temps, je bois une bière en mangeant un sandwich aux olives et au concombre, et des mots d’autrefois sonnent dans ma mémoire. Non, je ne suis pas nostalgique. Je tente de comprendre comment il est possible qu’un monde s’écroule, comment il est possible qu’on puisse s’éloigner autant de sa jeunesse. Je considère la jeune fille d’alors et il m’est difficile de croire qu’elle est la même personne que moi. Les souvenirs sont les seuls ponts qui me lient à elle. Les souvenirs, et certaines émotions, légères et douces, qui palpitent à nouveau en mon sein à l’évocation du chemin des oliviers.
Il menait à la mer. Nous allions rarement jusqu’à la mer. Nous nous cachions dans l’un de ces arbres magnifiques, toujours le même, et nous contemplions, avec béatitude, le ciel bleu, les rangées d’oliviers qui mouraient, tout au fond du chemin, dans le vert de la mer, et les tâches blanches des nuages, et les tâches jaunes des genêts. Sur la route, rarement, une voiture passait. Et personne ne connaissait notre refuge. Personne ne connaissait notre secret.
Il s’appelait Matthias.
Les gens appelaient Matthias, le benêt. On m’appelait la fille du bedeau. Ma mère était morte ou partie, je ne sais pas. Les gens du village étaient gentils avec moi, cruels avec Matthias. Comme aucun jeune ne lui parlait, je ne le connaissais que de vue jusqu’à notre première rencontre sur le chemin des oliviers. Ce fut une rencontre de hasard. J’aurais pu rencontrer n’importe quel autre garçon sur ce chemin oublié. Ce premier jour, nous montâmes déjà à l’arbre, parce qu’il voulait me montrer comment voient les oiseaux. Nous vivions depuis quinze ans dans ce village de neuf cents habitants, et c’était la première fois que je parlais avec le benêt.
Le village de Saint-Vivien s’étendait sur plusieurs kilomètres, des collines basses de Montpréau jusqu’à la mer. Les maisons de chaume ressemblaient toutes à la nôtre, blanches et rectangulaires, bien qu’elles fussent beaucoup plus grandes. Aujourd’hui que la grande Toile nous relie tous électroniquement à tout, je songe parfois à taper le nom de « mon village » sur un moteur de recherche. Mais je sais que je ne le ferai jamais. A quoi bon remuer la boue d’une enfance morte ?
« La maison du bedeau », comme on l’appelait, était une dépendance de l’église. J’y vivais seule avec mon père, mais nous dînions presque tous les soirs avec le curé du village. Je ne me souviens pas d’une seule conversation. Je ne me souviens pas de la voix du curé, ni de celle de mon père. Ils palabraient entre eux, et j’écoutais, baignée d’un ennui constant, inconscient. La maison comprenait trois pièces, et un joli petit jardin carré. Ma chambre donnait sur la rue, celle de mon père sur le jardin. J’ai passé beaucoup de temps à ma fenêtre, dissimulée derrière la tenture du rideau, à observer les allées et venues du village. Lui, ne passait presque jamais. Il bêchait dans les maisons du côté des collines. Puis, pour se rendre au chemin des oliviers, il ne traversait pas le village mais passait par le bois. Nous n’avions jamais de rendez vous et n’étions pas à quelques heures près. Une heure ou cinq minutes nous paraissait équivalents.
Nous dévorions inlassablement des sandwiches aux olives et au concombre. Il amenait le pain, j’amenais les concombres et nous nous servions d’olives dans l’arbre. C’est incroyable à quel point ce souvenir est puissant. Toute ma vie, j’ai eu des flashes extraordinairement violents et imprévisibles. A un cocktail, sur un marché, ou tout simplement chez des amis, lorsqu’une effluve de concombre ou d’olive traversait ma narine. Alors il me fallait plusieurs secondes pour en revenir, et me détacher d’un regard naïf, entier, un peu quémandeur.
Cinq ans durant, nous nous rencontrâmes quotidiennement, à l’arbre.
Et, c’est vrai, l’arbre, qui fut d’abord notre observatoire, nous servit bientôt de salle à manger, et enfin de lit.
Au village, nous nous ignorions. Nous ne nous parlions pas. A l’arbre, je l’écoutais et il m’écoutait. Pourtant, aujourd’hui, je me demande si nous nous connaissions, ou si nos solitudes se rencontraient sans que nous saisissions nous même où se situait cette rencontre en chacun de nous.
Nous ne savions rien exprimer ; savions-nous aimer ? Il n’est pas un jour depuis ma fuite où je n’ai pas pensé à lui. Il n’est pas un soir où je ne me suis pas endormie au creux de son souvenir. Il n’est pas une aube qui n’a mis devant mes yeux entrouverts, avant la moindre lumière du jour, l’image de ses deux grands yeux bleus naïfs, songeurs, vaguement mendiants…
Quand Matthias marchait, on le reconnaissait de très loin. Sa démarche était un peu de travers. Sa silhouette, à la fois élancée et gauche, penchait trop d’un côté à chaque pas. Il semblait marcher à contretemps.
De l’arbre, on voyait la statue de Notre Dame du Bon Secours, cette si gentille dame qui priait pour les marins. Les mères, les sœurs, les filles et les fils des marins morts lui déposaient des gerbes. Notre Dame du Bon Secours était notre seule amie, pourtant, nous n’allions jamais la voir. Nous parlions souvent d’elle, de sa douceur, de sa fidélité, de son amour pour les marins. Nous l’admirions. Nous savions que la statue représentait un être qui nous semblait incroyablement proche. J’étais la fille du bedeau, et lui, le benêt, était le dernier fils du boulanger, athée et épicuriste, comme il disait. Il ne comprenait pas qu’on lui ait refourgué un benêt pareil. Sur sept enfants, ça arrive souvent, comme il disait.
Au village, on ne nous faisait pas de fête d’anniversaire ; c’était réservé à la fine fleur des habitants, ceux qui « commandaient », ceux qui « dominaient » les autres par leur prestance. Mais les gens nous criaient : bon anniversaire. C’est ainsi que je connus sa date d’anniversaire : j’entendis quelqu’un lui crier, eh, bon anniversaire ! Lui, quelques mois avant, le jour de mes seize ans, était arrivé à l’arbre avec un couteau et un bracelet de sa fabrication, scellés entre eux par une liane fleurie. J’étais bouleversée par leur beauté. A mon tour, je lui offris un pull-over, pour lequel je dépensai tout mon argent au seul magasin de vêtements de Saint-Vivien. Matthias le porta presque tous les jours les trois ans qui suivirent.
Quand Matthias apprit, sans doute en entendant des gens du village en parler, que je partais étudier à la ville, il ne dit rien. Son attitude ne changea pas. Son regard devint peut-être plus inquiet.
Un jour, j’abordai le sujet. Il était évident qu’il savait ; j’en parlai donc naturellement, sans tristesse, sans joie : je vais aller étudier à la fac. Cela faisait plus de trois ans que nous nous étreignions tous les jours sans jamais commenter ces étreintes, ces serrements, qui étaient autant de serments jamais formulés, autant de déclarations jamais prononcées. Nous parlions des oiseaux, des arbres, il me racontait qu’il avait beaucoup bêché, je lui expliquai que je n’avais pas aimé la fin de telle émission de télévision.
Et voilà que sans rien commenter ni sous entendre, je disais simplement que j’allais partir. Qu’avais-je jusqu’ici décidé dans ma vie ? Rien. Nous avions l’habitude des décisions importantes imposées par le monde extérieur. Il ne dit rien.
Mais son étreinte ce jour là ressembla à un appel au secours. Je ne me dis rien, je le ressentis simplement. Nous nous quittâmes comme d’habitude, et son regard était affolé, mais silencieux.
Mon départ était prévu dans trois mois. Les trois mois qui suivirent, rien de différent n’eut lieu. La veille de mon départ, il me serra contre lui sans parler. Le benêt ne me laissait plus partir, et moi non plus je ne voulais pas partir.
Je devais marcher seule jusqu’au car, à quelques kilomètres de là. Je pris la route, un sac énorme et trop lourd sur le dos. J’étais si peu habituée à formuler et à ressentir que je ne mettais pas de mot sur la pierre douloureuse que je sentais dans mon cœur. Il sortit d’un fourré, émergea sur la route. Il me poignarda trois fois. Puis il me prit dans ses bras, sanglota et s’enfuit.
Quelques heures plus tard, une voiture s’arrêta et je fus ramassée, ainsi que le poignard. J’étais à peine consciente. Je ne l’ai jamais dénoncé. Au bout de quelques mois ils ont laissé tomber, ils ne m’ont plus interrogée. J’étais en convalescence. Je partis avec six mois de retard pour l’université. Lui, je le vis plusieurs fois venir à ma fenêtre. Je lui souris. Il déposa des fleurs sur le rebord de ma fenêtre. Quand je partis, mon père le bedeau et le maire du village m’accompagnèrent au car. Je le vis quand le car démarra. Il était dans un fourré, au bord de la route. Nous nous regardâmes jusqu’à ce que la vitesse du car nous sépare.
Je savais qu’il ne me faudrait jamais retourner à Saint-Vivien. Je savais qu’il était le benêt, qu’il bêchait, dans les jardins des gens. Je savais qu’il pensait à moi, et je pensais à lui. Quand je passai mon doctorat de poésie, j’eus le sentiment à la fin de la soutenance d’avoir raconté des insanités. Il aurait fallu que je raconte cette histoire : la seule chose qui compte vraiment.
Les mots qui me viennent le plus justement sont la fraternité et la tendresse. Ou l’amour, et la tendresse. Une histoire sans fard, sans témoin, sans intention.
La fraîcheur des aubes, la blancheur sale des maisons, le gras de la terre, l’herbe humide. Cela habite en moi. Rien de ce labyrinthe urbain qui m’entoure n’a pu effacer la terre. Et aucune caresse, aucun regard, aucun échange n’a calmé le profond amour que j’éprouve pour lui.
Certes, il était incapable d’être autre chose qu’un ange, et cela en faisait l’image d’un débile. Certes… J’ai vécu une vie d’universitaire, j’ai voyagé, j’ai été une citadine. J’ai fréquenté les bars à la mode. J’ai erré dans la ville le dimanche après-midi, désoeuvrée. J’ai péroré le samedi soir dans des dîners… Certes. Et je n’ai jamais rien dit de lui. Aujourd’hui, malgré l’impossibilité d’exprimer l’inexprimable, je prends la plume pour que cette histoire vive à nouveau. Mes amours, urbaines, n’ont jamais valu le benêt de Saint-Vivien.
Je me demande si de temps en temps, un homme de soixante ans, la démarche déglinguée, la bêche sur l’épaule, s’arrête, là-bas, à la sortie de Saint-Vivien, sur le chemin des oliviers, et adossé à la branche la plus basse d’un arbre, toujours le même, l’esprit chargé de mémoires d’un temps depuis longtemps fini, mange un sandwich aux olives et au concombre.
Peut-être les histoires les plus immobiles, les plus silencieuses, sont-elles aussi les plus inoubliables.
édith de Cornulier Lucinière
Et pour illustrer cette histoire, une autre histoire, sur une proposition d'Emma du Songe italien
Publié dans L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (5) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 18 février 2012
Eau de vie, espace, solitude et liberté pour les mouflets d’antan
Claude racontait ce weekend que son père allait à l’école seul, à pied, au début du siècle précédent. Il avait trois quarts d’heure de route et la Bourgogne était froide. Alors, pour la route, ses parents lui mettaient du journal dans ses chaussures et une bouteille de gnôle pour se réchauffer à bonnes lampées aux moments d’épuisement.
Oui, il y a soixante-dix ans les gamins marchaient quarante minutes dans les grands froids de l’aube hivernale en buvant des lampées de gnôle de pomme ou de mirabelle. Et ils n’étaient pas plus malheureux ni plus drogués que nos petits d’aujourd’hui.
Alors, pour fabriquer votre gnôle, c’est ici
Pour repeupler la France intérieure et créer des écovillages solidaires, c’est ici
Pour lire la mémoire d'Equihen, par une habitante de là-bas, c'est ici

Publié dans Le corps, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 17 février 2012
Carvos Loup, Place VH
Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

Le soir dardait ses bières et les mains des gens faisaient peur. Un grand silence baignait le bruit des villes. Mon cerveau travaillait hors contrôle. Je cherchais.
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 15 février 2012
Journalistes pousse-au-crime
Désespoir de cachot, photo Edith de CL
Nous proposons un extrait des Réflexions sur la délation, de François de Pange, révolutionnaire non-violent (1790)
"J'ai parlé des maux publics que la délation prépare. Si j'entrais dans le détail des infortunes particulières qu'elle entraîne, je pourrais écrire quelques pages intéressantes, mais inutiles. Qu'apprendrais-je aux hommes qui sont sont sensibles ? Qu'obtiendrais-je de ceux qui ne le sont pas ?
Avant de terminer ces réflexions sur les délateurs, je ne dois pas taire que, de tous ceux qu'a produits la France, les plus méprisables et les plus sanguinaires ont été des journalistes ; ces hommes que la multitude stipendie ont besoin de lui plaire et nous avons montré que la délation en fournit les moyens. Il semble aussi qu'ils aient compté sur ce désir curieux et cruel que quelques âmes ressentent pour contempler de grandes vicissitudes de fortune, pour voir même (il faut l'avouer) couler du sang humain.
Pendant l'instruction du procès de M. de Besenval, on les a vus, attristés par son innocence, déplorer l'absence des charges, en désirer de graves contre lui ; et tandis que cet homme presque septuagénaire languissait dans une injuste et dure captivité, de tranquilles folliculaires insultaient à sa longue infortune, essayaient de la rendre plus amère par les sinistres présages qu'ils lui faisaient parvenir et promettaient son sang pour vendre un peu mieux leurs feuilles.
On sait que les Romains couraient aux amphithéâtres épier avidemment les derniers soupirs d'un gladiateur ou d'un esclave déchirés par les bêtes et ne pouvaient se rassasier de ces scènes de carnage qu'ils appelaient des jeux. Que des hommes soient organisés de manière à trouver là quelque plaisir, on doit les plaindre ; mais il faut réserver tout son mépris et toute sa haine pour ceux qui, par cupidité, se rendaient les entrepreneurs de ces affreux spectacles et prenaient le soin de chercher, à de tels plaisirs, des instruments et des victimes".
Plus sur François de Pange et son opuscule... par ici.
Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 13 février 2012
Hameaux-tombeaux, quelles tristesses ont clos tes derniers yeux-fenêtres ?
Un billet d'Esther Mar
Photo volée ici
Ô France, Ô ma belle, Ô ma morte, où erre l'écho de tous ces cris d'enfants, libres, qui résonnaient dans tes hameaux ? Combien de maisons, d'églises, de ruelles abandonnées par les morts, après la première guerre mondiale, après la seconde - combien de vieux sont morts dans une maison de retraite en ville en songeant à leur village, qu'ils avaient laissés après en avoir été le dernier survivant. Hameaux perdus, témoins d'un peuple assassiné par ses Élites, par les Guerres, par le Progrès, les trois ennemis qui marchent toujours main dans la main pour exterminer oiseaux et enfants, adultes et animaux, antiques pierres et vieux arbres.
Ruines d'un temps qui ne reviendra jamais, au fond des villages abandonnées, vous parlez encore des gens qui vous aimaient au vent qui passe, au seul vent qui passe.
Voix éteintes, yeux clos, rires perdus, ma France a été assassinée par les routes, par la télévision, par les discours nationalistes d'abord (guerres mondiales), par les discours internationalistes ensuite (mondialisme et progrès).
Pleurez, coeurs solitaires, en songeant que des enfants couraient là.
Pleurez aujourd'hui puisque personne n'a pleuré quand le dernier berger a été emmené à la maison de retraite, quand la dernière brodeuse a dû quitter le village mort.
Ô France, comme il est violent de t'aimer !
Car les lotissements laids poussent comme des champignons alentour des villes, mais dans les terres bafouées le vent gémit de compassion entre les murs écroulés.
France, pendant que tu t'apprêtes à voter en moutonnade, les derniers survivants des hameaux-tombeaux meurent dans les maisons de retraite, perdus dans la solitude immense des souvenirs d'un pays qui a existé, et qui n'est plus.
Esther Mar
Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 11 février 2012
Le dernier rêve...
Le dernier rêve du dernier jour.
Publié dans Clair-obscur, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 10 février 2012
Carvos Loup : Loup
Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

L'oubli d'une vie où je n'avais que toi et je ne le savais pas, où les bruits du studio énervaient mon esprit, où la poussière du monde ne m'avait pas encore touchée. Une jeunesse avait lieu.
Elle est morte depuis longtemps.
Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 08 février 2012
Mémoire des jours heureux
"Le matin nous trouvait calmement endormis
Midi brûlait de l'or dans nos cheveux
La nuit, nous nagions dans la mer rieuse
Quand l'été sera parti...
Où serons-nous ?"
Publié dans Clair-obscur, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 06 février 2012
Liberté, vérité, action
Sur la liberté, la vérité et les actions qui doivent en découler, voici une phrase de François de Pange, révolutionnaire qui s'opposa aux crimes de la Terreur, suivie d'une phrase d'Ernest Renan, prononcée un siècle plus tard.
La certitude de posséder la vérité, de représenter la liberté, autorise-t-elle le crime et la censure ?
De Pange et Renan, penseurs éclairés dépourvus de violence, furent impressionnés par la violence des penseurs de leur propre "clan idéologique".
Pour moi, qui ne puis apercevoir de liaison nécessaire entre des idées métaphysiques et des assassinats, je ne partagerai pas les passions de ceux dont j'applaudis les systèmes ; je m'efforcerai d'écarter ces glaives que des aveugles agitent au milieu de nous ; et, adorateur de la Liberté, je presserai mes concitoyens d'honorer cette divinité nouvelle en lui rendant ici ses compagnes immortelles, la Justice et l'Humanité.
François de Pange
In Réflexions sur la délation, 1790
La vérité est une grande coquette, monsieur. Elle ne veut pas être cherchée avec trop de passion. L'indifférence réussit souvent mieux avec elle. Quand on croit la tenir, elle vous échappe ; elle se livre quand on sait l'attendre. C'est aux heures où on croyait lui avoir dit adieu qu'elle se révèle. Elle vous tient rigueur, au contraire, quand on l'affirme, c'est-à-dire quand on l'aime trop.
AlmaSoror avait déja salué le catalogue éditorial d'Allia dans cet article.
Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
vendredi, 03 février 2012
Carvos Loup : Cuisine
Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

Le rock & roll a baigné toutes les scènes quotidiennes d'un monde aussi matériel que son inspiration est spirituelle. Et au fond de nos souvenirs le son de l'aspirateur se mélange aux rythmes des guitares américaines. Je bois trop de café chaque jour et les souvenirs à trier s'accumulent sur la table de mon bureau intérieur. Je n'ai pas le courage d'entamer la taxinomie de ma mémoire. J'attends que le temps passe - et il passe, sans que rien ne se passe.
Publié dans Le corps, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
jeudi, 02 février 2012
Fragment de Clarté
Nous avions déjà parlé d'Henri Barbusse ici, et nous nous demandions à propos de son engagement communiste : comment un homme traumatisé par les millions de morts de 14-18 peut militer pour une cause qui fera des millions de morts, le Communisme ? Mystère, mystère…
"Soldat universel, homme pris au hasard parmi les hommes, rappelle-toi : il n'y a pas un moment où tu fus toi-même. Jamais tu ne cessas d'être courbé sous l'âpre commandement sans réplique : « Il le faut, il le faut. » Enserré pendant la paix dans la loi du travail incessant, dans l'usine de machines ou dans l'usine de bureaux, esclave de l'outil, de la plume ou du talent ou d'autre chose, tu fus traqué sans répit, du matin au soir, par la tâche quotidienne qui ne te permettait que de vaincre tout juste la vie et de ne te reposer qu'en rêve.
Quand vient la guerre que tu n'as jamais voulue, — quel que soit ton pays et ton nom, — la fatalité terrible qui t'empoigne se démasque nettement, agressive et complexe. Le souffle de condamnation s'est levé.
On réquisitionne ta personne. On se saisit de toi par des mesures menaçantes qui ressemblent à des arrestations, et auxquelles rien de ce qui est pauvre ne peut échapper. On t'emprisonne dans des casernes. On te met nu comme un ver et on te rhabille avec un uniforme qui t'efface ; on marque ton cou d'un numéro. L'uniforme t'entre dans la peau; les exercices te façonnent et te taillent à l’emporte-pièce. Il surgit autour de toi, t'encerclant, des étrangers vêtus brillamment. On les reconnaît : ce ne sont pas des étrangers. Alors, c'est un carnaval, mais un carnaval farouche et suprême : ce sont les nouveaux maîtres, absolus, arborant leurs pouvoirs dorés sur leurs poings et leurs têtes. Ceux qui sont près de toi ne sont eux-mêmes que les serviteurs d'autres qui portent un pouvoir plus grand peint sur leurs habits. C'est une exigence de misère, d'humiliation et de rapetissement où tu tombes de jour en jour, mal nourri, et mal traité, assailli dans toute ta chair, fouetté par les ordres des gardiens. A chaque minute, tu es rejeté violemment dans ton étroitesse, tu es châtié au moindre geste qui en sort, ou tué par ordre de tes maîtres. Il t'est défendu de parler pour t'unir à ton frère qui te touche. Autour de toi règne un silence d'acier. Ta pensée ne doit être qu'une souffrance profonde".
Henri Barbusse, in Clarté
photos de Mavra Nicolaïevna Novogrochneïeva
Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |