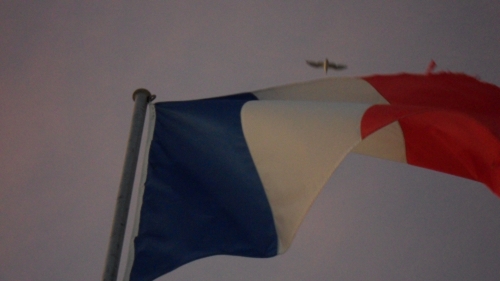jeudi, 02 février 2012
Fragment de Clarté
Nous avions déjà parlé d'Henri Barbusse ici, et nous nous demandions à propos de son engagement communiste : comment un homme traumatisé par les millions de morts de 14-18 peut militer pour une cause qui fera des millions de morts, le Communisme ? Mystère, mystère…
"Soldat universel, homme pris au hasard parmi les hommes, rappelle-toi : il n'y a pas un moment où tu fus toi-même. Jamais tu ne cessas d'être courbé sous l'âpre commandement sans réplique : « Il le faut, il le faut. » Enserré pendant la paix dans la loi du travail incessant, dans l'usine de machines ou dans l'usine de bureaux, esclave de l'outil, de la plume ou du talent ou d'autre chose, tu fus traqué sans répit, du matin au soir, par la tâche quotidienne qui ne te permettait que de vaincre tout juste la vie et de ne te reposer qu'en rêve.
Quand vient la guerre que tu n'as jamais voulue, — quel que soit ton pays et ton nom, — la fatalité terrible qui t'empoigne se démasque nettement, agressive et complexe. Le souffle de condamnation s'est levé.
On réquisitionne ta personne. On se saisit de toi par des mesures menaçantes qui ressemblent à des arrestations, et auxquelles rien de ce qui est pauvre ne peut échapper. On t'emprisonne dans des casernes. On te met nu comme un ver et on te rhabille avec un uniforme qui t'efface ; on marque ton cou d'un numéro. L'uniforme t'entre dans la peau; les exercices te façonnent et te taillent à l’emporte-pièce. Il surgit autour de toi, t'encerclant, des étrangers vêtus brillamment. On les reconnaît : ce ne sont pas des étrangers. Alors, c'est un carnaval, mais un carnaval farouche et suprême : ce sont les nouveaux maîtres, absolus, arborant leurs pouvoirs dorés sur leurs poings et leurs têtes. Ceux qui sont près de toi ne sont eux-mêmes que les serviteurs d'autres qui portent un pouvoir plus grand peint sur leurs habits. C'est une exigence de misère, d'humiliation et de rapetissement où tu tombes de jour en jour, mal nourri, et mal traité, assailli dans toute ta chair, fouetté par les ordres des gardiens. A chaque minute, tu es rejeté violemment dans ton étroitesse, tu es châtié au moindre geste qui en sort, ou tué par ordre de tes maîtres. Il t'est défendu de parler pour t'unir à ton frère qui te touche. Autour de toi règne un silence d'acier. Ta pensée ne doit être qu'une souffrance profonde".
Henri Barbusse, in Clarté
photos de Mavra Nicolaïevna Novogrochneïeva
Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
lundi, 01 mars 2010
René Lalou : les témoignages sur la Guerre V
J'ai trouvé le tome I de ce livre dans les affaires de mon grand-père. Publiée en 1946, L'histoire de la littérature française et contemporaine (1870 à nos jours) , de René Lalou, comporte d'assez beaux passages.
En voici un, que je recopie à l'usage de ceux qui trouvent amusant de lire un critique du milieu du XXème siècle sur la littérature "contemporaine".
Le chapitre « les témoignages sur la guerre » est émouvant, guirlande des traumatisés de 14-18 (cette guerre votée par des députés qui ne la firent point, mais continuèrent leur tranquille vie tandis que la jeunesse masculine française était envoyée à la boucherie).
Des soldats revenants, beaucoup écrirent, sans espoir.
La guerre de 14-18 a brisé beaucoup d’œuvres de jeunes écrivains qui commençaient, comme Alain-Fournier et son Grand Meaulnes ; elle a ensuite donné des raisons d’écrire à ceux qui n’en auraient pas eu l’idée sans elle.
V Fin des témoignages des garçons sacrifiés
« Cette guerre a tué le romantisme de la guerre ».
Un moment arriva pourtant où il fut admis par la majorité des éditeurs que le public ne s’intéressait plus aux ouvrages sur la guerre. La riposte fut le prodigieux succès, en 1929, de la traduction du livre de Remarque, À l’Ouest rien de nouveau.
Vers le même temps Norton Cru provoquait un scandale en publiant ses Témoins : les âpres reproches qu’il adressait aux auteurs de livres de guerre étaient souvent justifiés ; mais il méconnaissait le droit qu’a l’artiste de faire des peintures, non des photographies et il refusait d’admettre que le vrai n’est pas toujours vraisemblable. Parmi les livres qui échappaient à ses critiques citons les Carnets d’un fantassin, de Charles Delvert, l’un des défenseurs du fort de Vaux.
Sous le bombardement Delvert écrivait : « cette guerre a tué le romantisme de la guerre ». La phrase pourrait servir d’épitaphe aux trois témoignages parus en 1930 : l’inexorable Ce qui fut sera d’Henri Barbusse, épilogue et synthèse du Feu ; la Peur, de Gabriel Chevallier où l’accumulation des « petits faits vrais », jugés par un disciple de Stendhal, aboutissait au plus cruel réquisitoire ; les tragiques « prises de vue » qui font ressembler le Noir et Or d’André Thérive au film de Pabst, Quatre de l’Infanterie, et laissent la même impression d’une atroce épreuve subie par les hommes mais reniée par l’esprit.
« Le Feu, c’est un beau bouquin. Il est presque vrai. Y a qu’une chose, c’est trop romantique, trop en théâtre » : ainsi parle un des personnages d’Henry Poulaille dans l’hallucinante et minutieuse reconstitution du Pain de Soldat (1937). En nous livrant, la même année, ses Souvenirs de Guerre, le philosophe Alain affirme que ces expériences renforcèrent sa conviction que la tâche la plus urgente était, selon les exemples de Socrate et Descartes, de « massacrer d’abord les lieux communs ».
Assurément tous les anciens combattants n’exprimeraient point aujourd’hui le sentiment d’une gigantesque duperie avec la verdeur rabelaisienne que déploie Jolinon dans Fesse-Mathieu et l’Anonyme (1936). Mais on ne saurait étudier la littérature des années 1920-35 sans tenir compte de ces deux faits : elle est pour la plus grande partie d’hommes qui ont connu les souffrances de la guerre ; l’immense majorité de ces hommes est arrivée tôt ou tard à la conclusion que leurs souffrances auraient pu être évitées et qu’elle n’avaient même pas assuré le triomphe des idées pour lesquelles ils avaient lutté.
René Lalou
Publié dans Fragments, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
mercredi, 24 février 2010
René Lalou : les témoignages sur la Guerre IV
J'ai trouvé le tome I de ce livre dans les affaires de mon grand-père. Publiée en 1946, L'histoire de la littérature française et contemporaine (1870 à nos jours) , de René Lalou, comporte d'assez beaux passages.
En voici un, que je recopie à l'usage de ceux qui trouvent amusant de lire un critique du milieu du XXème siècle sur la littérature "contemporaine".
Le chapitre « les témoignages sur la guerre » est émouvant, guirlande des traumatisés de 14-18 (cette guerre votée par des députés qui ne la firent point, mais continuèrent leur tranquille vie tandis que la jeunesse masculine française était envoyée à la boucherie).
Des soldats revenants, beaucoup écrirent, sans espoir.
La guerre de 14-18 a brisé beaucoup d’œuvres de jeunes écrivains qui commençaient, comme Alain-Fournier et son Grand Meaulnes ; elle a ensuite donné des raisons d’écrire à ceux qui n’en auraient pas eu l’idée sans elle.
Les premiers fragments de ce chapitre, publiés sur ce blog :
II Georges Duhamel, la Vie des martyrs
III Roland Dorgelès, les Croix de bois
IV Voix d’hommes meurtris et panorama pêle-mêle d’après-guerre.
… "une attitude originale de l’homme façonné par la guerre".
Après ces œuvres maîtresses, le lecteur accueillant ne refusera pas d’entendre d’autres témoignages. La Flamme au poing d’Henry Malherbe lui apportera les notes d’un combattant cultivé groupées autour de trois thèmes : Souvenir, Amour et Mort.
Dans Nach Paris, Louis Dumur, auparavant connu pour d’amusantes peintures du calvinisme genevois, a dressé un réquisitoire contre les atrocités allemandes.
Jean des Vignes Rouges a voulu, dans André Rieu, officier de France, exposer le point de vue des chefs, tandis que Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier, auteurs de la Guerre des soldats, renchérissaient sur l’antimilitarisme de Barbusse.
Adrien Bertrand, dans les récits et conversations de l’Appel du sol ainsi que dans les dialogues de l’Orage sur le jardin de Candide a livré les confidences d’un agrégé de philosophie, disciple d’Anatole France, qui se sent « une cellule de la nation », entend « l’appel de la terre française » et meurt en héros « pour que la France continue ».
Paul Reboux, dont l’inspiration versatile s’était tournée successivement vers Paris, Naples, la Bretagne et l’Espagne, composa en deux volumes les Drapeaux, œuvre de propagande antimilitariste qui tente d’annexer au roman la science des statistiques : peut-être y apporta-t-il à piper les dès un peu de cette adresse qui le fit baptiser « roman nègre » son Romulus Coucou, dont le héros est un mulâtre.
Dans Indice 33, Alexandre Arnoux a construit un récit dramatique ; sa verve de conteur s’atteste aussi bien dans les histoires militaires du Cabaret que dans La Nuit de Saint-Barnabé, alerte document sur l’imagination des gosses parisiens de 1920.
Marcel Berger, dont l’Homme enchaîné avait traité gauchement mais loyalement un problème complexe, raconta dans Jean Darboise la vie en grisaille des hommes du service auxiliaire ; avec les Dieux tremblent, il essaya de matérialiser la haine vengeresse d’un blessé pour ceux que la tourmente a épargnés mais noya cette idée intéressante sous des péripéties mélodramatiques.
Paul Géraldy avec cet art de ramener tout haut sujet à un dialogue de salon dont ses Noces d’argent font la démonstration, décrivit dans
la Guerre, Madame, une journée à Paris pendant l’automne 1915, suggérant la grandeur des événements, représentant avec une fidèle facilité le snobisme de certains milieux ; il n’épuisa point son sujet puisque Maurice Level put écrire Mado ou la Guerre à Paris, qui tient ce que promet son titre.
On aurait pu attendre de l’expédition à Salonique un renouveau d’orientalisme : À Salonique, sous l’œil des Dieux, de J.-J. Frappa ne nous leurre d’aucun mirage poétique. Quant au passage des Anglo-Saxons en France, Marcel Prévost prit soin qu’il en demeurât au moins un souvenir comique : Mon cher Tommy leur légua une image de jeune fille française à leur usage, en n’omettant point, il est vrai, de leur apprendre qu’en de certaines épreuves « on a besoin de faire appel à toute sa fermeté britannique pour se raidir contre l’arrêt de sa volonté divine ».
Benjamin Vallotton est le créateur de Potterat, commissaire de police en retraite, porte-parole du bon sens vaudois, de sa révolte contre la violation de la neutralité belge et contre la consigne de neutralité suisse. Outre À tâtons, roman sur les aveugles de guerre, il a décrit, dans Ceux de Barivier, l’histoire tragique d’un village savoyard pendant la lutte. On retrouve l’humeur narquoise de Ce qu’en pense Potterat dans son Achille et Cie, satire d’une famille de nouveaux riches installés dans un château historique avec leur singe symbolique. Les ouvrages de Vallotton sont des articles d’exportation.
Il y a dans ces derniers livres beaucoup de littérature, parfois assez inutile. On en rendra donc mieux justice au sobre réalisme du caporal Georges Gaudy dans l’Agonie du Mont-Renaud, au mélange aimable d’humour et d’esprit des Silences du Colonel Bramble, et Discours du Docteur O’Grady par André Maurois, à la verve savoureuse de Pierre Chaine, auteur des Mémoires d’un rat et des Commentaires de Ferdinand, et aux ironiques récits de la vie dans un dépôt que Jean Gaultier-Boissière, l’un des rédacteurs du Crapouillot, a réunis dans Loin de la Rifflette.
Parmi les récits de combattants, signalons encore Ma Pièce de Paul Lintier et Sous Verdun de Maurice Genevoix ; on pourra ajouter, pour les territoriaux, les Pépères la Victoire du critique Jean Valmy-Baysse et l’Héroïque pastorale de Louis Vuillemin, variations d’un musicien au grand air de la guerre.
La vie populaire pendant la guerre a été peinte dans la Maison à l’abri par Marcel Martinet qui est aussi un poète véhément et l’apôtre d’un « art prolétarien » ; les problèmes moraux de l’immédiate après-guerre ont été évoqués avec une rare loyauté par Jean Schlumberger dans le Camarade infidèle. Mais il faut tirer hors de pair cet extraordinaire manuel d’attention morale qu’est le Guerrier appliqué de Jean Paulhan : devant ce livre où le décor de la guerre apparaît renouvelé par une totale absence d’interprétation, par une exacte vision de ce qui fut, non colorée d’enthousiasme ou de découragement, plus d’un lecteur confessera que son esprit, esclave de trop de préoccupations étrangère, a véritablement manqué la guerre et sentira se réveiller en lui la faculté d’observer précise que tous possèdent et que nul n’a su exercer avec cette infaillible maîtrise.
Au surplus, pendant les années qui suivirent, les échos de la guerre n’ont pas cessé de retentir dans la sensibilité contemporaine, témoin le Sel de la terre, de Raymond Escholier, carnet de route féroce et mystique sous la morne lumière de Verdun, ou cet implacable cauchemar,
Ils étaient quatre, d’Henry Poulaille. Avant les reportages romancés et précis des Captifs et des Cœurs purs, Joseph Kessel avait prêté, dans l’Equipage, un intense relief dramatique au roman de l’aviation.
Joseph Jolinon a conduit ainsi un héros qui fut d’abord un jeune athlète à travers l’enfer, évoqué dans l’atmosphère de cauchemar sarcastique du Valet de gloire, jusqu’aux vilenies de l’après-guerre stigmatisées dans la Tête brûlée. Les nouveaux problèmes ont encore inspiré à Léon Bocquet son émouvant Fardeau des jours, reprise de la vie dans un village des Flandres, à André Lamandé la grande fresque des Enfants du siècle et Ton pays sera le mien qui peint avec une généreuse loyauté, dans une demeure familiale du haut Quercy, le poignant débat d’un cœur allemand et de l’esprit français.
Thierry Sandre a été lui aussi marqué par la tourmente : heureux traducteur ou renouveleur d’ouvrages injustement oubliés, éditeur de l’anthologie des écrivains morts à la guerre, il a conté avec une sobre sincérité ses souvenirs de prisonnier dans le Purgatoire. Surtout, il a réussi à démêler et exprimer dans Mienne, confession d’un être en qui les ressorts de la volonté sont brisés, et dans le Chèvrefeuille, douloureux monologues sur la fragilité de l’amour, une attitude originale de l’homme façonné par la guerre.
Les premiers fragments de ce chapitre, publiés sur ce blog :
Publié dans Fragments, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 13 février 2010
René Lalou : les témoignages sur la Guerre III
J'ai trouvé le tome I de ce livre dans les affaires de mon grand-père. Publiée en 1946, L'histoire de la littérature française et contemporaine (1870 à nos jours) , de René Lalou, comporte d'assez beaux passages.
En voici un, que je recopie à l'usage de ceux qui trouvent amusant de lire un critique du milieu du XXème siècle sur la littérature "contemporaine".
Le chapitre « les témoignages sur la guerre » est émouvant, guirlande des traumatisés de 14-18 (cette guerre votée par des députés qui ne la firent point, mais continuèrent leur tranquille vie tandis que la jeunesse masculine française était envoyée à la boucherie).
Des soldats revenants, beaucoup écrirent, sans espoir.
La guerre de 14-18 a brisé beaucoup d’œuvres de jeunes écrivains qui commençaient, comme Alain-Fournier et son Grand Meaulnes ; elle a ensuite donné des raisons d’écrire à ceux qui n’en auraient pas eu l’idée sans elle.
III Les Croix de bois, de Roland Dorgelès
Les Croix de bois de Roland Dorgelès apparurent comme une sorte de mise au point du roman de guerre : aucun témoignage de combattant n’avait offert pour ses héros, chefs et soldats, intellectuels et ouvriers, la large impartialité qui distingue les robustes récits de ce livre et du Cabaret de la Belle Femme.
Les chapitres qui décrivaient la vie dans les tranchées et les attaques égalaient les pages tragiques du Feu ; mais jamais l’auteur ne prétendait généraliser rien ; il n’excluait point « la blague divine qui faisait plus forts » ses camarades. Ses traits les plus vigoureux ressuscitaient le réalisme des combattants : « La Marne, c’est une combine qu’a rapporté quinze sous aux gars qui l’ont gagnée ». Courageusement il soulignait la « terrible grandeur » de cet aveu de Sulphart : « J’trouve que c’est une victoire, parce que j’en suis sorti vivant ».
On trouverait difficilement dans toute la littérature de guerre un résumé des sentiments qu’elle provoqua chez les poilus plus simple et plus complet que les 30 pages qui retracent l’assaut, la descente des tranchées, le défilé glorieux, le sursaut d’orgueil enfin qui justifie un bref commentaire : « Allons, il y aura toujours des guerres, toujours, toujours ». Ce sobre réalisme est bien la qualité maîtresse de Dorgelès : le Saint-Magloire où il raconta l’échec d’un apôtre dans la société d’après-guerre verse dans le journalisme dès que l’auteur n’y observe plus cette discipline qui a donné aux Croix de bois, livre si spontané, une manière de style.
RENÉ LALOU
Publié dans Fragments, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
dimanche, 24 janvier 2010
René Lalou : les témoignages sur la Guerre
J'ai trouvé le tome I de ce livre dans les affaires de mon grand-père. Publiée en 1946, L'histoire de la littérature française et contemporaine (1870 à nos jours) , de René Lalou, comporte d'assez beaux passages.
En voici un, que je recopie à l'usage de ceux qui trouvent amusant de lire un critique du milieu du XXème siècle sur la littérature "contemporaine".
Le chapitre « les témoignages sur la guerre » est émouvant, guirlande des traumatisés de 14-18 (cette guerre votée par des députés qui ne la firent point, mais continuèrent leur tranquille vie tandis que la jeunesse masculine française était envoyée à la boucherie).
Des soldats revenants, beaucoup écrirent, sans espoir.
La guerre de 14-18 a brisé beaucoup d’œuvres de jeunes écrivains qui commençaient, comme Alain-Fournier et son Grand Meaulnes ; elle a ensuite donné des raisons d’écrire à ceux qui n’en auraient pas eu l’idée sans elle.
phot Sara
I Le Feu, d’Henri Barbusse.
(NOTE d'AlmaSoror : Comment un homme traumatisé par les millions de morts de 14-18 peut militer pour une cause qui fera des millions de morts, le Communisme ? Mystère, mystère…)
« …des choses épouvantables faites par 30 millions d’hommes qui ne les veulent pas ».
L’œuvre « militariste » de Péguy et de Psichari n’était point inhumaine mais évoquait avec gravité des problèmes urgents. De même, le roman de guerre ne fut point, dans l’ensemble, belliqueux. Il aurait fallu être aveugle à la durée et à l’immensité du carnage pour oser s’en réjouir. Les livres qui, de 1914 à 1918, connurent la faveur du public montrent assez bien les fluctuations de l’opinion durant cette période : aucun d’eux n’est coupable de sacrilège envers l’humanité.
Gaspard ne dépasse pas la facilité superficielle qui caractérise toutes les autres productions de René Benjamin : tout y est conventionnel : la guerre et ses à-côtés, les combattants et leurs infirmières. Mais le caractère de Gaspard, marchand d’escargots rue de la Gaïté, Parigot blagueur et héroïque, est de ceux auxquels, depuis Gavroche toutes les sympathies sont acquises. En 1915, on réclamait une détente : on la trouva dans ce journalisme sans prétention.
En 1916 parut le livre qui fut le plus grand succès de librairie de notre temps : le Feu, d’Henri Barbusse. Vingt ans avant, Barbusse avait débuté avec un recueil de poèmes, les Pleureuses, où se manifestait une sensibilité prompte à s’émouvoir devant les nuances les plus fugitives de la réalité moderne, mais qui ne parvenait point à les traduire sous une forme définitive. Le poème La Lettre, si proche encore d’Henry Bataille :
Je t’écris et la lampe écoute.
L’horloge attend à petits coups
Je vais fermer les yeux sans doute
Et je vais m’endormir de nous…
montre assez clairement les bornes de ce lyrisme familier. Dans L’Enfer, Barbusse se posait en successeur de Zola, et ce roman renfermait de vigoureuses descriptions. Mais l’écrivain avait en même temps cédé au désir d’y dresser une espèce de somme philosophique de son époque. C’était là de sa part un contre-sens sur son propre talent : s’il existe des esprits pour qui les idées ne comptent que selon leur valeur abstraite, Barbusse représentait l’autre extrême. Il appréhende des idées leur rayonnement sentimental ; en face d’une notion intellectuelle, il déploiera toutes les notions d’un cœur généreux, jamais il ne la peindra dans son impartiale nudité. La pensée de l’auteur de l’Enfer égalait en simplicité celle de la Couturière qu’il a chantée :
Elle croit à la beauté,
Elle croit à l’harmonie,
Elle se sent infinie,
Les lèvres dans la clarté.
Nous avons rappelé l’énorme succès du Feu : peut-être le dut-il d’abord à son extraordinaire accent de sincérité ; pour la première fois un écrivain apportait à ses lecteurs, sans aucune interposition littéraire, la vérité, une description exacte de la vie dans les tranchées. Mais cette popularité ne fut point un triomphe de surprise : le Feu réunit en effet toutes les qualités du réalisme humanitaire de Barbusse. Dans ce « journal d’une escouade », il s’est presque toujours interdit de dépasser son expérience personnelle et le point de vue du simple soldat ; de là, l’intensité des pages où, racontant une journée sans incident, une corvée ou une attaque, il évoque avec le relief de leur précision concrète la durée, la boue, les instincts élémentaires. Son émotion, assez vibrante pour dédaigner tout artifice, ressuscite, avec une sympathie virile ou un humour attendri, ses compagnons de combat qui ne furent point des héros, mais, plus glorieusement, des hommes. Même l’âpre satire qui stigmatise la division de la patrie en « deux pays étrangers, l’avant et l’arrière », n’est point une opposition factice : elle naît de cent petits faits qui gardent leur force. Surtout elle est dominée par le sentiment poignant que, si les civils oublieront vite ce qu’on souffert pour eux les combattants, ces derniers eux-mêmes n’en garderont point une mémoire intacte : « on est plein de l’émotion de la réalité au moment, et on a raison. Mais tout ça s’use dans vous. »
Le Feu représentait la guerre dans toute son horreur, plus haïssable encore d’être peinte avec cette tragique sobriété. Barbusse eût failli à l’honnêteté en ne cherchant point quel remède éviterait le retour « des choses épouvantables faites par 30 millions d’hommes qui ne les veulent pas ». Quelques pages du Feu indiquaient nettement sa volonté de pacifisme : une aube d’espoir se levait sur ce champ de bataille sinistre. Il était donc inévitable que Barbusse apparusse à beaucoup d’anciens combattants comme un guide et qu’il lui fût impossible de se soustraire à cet honneur. Persuadé par l’exemple de Zola que le roman peut devenir un instrument d’apostolat politique, il écrivit Clarté où l’affabulation romanesque voile mal son dessein de démontrer que, selon la conclusion des Paroles d’un combattant, « la seule voix humaine qui s’harmonise avec la nature elle-même, la musique pensante de l’aube et du soleil, c’est le chant de l’Internationale ». Tout jugement sur la portée d’ouvrages comme Élévation ou sa biographie de Staline dépend de l’opinion que l’on professe envers l’activité de militant à laquelle il a tout subordonné ; mais ses plus violents adversaires ont dû reconnaître la générosité avec laquelle Henri Barbusse a servi jusqu’à sa mort la cause du progrès humain qu’il prenait déjà l’engagement de défendre dans les admirables Lettres à sa femme (1914-1917).
René Lalou
Publié dans Fragments, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |