mardi, 18 novembre 2014
Encore un adieu
Affreuses visions de l'hôpital, des parkings, des aides-soignantes qui se traînent dans les couloirs glauquissimes, tragique transformation de Carmina pourvue d'une perruque blonde, maigre comme un clou, décharnée, la peau du visage et du corps jaune, allongée sur son lit, la voix un peu changée, pâteuse. Il y avait ses deux filles Gudule et Cléo, gentilles avec leur mère, ayant laissé leur dureté habituelle aux portes de la chambre, conscientes sans doute qu'il n'y a plus le moindre espoir. Je suis rentrée avec elles en voiture et nous n'avons touché mot du drame qu'elles vivent, que vit leur mère, nous riions de rien et de tout dans les embouteillages de Vertou. Oh mon Dieu notre siècle est celui des camps de concentration, hôpitaux, prisons, barres HLM, notre siècle est celui de la déshumanisation du monde et des fous rires dans des voitures payées à crédit.
Lorsque nous nous levâmes pour partir, Carmina se mit à sangloter. Puis, devant nos consolations fades, devant l'inanité de ses larmes, devant l'absurde fatalité de la situation elle a cessé de pleurer. Nous l'avons laissée seule face au plateau repas médiocre apporté par l'hôpital. Nous ne parlons pas en vérité de la mort, nous n'en parlons jamais alors que chacun y pense. Cette omission grande comme le néant empêche un vrai contact.
Là voilà, cette manière de mourir que chacun veut éviter et vers laquelle tant d'entre nous se dirigent. Une mort non choisie, (mal) administrée.
J'en suis hébétée.
Voir de suite la mort en face permettrait d'éviter cette lente déchéance sans paroles. Accepter l'arrivée de la mort la rendrait plus douce, plus vraie, plus tangible. Un adieu paisible serait possible.
Mais nous allons voir Carmina, nous savons qu'elle va mourir et ne lui disons pas Adieu parce que ce serait mentionner la mort, avouer qu'il n'y aura pas d'autre issue, et cette vérité là n'a pas sa place dans cette triste histoire...
Nous retournons dans la ville de Nantes, la laissant seule et jaune, dans sa chambre isolée et jaune, au milieu d'aides-soignantes, la plupart immigrées, qui lui parlent sans intérêt, sans gentillesse, qui ne sont là ni par dévotion, ni par morale, mais pour toucher leur salaire, sauf certaines qui sont un peu plus gentilles, un peu plus conscientes.
Ses filles retrouvent leurs maris et leurs enfants et j'hésite entre une soirée politique ou un bar lesbien pour oublier les détails techniques de la chambre 413. Elle s'éloigne de nous tandis que nous nous éloignons d'elle, si vivants, pour manger, boire, marcher sous le ciel de la ville, et ripailler loin des mourants. Et je pense à Paul-Jean Toulet, au poème qu'il écrivit le dernier jour et que la mort interrompit :
Ce n'est pas drôle de mourir
Et d'aimer tant de choses
La nuit bleue et les matins roses
Le verger plein de glaïeuls roses
L'amour prompt
Les fruits lents à mûrir...
Enfance, cœur léger.
Carmina, tu étais pétillante. Tu étais violente et méprisante, et drôle quand même quand tu laissais tout aller et que tu faisais la fête. Tu étais belle et pimpante le dimanche, et soudain glaciale comme une bourgeoise plus riche que nous, et à nouveau charmante, le verre à la main, entonnant une chanson, t'agitant dans un débat politique. « Je suis l'homme de la rue, je pose une question comme ça ! » crias-tu un jour à un amiral qui sourit, désarmé par ta faconde baroque, et nous rîmes tous. Ce soir, je suis chez moi devant mon ordinateur, la musique tourne, j'ai bien bu et mangé et je t'ai laissée seule, douloureuse, souffrant, pleurant, t'enfermant dans une bulle parce que ta prison t'a ensevelie, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, seulement de temps en temps des baisers de tes filles. Tout s'est effondré dans ta vie, ton mariage et ta santé. Nous avons vécu les uns à côté des autres, et tu t'en vas ?
Oui, tu t'en vas, et nous nous en irons tous à notre tour.
Hier soir à l'hôpital il y avait tout de même la beauté de la nuit sur le béton des villes de l'Ouest, la beauté des lumières des réverbères sur le toit des bâtiments, l'étrangeté nocturne qui dissipe la cruelle criardise du jour. L'allée le long de l'hôpital fut cinématographique.
("Une âme ne peut donner aux autres que du trop-plein d'elle-même, que le surplus qui lui est donné. On ne peut faire aimer l'Amour que dans la mesure où on le possède, comme on ne peut rayonner que si on porte en soi la Vérité, qui est la Lumière". Marthe Robin)
Sur AlmaSoror
| Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |
samedi, 05 janvier 2013
Métrodore : ouverture

Voici l'ouverture de Métrodore, un roman en suspension entre l'enfance et le monde adulte, entre hier et aujourd'hui.
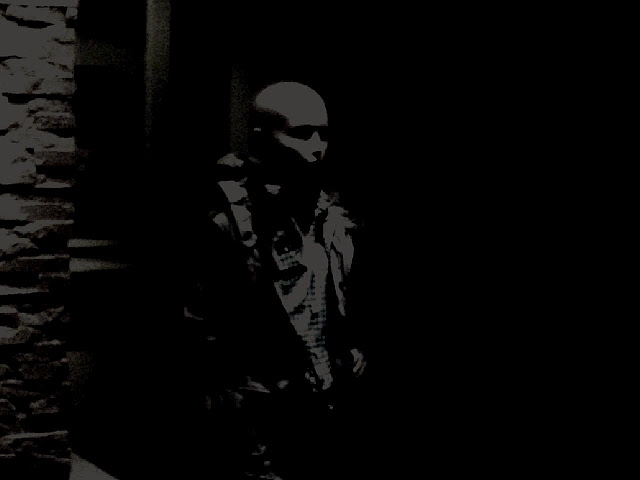
J’ai seize ans et je ne mange plus. Il paraît que ça n’arrive qu’aux filles qui ont des problèmes avec leur mère. Je suis un garçon et je n’ai pas de problèmes. Je suis seulement fatigué de vivre. La nourriture me dégoûte. Les gens me dépitent. Les professeurs me répugnent. Le lycée m’insupporte. Les magasins criards, la grisaille des rues, les ordinateurs me désespèrent. Je hais la société. Je m’appelle Jude Parizet et je vous hais.
Alors, vous m’avez amené ici, dans cet hôpital blanc. Les infirmiers me sourient : j’ai envie de leur cracher à la gueule. Les médecins me parlent d’un ton gentil : je les devine fiers de leur diplôme de médecine, fiers de s’occuper des jeunes en difficulté. Je les terrasse de mon mépris, mais ils s’en fichent : ils croient par-dessus tout qu’ils ont raison.
L’hôpital est blanc comme la mort, noir comme la peur, gris comme l’hiver. Le pavillon Michel-Foucault accueille des garçons et des filles entre treize et dix-sept ans. Nous errons dans les couloirs, nous marchons sur le carrelage des toilettes et le linoléum des pièces lugubres. Des néons jaunes éclairent l’escalier ; des néons blancs éclairent les murs blêmes. De nombreuses affiches empirent la laideur des murs. Une immense photographie du philosophe Michel Foucault orne le mur du vestibule. L’homme a l’air sadique et arrogant. Sur les murs des couloirs et de la salle de jour, de grotesques affiches montrent des jeunes en train de s’embrasser, de parler, de jouer au ballon. Sous les photos sont inscrits des slogans affligeants : « Moi, je dis non à la violence », « Moi, je dis non à la drogue », « La lecture est le plus beau voyage du monde ». Ils nous prennent pour des idiots.
D’autres jeunes sont là. Une petite dizaine. Certains n’ont pas le droit de venir dans la salle de jour ; nous les apercevons se faufiler comme des ombres, accompagnés par des infirmiers qui les mènent comme des enfants.
Nous, qui avons le droit de passer du temps dans la salle de jour, nous sommes libres de nos mouvements à l’intérieur du pavillon Michel-Foucault. Beaucoup sont des filles, encore plus maigres que moi. J’ai peur d’en voir une mourir. Ce serait triste à voir, une mort dans un hôpital. Quelle horreur d’agoniser dans un couloir de plastique et de béton. Si mourir, c’est quitter à jamais le monde où nous avons aimé et souffert, une mort au bout d’une plage, une mort en haut d’une montagne, c’est une mort bien plus belle.
Pourquoi sommes-nous ici ? On nous a enlevés de la vie normale pour nous enfermer dans cet hôpital parce que nous avons un problème avec l’idée de devenir adulte.
Les adultes se sont habitués à leur vie dans la ville, loin du ciel bleu, des arbres, des grandes forêts, des animaux sauvages, des océans. Ils se sont habitués à leurs habits étriqués, qui leur donnent l’air de petits pions. Ils se sont habitués à se lever au bruit strident du réveil, à se laver dans leur petite salle de bains, à utiliser des produits conformes aux normes pour se laver, pour manger, pour nettoyer leur maison…
Ils se sont habitués à se lever matin après matin.
Les adultes se sont habitués à remplir des papiers, à suivre des milliers de règles administratives, juridiques. Jour après jour, chaque fois qu’ils achètent, qu’ils vendent, qu’ils se marient, qu’ils divorcent, qu’ils ont des enfants, qu’ils en perdent, qu’ils partent en vacances, ils remplissent des papiers administratifs. Machinalement, ils écrivent dans les petites cases leur numéro de Sécurité sociale (un numéro d’au moins dix chiffres), leur sexe (masculin ou féminin, tant pis pour les anges), leur âge (comme si c’était important), leur lieu de naissance (pourquoi ?), leur statut social et leur statut familial. Ils ont des comptes en banque, des contrats d’assurances, des cartes d’assuré, des cartes d’électeur, des cartes bancaires. Sur tous ces papiers, des chiffres et des mots sans poésie.
Les adultes peuvent rester assis au bureau toute la journée alors que dehors brille un soleil magnifique. Ils peuvent parler des heures de l’actualité politique alors que Charles Baudelaire a écrit des poèmes qui traversent le temps. Ils peuvent prendre le métro tous les jours, dans de longs couloirs souterrains, pour se rendre de leur maison au travail et de leur travail à la maison. Ils peuvent subir cette vie pendant quarante ans sans jamais se révolter plus de deux jours.
J’ai seize ans, dans deux ans je serai un adulte.
Pourquoi voulez-vous que je mange ?
Edith de Cornulier-Lucinière

Publié dans Chronos, Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer |
Imprimer |













